
Jazz Records (les chroniques de l'année en cours)
Jazz Records (recherche alphabétique)
Jazz Records (recherche chronologique)
Jazz Records (Hot Five: la sélection de la rédaction)
Jazz Stage (les comptes rendus clubs, concerts, festivals de l'année en cours)
|
|
JAZZ RECORDS • Chroniques de disques en cours •
Ces chroniques de disques sont parues exclusivement sur internet de 2010 (n°651) à aujourd’hui. Elles sont en libre accès.4 choix possibles: Chroniques en cours (2023), Jazz Records/alphabétique (2010 à 2023 sur internet), Jazz Records/chronologique (2010 à 2023 sur internet), Hot Five de 2019 à 2023.
En cliquant sur le nom du musicien leader dans le programme des chroniques proposées, on accède directement à la chronique. Toutes les autres chroniques sont parues dans les éditions papier de 1935 (n°1) à février 2013 (n°662). A propos des distinctions, elle ne résument que la chronique, pour sacrifier à la tradition déjà ancienne des notations et à la mauvaise habitude moderne d'aller vite. Nous pouvons résumer l'esprit de ces niveaux d'appréciation par un raccourci qualitatif (Indispensables=enregistrement de référence, historique; Sélection=excellent; Découverte= excellent par un(e) artiste pas très connu(e) jusque-là; Curiosité=bon, à écouter; Sans distinction=pas essentiel pour le jazz selon nous). Cela dit, rien ne remplace la lecture de chroniques nuancées et détaillées. C'est dans ces chroniques de disques, quand elles sont sincères, c'est le cas pour Jazz Hot, que les amateurs ont toujours enrichi leur savoir. |
Au programme des chroniques
|
|
Des
extraits de certains de ces disques sont parfois disponibles sur
Internet. Pour les écouter, il vous suffit de cliquer sur les pochettes
signalées par une info-bulle.
© Jazz Hot 2023
|
  Philly Joe Jones Sextet & Quintet Philly Joe Jones Sextet & Quintet
Live at Birdland: Historic Unreleased 1962 Recordings
Joe's Delight*, I
Remember Clifford*, Take Twelve*, Shaw 'Nuff, The Scene Is Clean, Stablemates,
Muse Rapture°, Shaw 'Nuff°, Well You Needn't°
• Philly Joe Jones
(dm) Sextet*:
Dizzy Reece (tp), Sonny
Red (as), John Gilmore (ts), Elmo Hope (p), Larry Ridley (b)
• Philly Joe Jones
(dm) Quintet:
Bill Hardman (tp), Roland
Alexander (ts), Elmo Hope (p), Larry Ridley (b)
Enregistré live les
5 janvier*, 24 février et 3 mars° 1962, Birdland, New York, NY
Durée: 1h 19’ 41’’
Fresh Sound Records
1139 (www.freshsoundrecords.com/Socadisc)
Né le 15 juillet 1923
à Philadelphie, PA, Philly Joe Jones aurait eu 100 ans cette année. A cette
occasion, Fresh Sound a sorti de l’armoire aux trésors des sessions live inédites du batteur, effectuées en
1962 au Birdland et radiodiffusées à l’époque. Chef de file, avec son homonyme Elvin Jones (en compagnie duquel il enregistra), d’un renouvellement du langage
de la batterie (cf. Jazz Hot n°131, avril 1956) ancré dans le bop, Philly Joe Jones s’inscrit dans une continuité, comme toujours en jazz. Celle-ci remonte aux aînés de
la batterie swing –Baby Dodds (1898-1959), Cozy Cole (1909-1981), Sid Catlett (1910-1951), auprès desquels il se forme à son arrivée à New York, NY– en
passant par le grand Jo Jones (1911-1985), père de la batterie moderne (pour se
distinguer duquel il adopte le surnom «Philly»), jusqu’aux «grands frères»
ayant porté les dernières évolutions rythmiques: Kenny Clarke (1914-1985) qui
restera pour Philly Joe un mentor («il a entièrement révolutionné le monde de
la batterie», cf. Jazz Hot n°425), Art
Blakey (1919-1990) et Max Roach (1924-2007). C’est pétri d’admiration pour ses
pairs –y compris Buddy Rich (1917-1987), «batteur brillant» mais qui «n’a pas
le feeling»– que Philly Joe construit sa personnalité musicale caractérisée par
une frappe nerveuse, un swing explosif, une élaboration complexe du rythme alliée
à une extrême sensibilité. Cette formidable synthèse entre tradition et
modernité à laquelle il intègre ses propres innovations lui permet de jouer
dans des contextes variés, du mainstream au free jazz, et en a fait l’un des maîtres
les plus respectés dans la communauté des musiciens.
Dans une interview
donnée à Jazz Hot peu avant sa
disparition le 30 août 1985 (n°425, octobre 1985), il était
longuement revenu sur son parcours: le premier apprentissage musical donné par
sa mère, Amelia, pianiste classique (Philly Joe écrira certains de ses
arrangements au piano); son service militaire pendant la Seconde Guerre
mondiale (1941-44); de retour à Philadelphie, son emploi de chauffeur de
tramway avant de se lancer dans la carrière de musicien professionnel en compagnie
d’autres «jeunes types» de la ville comme Benny Golson et John Coltrane; son
installation définitive à New York et bien sûr le premier quintet de Miles
Davis (1955-57) avec John Coltrane, Red Garland et Paul Chambers, puis le
sextet (1958) avec Cannonball Adderley.
Porté par son compagnonnage avec Miles,
Philly Joe enchaîne de 1957 à 1960 les collaborations (Clark Terry, Sonny
Rollins, Thelonious Monk, Bill Evans, Freddie Hubbard, parmi beaucoup d’autres)
devenant, comme l’indique le livret très détaillé de Jordi Pujol, le batteur
américain le plus enregistré de l’époque, tous genres musicaux confondus. Le
sideman a dès lors des envies de leader et grave un premier disque sous son nom
en 1958, Blues for Dracula (Riverside) marquant avec humour son goût pour les films d’épouvante (cf.
Jazz Hot n°151, février 1960). Quand sont effectuées, entre janvier et
mars 1962, les présentes sessions, Philly Joe, à la tête de ses propres
formations, a définitivement acquis une stature de musicien de premier plan. Il
est en couverture du Jazz Hot n°160 de décembre 1960.
Ces live au Birdland sont captés dans le
cadre de l’émission radiophonique du célèbre animateur radio Symphony Sid, alias
Sidney Torin (né Tarnopol, 1909-1989). Issu d’une famille d’immigrants de
langue yiddish, il grandit à Brooklyn, NYC, et il découvre le jazz durant son
adolescence. Il est d’abord employé chez un disquaire et débute sa carrière
d’animateur en 1937, sur une station du Bronx, WBNX, pour une émission
d’après-midi où, à l’inverse de ce qui y est pratiqué sur les antennes, il passe
exclusivement les disques des jazzmen afro-américains, réunissant ainsi un
public jeune et intercommunautaire. Dès l'apparition du bebop, il en devient un ardent promoteur. Un
activisme qui est salué par les musiciens dont plusieurs lui dédient des
compositions: «Jumpin’ With Symphony Sid» de Lester Young (qui devient son
indicatif), «Walkin’ With Sid» d’Arnett Cobb ou «Symphony in Sid» d’Illinois
Jacquet. En 1950, il commence à animer ses émissions depuis le Birdland (qui a
ouvert un an plus tôt) pour WJZ, une filiale d’ABC qui assure une diffusion sur
trente Etats, donnant au bebop une visibilité inédite. Il poursuit
ses live sur WEVD à partir de 1957.
En 1962, l’émission
de Symphony Sid est donc un rendez-vous incontournable pour les jazzfans et les
musiciens (cf. chronique Al Grey/Billy Mitchell). On remarque
d’emblée que Philly Joe a choisi des partenaires qui sont tous passés par Blue Note (au moins en sideman) et appartiennent à la galaxie bop-hard
bop qui emmènera certains jusqu’au free jazz. Sur les trois sessions, le
batteur est au centre de la même rythmique. Elmo
Hope (1923-1967) avec lequel il a joué à la fin des années 1940 dans le
groupe rhythm & blues de Joe Morris qui comptait aussi Johnny Griffin et
Percy Heath, et sur son New Faces-New
Sounds (1953, Blue Note), est l’un des initiateurs du piano bop avec Bud
Powell et Thelonious Monk, bien que la postérité ne lui ait pas accordé la même
place malgré une œuvre de compositeur importante. Plus jeune, le contrebassiste
Larry Ridley (1937), en compagnie duquel Philly Joe a enregistré pour Freddie
Hubbard (Hub Cap, 1961, Blue Note),
débute alors une brillante carrière d’accompagnateur.
Sur le live du 5 janvier, le batteur est en
sextet. A la trompette, le Jamaïcain Dizzy Reece (1931) qui, après avoir
séjourné à Londres et Paris, s'est installé à New York depuis 1959. A l’alto,
Sonny Red (1932-1981) a débuté à Detroit, MI, avec Barry Harris, avant
d’accompagner Art Blakey puis Curtis Fuller. Au ténor, John Guilmore
(1931-1995), venu de Chicago, IL, et fidèle compagnon de route de Sun Ra, a
déménagé à New York en 1960, avec d’autres membres de l’Arkestra, où il devient
sideman pour différents musiciens. Philly Joe ouvre son «Joe's Delight» de son
drumming bouillonnant faisant entrer l’orchestre directement dans le vif du
sujet: le swing! Dès les premières minutes de ce long morceau (13’43’’), on est
déjà étourdi par l’énergie dégagée par les solos successifs de la front line, sans oublier Elmo Hope,
sublime dans sa façon de placer parcimonieusement les notes lors des échanges
avec le leader. La belle et chaleureuse sonorité de Dizzy Reece expose
longuement le thème «I Remember Clifford» (Benny Golson) avec le soutien tout
en finesse de Philly Joe qui, à l’occasion d’un numéro époustouflant sur «Take
Twelve», donne l’impression de faire sonner simultanément chaque partie de son
instrument.
Les 24 février et 3
mars, Philly Joe est en quintet. Le trompettiste Bill Hardman (1932-1990) est
originaire de Cleveland, OH où il a notamment débuté avec Bobby Few et
enregistre son premier album avec Jackie McLean en 1956 (Jackie’s Pal: Introducing Bill Hardman, Prestige), joue avec
Charles Mingus, Art Blakey, Horace Silver et Lou Donaldson. Le ténor Roland
Alexander (1935-2006) a débuté dans sa ville de Boston, MA, notamment avec Jaki
Byard, et s’installe à New York en 1958 pour jouer avec Paul Chambers, Charli Persip ou encore Howard McGhee. Comme sur l’autre session, l’attaque mordante
de l’orchestre saisit immédiatement, en particulier celle de Bill
Hardman et Roland Alexander sur «Shaw 'Nuff» (Dizzy Gillespie). On est encore
happé par le solo extraordinaire de Philly Joe qui paraît capable de tirer n’importe
quel son de sa batterie, tandis qu’Elmo Hope sur «The Scene Is Clear» (Tadd
Dameron) se fait à la fois léger, véloce et percussif, en lien avec le maintien
rythmique fondamental de Larry Ridley: quel trio!
Ces exhumations restituent ainsi la réalité d’un monde aujourd'hui révolu, peuplé par des musiciens s’exprimant
avec une intensité qui n'a malheureusement plus son pareil, et ceci explique sans aucun doute cela.
Jérôme Partage
© Jazz Hot 2023
|
  Ramona Horvath Trio Ramona Horvath Trio
Carmen's Karma
Claire de Bussy,
Carmen's Karma, La Valse des asperges jaunes, Lagniappe, Portrait de la Comtesse, Enescool, Fantaisie, Winnaretta Song, Caipirinha com Pedro
Ramona Horvath (p)
Nicolas Rageau (b), Antoine Paganotti (dm)
Enregistré les 19 et
20 janvier 2023, Colombes (Hauts-de-Seine)
Durée: 49’ 23’’
Née dans une famille
musicienne où l’on jouait du classique, de la musique traditionnelle comme des
variétés et formée au Conservatoire de Bucarest, Romana Horvath est une
jazzwoman accomplie qui a fait fructifier l’ouverture artistique dont elle a
bénéficié dès l’enfance pour opérer une synthèse entre sa culture de naissance
et l’expression jazz acquise dans un second temps (cf. son interview dans Jazz Hot). Ce double apprentissage est aujourd’hui très répandu du fait des études poussées et formatées des écoles, conservatoires et universités, mais la pratique du piano jazz et de la musique classique était, dans la première moitié du XXe siècle, l’apanage de quelques parfaits «bilingues» bien au-delà de la maîtrise technique, avec une perception très fine, d’Art Tatum à Hazel Scott, en passant par Eddie (Eddy) Bernard sans oublier Bud Powell et Don Shirley formé à 9 ans en 1936 à Léningrad parmi d'autres! Aujourd’hui, un autre héritier de ce double apprentissage est Rossano Sportiello: ce n’est sans doute pas un hasard, car l’Italie et la Roumanie partagent cette tradition ancienne de la mélodie narrative populaire, accompagnait la voix et les danseurs, une pratique dont le jazz était évidemment porteur, avec son accent alternatif d'un nouveau monde à construire. Ramona Horvath a les atouts de ce double feeling, de ce bilinguisme du piano d’excellence pour pouvoir se lancer dans cet exercice périlleux de la rencontre de deux traditions, et en faire un voyage tonique et inventif.
Avec ce Carmen’s
Karma, elle a eu pour démarche non pas seulement de faire swinguer des pièces classiques,
mais de re-composer des morceaux à partir des structures mélodiques, harmoniques ou rythmiques d'œuvres assez connues du public ou inspirés par des compositeurs de la musique romantique, impressionniste et lyrique dont
le détail est précisé dans le livret.
«Claire de Bussy», tiré du «Clair de Lune»
de Claude Debussy a été coécrit par Nicolas Rageau dont les belles lignes de basse mettent en valeur le superbe toucher de Ramona. Par la proximité mélodique et
harmonique avec le thème original, le trio opère une sorte de jeu s’approchant au plus près de l’idiome classique et de l’œuvre
modèle tout en conservant une respiration jazz. «Portrait
de la Comtesse», une variation sur «Pavane», ce «portrait musical» que Gabriel
Fauré avait écrit pour la comtesse Greffulhe, une personnalité du Paris de la
Belle Epoque qui inspira à Marcel Proust sa duchesse de Guermantes. Le morceau
s’ouvre sur un magnifique solo de Nicolas Rageau exposant les mesures reconnaissables du célèbre thème, reprises par Ramona avec une retenue et une
clarté propres aux concertistes classiques. Dans la même lignée, «Winnaretta
Song» vient de la «Pavane pour une infante défunte» de Maurice Ravel qui
s’était lui-même inspiré de la «Pavane» de Fauré. Le thème débute également par
une exposition à la contrebasse, mais avec des accélérations de tempo et
davantage d'accents de la part de la pianiste. Du swing, on en trouve aussi sur «Lagniappe» d’après «Humoresque» d’Antonin Dvorak, une variation aux
accents new-orleans avec un bon travail rythmique d’Antoine Paganotti, de même
que sur «Enescool», un titre évoquant le virtuose précoce et compositeur George Enescu, né en Moldavie roumaine, Prix de Vienne, et peaufiné entre autres par Gabriel Fauré à Paris (1895).
Avec toujours beaucoup de naturel et de fluidité, le trio emmène le deuxième
mouvement de la Symphonie n°5 de Tchaïkovski
du côté de la bossa avec «Caipirinha com Pedro», une transposition
assez inattendue! On découvre enfin d'autres chemins de traverse
qu’empruntent les musiciens en lisière de la Carmen de Georges Bizet ou des sonates de Schubert et de Beethoven: du bel ouvrage!
Jérôme Partage
© Jazz Hot 2023
|
  The Al Grey and Billy Mitchell Sextet & Septet The Al Grey and Billy Mitchell Sextet & Septet
Live at the Museum of Modern Art & at Birdland
CD1: Bluish Grey, Wild Deuce, On Green Dolphin Street, Bantu, Melba's Blues, Home Fries**, Grey's Blues, Minor on Top*, African Lady*, Hi Fly*
CD2: Home Fries°, Minor on Top°, On Green Dolphin Street°, African Lady°, Blues/Closing announcement/Jumpin’ With Symphony Sid Theme°, J & B+, Melba's Blues+, Three-Fourth Blues+, Rompin+
Al Grey (tb), Billy Mitchell (ts, as**) avec:
• Henry Boozier (tp), Gene Kee (p, cor alto), Art Davis (b), Jules Curtis (dm), Ray Barretto (perc)
• Donald Byrd*°, Dave Burns+ (tp), Bobby Hutcherson (vib)*°+, Herbie Hancock (p)*, Herman Wright*+, Doug Watkins° (b), Eddie Williams (dm)*°+
Enregistré live les 6 juillet 1961, Museum of Modern Art, 20 et 31 janvier, 19 mai 1962, Birdland, New York, NY
Durée: 50’ 30’’ + 1h 09’ 09’’
Fresh Sound Records 1137 (www.freshsoundrecords.com/Socadisc)
  Al Grey / Billy Mitchell Al Grey / Billy Mitchell
Studio Recordings
Nothin’ but the Truth, Three-Fourth Blues, Just Waiting, R.B.Q., On Green Dolphin Street, Blues in the Night*, Stella by Starlight*, The Way You Look Tonight*, Through for the Night*, Stardust, Night and Day*, Laughing Tonight*, Dirty Low Down Blues°
Al Grey (tb) et Billy Mitchell (ts), Dave Burns (tp), Bobby Hutcherson (vib), Calvin Newborn (g)°, Floyd Morris, Earl Washington* (p), Herman Wright (b), Eddie Williams, Otis Candy Finch* (dm), Philip Thomas (perc)*
Enregistré les 19 février, 1er novembre 1962 et au cours de l’année 1962, Chicago, IL
Durée: 58’ 23’’
Fresh Sound Records 1138 (www.freshsoundrecords.com/Socadisc)
L’association entre Al Grey (1925-2000) et Billy Mitchell (1926-2001) est une belle histoire musicale et amicale qui commence par des parcours croisés. Le premier a grandi en Pennsylvanie. Il s’initie d’abord à la trompette, au cor et au tuba avant d’adopter le trombone durant son service dans la Marine, pendant la Seconde guerre mondiale, à l’issue duquel il entre dans l’orchestre de Benny Carter (1945-46). Il passera ensuite par ceux de Jimmy Lunceford (1946), Lucky Millinder (1946-48), Lionel Hampton (1948-52), Arnett Cobb, et tourne pendant un an avec le big band de Dizzy Gillespie (1956-57), à la même période que Billy Mitchell.
Celui-ci est né à Kansas City, MO, mais a passé sa jeunesse à Detroit, MI, où il étudie au lycée Cass Tech. Professionnel à 17 ans dans le big band Nat Towles. Il part ensuite travailler à New York, NY, avec Lucky Millinder (1948), Jimmy Lunceford, Milt Buckner, puis Woody Herman. De retour à Detroit, il monte son propre quintet (1950-53) qui comprend les frères Thad et Elvin Jones. Billy Mitchell et Al Grey passent ensemble dans l’orchestre de Count Basie en 1957 à l’issue de leur tournée avec Dizzy. C’est là que mûrit leur projet de monter leur propre groupe. Dans le livret, Jordi Pujol détaille les circonstances en ayant précipité sa création: Al Grey s’étant cassé la cheville en décembre 1960, il est renvoyé de chez Basie, dont il était l’un des piliers, et décide de concrétiser ses envies de leader, bientôt rallié par son ami Billy Mitchell qui démissionne de l’orchestre. Comptant six à huit membres, cette formation à géométrie variable –avec la présence régulière de musiciens originaires de Detroit, probablement à l’initiative de Billy Mitchell– a été active de janvier 1961 à mars 1963.
Fresh Sound réunit aujourd’hui l’intégralité de ces enregistrements sur deux nouvelles productions dont la qualité contribue à reconstituer la mosaïque artistique du jazz: un double CD (CD1 et CD2) réunissant les sessions live, The Al Grey and Billy Mitchell Sextet & Septet, et un CD simple, Studio Recordings (CD3). Ainsi, début 1961, après des concerts de rodage en Pennsylvanie, la version initiale du sextet obtient un premier engagement d’importance au Tivoli Theater de Chicago, IL, et assoit progressivement sa réputation. Al Grey et Billy Mitchell ne parviennent cependant pas à placer leur sextet au festival de Newport l’été suivant car son organisation a été donnée à Sid Bernstein en lieu et place de son créateur George Wein. Toutefois, le tromboniste et le ténor y participent le 1er juillet en invités du trio d’Ike Isaacs (b, 1923-1981) et font forte impression. Jazz Hot (n°168) s’en fait d’ailleurs l’écho: «le clou de l’après-midi: Billy Mitchell (ténor) et Al Grey (tb); ces deux compères diplômés des écoles des professeurs Gillespie et Basie nous donnent quelques moments incomparables (…). Ils terminent avec une jam-session torride, rejoints par Carol Sloane, Jon Hendricks et Michael Olatunji». Mis en confiance par ce succès, ils enregistrent le 6 juillet leur premier live au Museum of Modern Art de New York qui donnera le LP The Al Grey and Billy Mitchell Sextet (Argo, CD1), bien qu’avec l’ajout de Ray Barretto il s’agisse d’un septet! Gene Kee (p) qui renforce au cor alto la section de cuivres sur certains titres (contre-chants de «On Green Dolphin Street») prend en charge les arrangements. Le disque s’ouvre sur «Bluish Grey» (Thad Jones) introduit par une section rythmique, complétée par Art Davis et Jules Curtis, qui installe un swing intense pour amener l’intervention des deux coleaders: Al Grey offre un solo étincelant, Billy Mitchell vibre de virtuosité bop. Deux morceaux ont été apportés par Gene Kee: «Wild Deuce» et «Home Fries» (le groupe continuera à jouer ses titres après son départ) où Billy Mitchell est à l’alto. Le LP se conclut sur un spectaculaire «Grey’s Blue» (Al Grey) avec un numéro de batterie réalisé par Jules Curtis.
Fresh Sound propose ensuite trois sessions live au Birdland: deux retransmissions radio inédites, captées les 20 janvier et 19 mai 1962 (CD2), présentées par l’animateur Symphony Sid Torin (cf. chronique Philly Joe Jones) avec quelques parasites d'époque, et une troisième, du 31 janvier 1962 (CD1), constituant la face B du LP Snap Your Fingers (Argo), dont la face A a été enregistrée en studio, à Chicago, IL, le 19 février 1962 (CD3).
Depuis qu’il a accompagné Sarah Vaughan en octobre 1961 pour un engagement de cinq semaines à Las Vegas, NV, le sextet s’est renouvelé en intégrant le tout jeune Bobby Hutcherson ainsi que Donald Byrd et Doug Watkins (b, 1934-1962), tous deux originaires de Detroit. Sur le live du 20 janvier 1962, on savoure les enrichissements harmoniques apportés par Bobby Hutcherson tandis que Donald Byrd qui a déjà fait ses classes chez Art Blakey, impose sa présence («Home Fries»), amenant le groupe à un degré d’intensité encore supérieur (superbe «African Queen» de Randy Weston). Le 31 janvier, Herman Wright (1932-1997), autre natif de Detroit, a pris le relais de Doug Watkins. La formation est en septet sur cette session avec la participation d’un autre «gamin», Herbie Hancock (1940) qui en septembre suivant emploiera Donald Byrd sur son Royal Flush (Blue Note). Sur «Minor on Top» (Thad Jones), Billy Mitchell donne un solo fiévreux avec le soutien swing d’Herbie Hancock. Bobby Hutcherson intervient longuement, de même que sur «Hi Fly» (Randy Weston) avec un Donald Byrd impérial. Al Grey livre une démonstration de haut vol sur «African Lady» (de la tromboniste de Kansas City, MO, Melba Liston). Le 19 février, dans le studio Ter Mar Recordings de Chicago, un pianiste du cru Floyd Morris (1926-1988), prend la place d’Herbie Hancock et Dave Burns celle de Donald Byrd parti pour se consacrer à ses projets en leader. Dave Burns qui compte alors déjà vingt ans de carrière (Dizzy Gillespie, James Moody, Duke Ellington…) restera le trompettiste attitré du groupe, lui apportant sa sonorité chaleureuse («Three-Fourth Blues» de Gene Kee). De retour au Birdland le 19 mai, la formation redevient un sextet sans piano, mais ne perd rien de sa vitalité («J & B» de Billy Mitchell, où Dave Burns cite avec humour «Qui craint le grand méchant loup»!). Un autre titre de Melba Liston est au programme, le langoureux «Melba’s Blues».
Quelques mois plus tard, le 1er novembre (la discographie de Walter Bruyninckx fournit une datation légèrement différente: les 2 et 5), Al Grey et Billy Mitchell enregistrent de nouveau à Chicago, cette fois en octet, sept titres qui seront publiés sur le LP Night Song (Argo, CD3). Le groupe s’adjoint deux musiciens de la scène locale: Earl Washington (p, 1921-1975) et Philip (ou Phil) Thomas (perc, 1929-2002). En outre, c’est encore un musicien de Detroit qui s’assoit derrière la batterie, Otis Candy Finch (1933-1982), lequel vient d’enregistrer, toujours à Chicago, un autre disque pour le compte de Billy Mitchell seul, This Is Billy Mitchell (Smash) où l’on retrouve également Dave Burns, Bobby Hutcherson et Herman Wright. Davantage tourné vers les standards que vers les compositions récentes, cette séance regorge de pépites, comme les solos d’une grande profondeur donnés tour à tour par les trois soufflants sur «Stardust» (Hoagy Carmichael) dans un écrin harmonique esquissé par les petites touches de Bobby Hutcherson.
On relève enfin en «bonus track» (CD3), une composition d’Al Grey, «Dirty Low Down Blues», qui constitue la face B d’un 45 tours Argo dont la face A est le «Nothin’ but the Truth» tiré du LP Snap Your Fingers. Si la date de l’enregistrement effectué à Chicago se situe en 1962 sans plus de précision, elle est probablement voisine de la session du 19 février de Snap Your Fingers, l’orchestre étant identique, si ce n’est l’ajout du guitariste Calvin Newborn, frère cadet de Phineas, qui est sur ce blues the right man at the right place, tout comme le magnifique Floyd Morris. Une belle conclusion à cette intégrale des enregistrements du duo Al Grey-Billy Mitchell qui début 1963 repartiront chacun de leur côté: le tromboniste prolonge l’aventure du septet avec ses membres récents (Havin a Ball, janvier 1963, Argo) et le saxophoniste réactive son quintet avec Thad Jones (A Little Juicy, août 1963, Smash), tous deux continuant à écrire l’histoire du jazz à une époque où elle reste d’une densité inimaginable aujourd’hui.
Jérôme Partage
© Jazz Hot 2023
|
  Jimmy Jones Trio & Solo Jimmy Jones Trio & Solo
The Splendid Mr. Jones
Easy to Love, Little Girl Blue, Lush Life, Just Squeeze Me,
My Funny Valentine, Good Morning Heartache
• Jimmy Jones (p), Joe Benjamin (b), Roy Haynes
Moonlight in Vermont, London in July, Autumn in New York,
Cool in Cuba
• Jimmy Jones (p), Billy Hadnott (b), J.C. Heard (dm)
New World A-Comin’
• Jimmy Jones (p), John Levy (b) Denzil Best (dm)
Lazy River*, When I Walk With You**, Empty Space**,
Zigeuner°
• Jimmy Jones (p), Al Hall (b), Denzil Best*, Bill Clark**
(dm) + Al Casey (g)*, Lynn Warren (voc)°
What’s New?, I’ll See You Again, Mad About the Boy, Someday
I’ll Find You, Clair de Lune, Lover Man, New York City Blues, On a Turquoise
Cloud, Bakiff
• Jimmy Jones (p solo)
Enregistré entre 1947 et 1954, New York, NY, Los Angeles,
CA, Paris
Durée: 1h 15’ 19’’
Fresh Sound Records 1134 (www.freshsoundrecords.com/Socadisc)
Jimmy Jones (1918-1982) est une de ces multiples étoiles de la
galaxie jazz sur lesquelles Fresh Sound braque son télescope avec sagacité, disque
après disque. Né à Memphis, TN, mais élevé dans le terreau chicagoan par des parents musiciens amateurs, le pianiste (qui commença par jouer de la guitare), très marqué par l'influence d'Art Tatum et de Duke Ellington, avait cependant envisagé une autre carrière, poursuivant des études de sociologie au Kentucky State College –il y effectua des arrangements pour l'orchestre de l'université–qu'il dut interrompre avec l'entrée des Etats-Unis dans la Seconde guerre mondiale, quelques mois avant l'obtention de son doctorat. C'est ainsi que de retour à Chicago, il mit ses talents d’accompagnateur, d’arrangeur et de compositeur au service du jazz et en particulier de Stuff Smith (1943-45) qui le fit s'établir à New York, NY pour un engagement d'un an au fameux Onyx Club. Son autre collaboration d'importance fut avec Sarah Vaughan (1947-52, 1954-58), rencontrée au Café Society lequel, prônant l'anti-ségrégation et les droits civiques dès l'avant-guerre, était considéré comme un repère de «communistes» par Edgar J. Hoover, le patron du FBI, qui prêtera la main au maccarthysme après-guerre pour fermer les deux établissements de Barney Josephson où les idées de justice circulaient un peu trop... Jimmy Jones
travailla également comme arrangeur pour Duke Ellington et Billy Strayhorn de même qu'avec Dr. Billy Taylor, parmi d'autres compagnonnages: Dizzy Gillespie, Don Byas, Coleman Hawkins, Etta
Jones, Clifford Brown et de nombreux vocalistes (sa
spécialité), Nancy Wilson, Big Joe Turner, Joe Williams, Carmen McRae, Ella
Fitzgerald... Il a cependant peu enregistré sous son nom et sur une période
limitée, entre 1944 et 1957, alors que sa discographie en sideman court bien au-delà, notamment avec Kenny Burrell, Ellington
Is Forever, volumes 1 et 2, 1975, Fantasy. Pour les détails de son
parcours, on se reportera, comme à l’accoutumée, au très informatif livret de
Jordi Pujol. Ce dernier a fait le choix de présenter les sessions de façon
thématique, d’abord celles en en trio, voire en quartet (plages 1 à 15), puis celles
en solo (plages 16 à 24). Gravées entre 1947 et 1954, elles complètent fort
opportunément le CD 1946-1947 de la
série «The Chronological» paru il y a vingt ans chez Classics, où le pianiste
dirige des formations plus larges.
Le premier titre sur le plan chronologique, «New World A-Comin’», a été enregistré par Jimmy Jones le 4 mars 1947, en trio avec son ami John
Levy (b, qui l’avait fait engager chez Stuff Smith en 1943) et Denzil Best (dm),
à l’initiative de Wax Records. Le label a également produit les
autres titres datés de 1947 (plages 12 à 24) ayant donné lieu à
plusieurs 78 tours (jusqu’ici réédités sur CD de façon éparse), sur lesquels Jimmy Jones
est en solo ou en trio avec Al Hall (b) et Bill Clark (dm). Ce dernier cède la place à Denzil
Best sur «Lazy River» où la formation passe au quartet avec l’ajout d’Al Casey
(g) qui fait sonner certaines notes à la façon de Django Reinhardt. Sur les thèmes en
piano solo, Jimmy Jones déploie une technique superbe et un jeu élégant, d’une
grande clarté, qui rappelle celui de Teddy Wilson,
magnifiant les ballades («Mad About the Boy» de l'auteur britannique Noël Coward aux idées subversives et homosexuel assumé, dont d'autres compositions sont interprétées) et donnant une version très expressive du
«Clair de lune» de Debussy, dans l’idiome classique. On retrouve bien sûr ces
mêmes qualités de soliste sur les thèmes en trio, tandis qu’apparaît son talent
particulier d’accompagnateur sur «Empty Space» en soutien à la méconnue Lynn
Warren (voc), autre morceau où la formation relève du quartet.
Quatre autres titres, datant de 1952, sont proposés en trio
avec Billy Hadnott (b) et J.C. Heard (dm) dont Jimmy Jones fut le sideman de
1945 à 1947. Ces faces sont tirées du LP Escape!,
une compilation parue chez GNP où sont jointes des sessions des pianistes de
studio Paul Smith (1922-2013, futur directeur musical d’Ella Fitzgerald) et
Corky Hale (1936). Ces titres sont l’occasion d’apprécier le beau jeu en «block chords», caractéristique de Jimmy
Jones («Moonlight in Vermont»), dont il s’était expliqué dans le Jazz Hot n°94 de décembre 1954: «Ce n’est que vers 1946, lorsque je travaillais avec Stuff Smith (auquel un article est également consacré dans ce numéro) que
j’ai vraiment commencé à me dégager de l’influence des autres pianistes.
Savez-vous comment j’ai mis au point ce style de "block chords" qui me fut
attribué? Le piano de l’Onyx était une véritable casserole, sur lequel il
fallait cogner comme un sourd pour en tirer quelques sons; et force fut donc
pour moi d’adopter un style plus efficace…». On relève par ailleurs sur
cette série une jolie pépite latine, «Cool in Cuba» (une composition du pianiste)
avec un savoureux travail de percussion opéré conjointement au piano et à la
batterie.
On doit la dernière série d’enregistrements, réalisée en
octobre 1954, à Charles Delaunay qui profita de la venue à Paris de Jimmy
Jones, en pleine tournée européenne avec Sarah Vaughan, pour graver six titres
parus chez Swing. C’est bien sûr à cette occasion que Jazz Hot put recueillir les paroles du pianiste, rapportées dans le
numéro de décembre. On le retrouve ici en trio avec Joe Benjamin (b) et Roy
Haynes sur un dynamique «Easy to Love» qui s’ouvre sur les block chords du pianiste, auxquels
répondent les lignes de basse de Joe Benjamin, le tout sur un tapis rythmique
formé par les balais de Roy Haynes. Le reste est tout aussi remarquable, les
musiciens portant l’art du trio, dans cette session, à sa quintessence.
On ne peut que chaudement
recommander l’écoute du «splendide» Jimmy Jones que vous avez forcément déjà croisé
auprès d’autres grands du jazz. Il vaut le détour!
Jérôme Partage
© Jazz Hot 2023
|
  Klas Lindquist Nonet Klas Lindquist Nonet
Alternative Source of Energy
At Ease, Thorium*, Swells, Joey°, The Narrator, Dream,
Nilsie, Bernadette**
Klas Lindquist (as, cl), Karl Olandersson (tp, flh), Nils
Janson (tp), Magnus Wiklund (tb), Robert Nordmark (ts, fl), Fredrik Lindborg
(bar, bcl), Petter Carlson Welden (p), Kenji Rabson (b), Daniel Fredriksson (dm)
+ Lina Lövstrand (fl)**, Filip Ekestubbe (p)*°, Leo Lindberg (org)°**, Calle
Rasmusson (perc)**
Enregistré les 9 et 10 janvier 2023, Stockholm (Suède)
Durée: 41’ 42’’
Teng Tones 018 (tengtones.com/klaslindquist.com)
La scène jazz mainstream suédo-danoise –les échanges étant
constants de part et d’autre du détroit de l'Øresund– regorge de bons musiciens comme
l’illustre encore l’album du saxophoniste suédois Klas Lindquist. On le connaît
d’abord comme accompagnateur du batteur danois Snorre Kirk, parfois aux
côtés d’un autre sax de talent, Jan Harbeck, également danois. Né en
1975 à Göteborg, il a étudié à l’Ecole royale supérieure de musique de
Stockholm ainsi qu’au Mannes College of Music de New York. Cette expérience
américaine n’est pas pour étonner car Klas Lindquist s’inscrit pleinement dans
le jazz de culture. On le retrouve dans différentes formations, soit comme
sideman au sein de l’Artistry Jazz Group avec Jan
Lundgren et Jacob Fisher (g), du Glenn Miller Orchestra de Jan
Slottenäs (tb) ou auprès de Ronnie Gardiner (dm), Hayati
Kafe (voc), Claes Janson (voc), Mathias Algotsson (p) ou encore Ulf
Johansson Werre (p, tb, voc); soit en coleader du Stockholm Swing All Stars et
à la tête de son quartet ou de son nonet dont ce Alternative Source of Energy est le troisième album.
Un opus dont
Klas Lindquist assure la direction d’orchestre, les arrangements et la quasi
totalité des compositions dans une esthétique qui rappelle l’esprit des big bands
post bop dans la filiation Thad Jones-Mel Lewis Orchestra et Kenny
Clarke-Francy Boland Big Band. En outre, le titre Alternative Source of Energy ne nous trompe pas sur la
marchandise, car le nonet (qui sur certains titres augmente son effectif) envoie
avec générosité ses good vibes dès le
premier titre, «At Ease» qui donne aussi l’occasion d’apprécier l’attaque mordante
du leader à l’alto. Parmi ses partenaires, nous avions déjà repéré le solide trompettiste
Karl Olandersson (cf. nos comptes rendus
des éditions 2018 et 2019 du festival d’Ystad) lequel offre
un solo très swinguant sur «Bernadette», un titre qui bénéficie également d’un soutien
rythmique dynamique auquel Calle Rasmusson apporte ses couleurs latines.
L’ensemble, plein de variété, est de très bonne facture avec des compositions
dignes d’intérêt, des arrangements raffinés et bien sûr un collectif de musiciens
pleinement ancrés dans le langage du jazz. Les ballades sont particulièrement
bien écrites et Klas Lindquist s’y distingue, à l’alto sur «Nilsie» comme à la
clarinette sur «Swells». On aimerait évidemment pouvoir entendre en live ce répertoire et compter, pourquoi
pas, sur une initiative de l’Institut Suédois pour accueillir Klas Lindquist
dans son bel hôtel particulier du Marais.
Jérôme Partage
© Jazz Hot 2023
|
  Nirek Mokar Nirek Mokar
Back to Basics
Nini’s Special*, What I Drink, Twist à La Huchette, Hot
Bread, Shuffle Chelou, Maïra, Back to Basics, DD Rider, Swing and Limp, Besco
Boogie, Late Harvest
Nirek Mokar (p), Sax Gordon (ts), Claude Braud (ts), Stan
Noubard Pacha (g, tambourin*), Nicolas Dubouchet (b), Guillaume Nouaux (dm,
perc)
Enregistré les 15 et 16 mai 2023, Tilly (Yvelines)
Durée: 41’ 08’’
Ahead 843.2 (www.nirekmokar.com/Socadisc)
Nirek Mokar est ce qu’il est convenu d’appeler un jeune
prodige puisqu’il a enregistré son premier album autoproduit à 13 ans et
publie aujourd’hui le cinquième, Back to
Basics. Les talents précoces exercent toujours une fascination sur le public
et les médias, même si notre époque saturée par la musique de consommation
de masse est peu propice à leur émergence dans le monde du jazz, surtout hors
de sa terre natale, le phénomène persiste de façon éparse: on se rappelle l’altiste
italien Francesco Cafiso au début des années 2000 ou plus récemment le pianiste
indonésien Joey Alexander, tous deux adoubés par Wynton Marsalis. Nirek Mokar,
quant à lui, est né le 5 août 2002 et a grandi à Paris. Enfant, il fréquente le
Paris Boogie Speakeasy,
un club du XVIIIe arrondissement qui vécut de 2007 à 2016, où son père
travaille, et où il entend Allan Tate, Jean-Paul Amouroux, Jean-Pierre Bertrand ou encore Jean-Baptiste Franc qui lui donnent le goût du piano boogie woogie
auquel il s’initie d’abord en autodidacte. Il ne lui faudra qu’une poignée
d’années pour rejoindre ses aînés dans le circuit professionnel. Il est
aujourd’hui une des figures de proue du Caveau de La Huchette où il crée avec
ses partenaires une ambiance festive, entre boogie et rock & roll, qui fait
le bonheur des danseurs et du public de jeunes gens qui emplissent le club sans
discontinuer. Le patron de La Huchette,
Dany Doriz, lui témoigne d’ailleurs son admiration et ses encouragements dans
le livret. Parmi les compositions de
Nirek Mokar qui constituent l’album, l’une d’elles, un rock & roll écrit pour la danse, s’intitule d’ailleurs «Twist
à La Huchette». La fraîcheur et l’enthousiasme de sa musique sont
les principaux atouts du pianiste entouré ici de musiciens chevronnés avec lesquels
il partage un plaisir de jouer évident. L’aîné de la troupe, Claude Braud (73
ans), qui l’a pris sous son aile depuis dix ans, appartient à la catégorie des
«ténors velus», doté d’un son épais et tonitruant qu’on a pu entendre auprès
d’autres pianistes boogie comme Jean-Paul Amouroux et Jean-Pierre Bertrand,
mais aussi avec les orchestres Swingin’ Bayonne d’Arnaud Labastie, Megaswing de
Stéphane Roger ou pour des sax summits avec
Pierre-Louis Cas. Sensiblement sur le même registre, Gordon Beadle, dit Sax Gordon,
né à Détroit mais ayant étudié et débuté en Californie, a accompagné plusieurs
grands noms du blues, notamment à ses débuts Luther Guitar Junior Johnson avec
lequel il a tourné pendant cinq ans. Le dialogue entre les deux
ténors sur «Swing and Limp» souligne leur proximité. Guitariste marqué par
l’influence du Chicago blues (cf. son solo électrisant sur «Schuffle Chelou»), Stan Noubar Pacha se produit régulièrement avec Benoit Blue Boy (voc, hca), François
Fournet (g) ou Simon Boyer (dm). On l’a aussi rencontré un temps auprès de Paddy
Sherlock (tb, voc). A la batterie, on retrouve un maître du swing, Guillaume Nouaux (cf. chronique infra),
qui apporte ici un soutien robuste au pianiste –déjà doté d’une solide main
gauche– qui ne va pas sans petites subtilités rythmiques («What I Drink»). Enfin, Nicolas Dubouchet, spécialiste du slap, formé à la contrebasse par l'écoute des disques de rock & roll et de blues, ajoute encore du dynamisme au groupe. La technique spectaculaire de Nirek Mokar
le fait passer avec aisance du boogie («Nini’s Special», «Besco Boogie») au
blues («Back to Basics») ou du rock & roll («DD Rider» de Sax Gordon) au
jazz («Late Harvest»). Un enchevêtrement naturel des expressions qui démontre une nouvelle
fois que d’Albert Ammons à Louis Jordan, d’Earl Hines à Chuck Berry, il
n’existe qu’une seule grande musique de culture afro-américaine issue du blues
et du gospel, très loin des étiquettes fabriquées par les vendeurs qui segmentent et découpent l’histoire et la mémoire pour optimiser leurs petites affaires.
Jérôme Partage
© Jazz Hot 2023
|
  Miles Davis Quintet Miles Davis Quintet
In Concert at The Olympia Paris 1957
Solar, Four, What's New?, No Moe, Lady Bird*, Tune Up, I’ll
Remember April*, Bag's Groove*, 'Round Midnight, Now's The Time, Walkin', The
Theme
Miles Davis (tp, out*), Barney Wilen (ts), René Urtreger (p), Pierre
Michelot (b), Kenny Clarke (dm)
Enregistré live le 30 novembre 1957, l’Olympia, Paris
Durée: 1h 12’ 30’’
Fresh Sound Records 1135 (www.freshsoundrecords.com/Socadisc)
1957 est une année marquante dans le parcours de Miles
Davis. La lecture de Jazz Hot permet
de se rendre compte de la place prise alors par le trompettiste qui fait sa
première couverture de notre revue avec le n°117 de janvier 1957, distingué par les «Prix Jazz
Hot» de la meilleure formation et le prix du meilleur trompettiste pour les lecteurs comme
pour la rédaction. Il sera d’ailleurs de nouveau en couverture du numéro de
novembre (n°126), vraisemblablement dans la perspective de son concert
parisien du 30 qui est l’objet de cette nouvelle production Fresh Sound. Cette
année 1957 très riche comporte aussi son lot de difficultés: en mars, après
avoir renvoyé de son quintet John Coltrane et Philly Joe Jones en raison de
leur addiction à la drogue, Miles dissout sa formation; en mai, il enregistre,
sous la direction de Gil Evans, Miles
Ahead (Columbia), dont le succès marque le premier épisode de leur
collaboration et assoit le statut de vedette du leader. Début septembre, il
subit une opération à la gorge qui l’immobilise jusqu’à la fin du mois et forme
alors un nouveau quintet. C’est à ce moment que l’activiste du jazz,
organisateur de concert et contributeur de Jazz
Hot, Marcel Romano, débarque à New York pour planifier avec différents
musiciens des tournées européennes à venir, comme le raconte Jordi Pujol dans
le livret. Après avoir monté un mémorable «Birdland Show», passé par la Salle
Pleyel en novembre 1956 –comprenant Miles, Lester Young, Bud Powell et le
Modern Jazz Quartet (cf. Jazz Hot n°116, décembre 1956)–,
le producteur a notamment en tête de faire revenir le trompettiste en Europe et il
en annonce son intention dès Jazz Hot n°117 car le programme très
chargé de la tournée Birdland a laissé «de nombreux amateurs sur leur faim». C'est ainsi que Miles atterrit à Orly le 29 novembre, accueilli par Marcel Romano qui a monté
une tournée européenne de trois semaines. Le livret signale que le concert du
lendemain qui devait se tenir initialement à l’Alhambra a été déplacé quelques
jours avant à l’Olympia et se joue à guichets fermés, performance dont on
pensait alors seuls capables les orchestres swing de Louis Armstrong ou Lionel
Hampton (cf. Jazz Hot n°128). Là encore, la relecture des Jazz Hot de l’époque donne une idée de la
formidable vitalité jazz de la capitale, puisque le mois précédent, l’Alhambra
accueillait Harry James (avec Buddy Rich) et l’Olympia Jack Teagarden (avec
Earl Hines et Cozy Cole) ainsi que le Count Basie Orchestra (cf.
Jazz Hot n°127); et la même semaine que Miles, Erroll Garner (salué à la descente de l'avion par Boris Vian, cf. Jazz Hot n°128) est également au programme de l'Olympia. Pour accompagner Miles, Marcel Romano sollicite de
nouveau le trio de René Urtreger qui l’avait entouré l’année précédente à
Pleyel. Mais si Pierre Michelot tient toujours la contrebasse, Christian Garros
est remplacé par Kenny Clarke qui a notamment enregistré Bag’s Groove (1954, Prestige) avec le trompettiste, tandis qu’un
deuxième soufflant est ajouté avec le tout jeune Barney Wilen, pour une
version parisienne du quintet de Miles. Dès son arrivée, celui-ci rencontre ses
partenaires en scène pour une répétition.
L’enregistrement du concert, toujours à l’initiative de
Marcel Romano, n’a jamais été publié «officiellement» mais il a en partie
circulé (on en trouve des extraits sur YouTube).
Sa restitution intégrale proposée aujourd’hui par Fresh Sound a donc valeur
d’inédit, ce qui, concernant un musicien de la dimension de Miles, dont on
pense tout connaître, est une divine surprise. Précisons que sur trois titres le leader se met en retrait, laissant l'orchestre jouer sans lui et que sur «'Round
Midnight» la bande originale était endommagée et que sur près de 4 minutes, une autre
source de moindre qualité a été utilisée pour combler le manque. Ce travail
de restauration minutieux nous permet ainsi de profiter d’un Miles au sommet de
son art sur cette période encore bop, soutenu par des partenaires de premier
ordre. Jordi Pujol rapporte d’ailleurs le compte-rendu enthousiaste que Jazz Hot avait publié (n°128): «Ce concert
de Miles Davis fut l’un des plus beaux concerts de jazz qu’il nous ait été
donné d’entendre à Paris. Brillamment soutenu par Kenny Clarke, René Urtreger,
Pierre Michelot et Barney Willen, le grand trompettiste a donné en maints
passages le meilleur de lui-même». On peut qu’inciter les lecteurs actuels
de Jazz Hot à se précipiter sur ce
trésor: une heure et quart de beauté jazzique, avec un Miles Davis à la
sensibilité crépusculaire (magnifique «What’s New?»), un Barney Willen
débordant de swing («I’ll Remember April»), le beau toucher bop de René
Urtreger («Solar»), la sonorité boisée de Pierre Michelot (superbe solo sur
«Lady Bird») et le groove de Kenny Clarke (formidable introduction de «Now's
The Time»). Un morceau d’histoire restitué dans son intégrité qui a précédé,
avec la même formation, un autre livele 8 décembre à Amsterdam, celui-ci déjà connu depuis les années 1980, mais
aussi la célèbre session «improvisée» dans la nuit du 4 au 5 décembre pour la
musique du film de Louis Malle, Ascenseur
pour l’échafaud. Ajoutons que récemment l’INA a mis à disposition des
images filmées du quintet, tournées le 7 décembre par Jean-Christophe
Averty, qui seraient les plus anciennes de Miles jamais réalisées. Pour son intérêt historique comme la qualité
exceptionnelle de la musique jouée, ce Miles
Davis in Concert at The Olympia Paris 1957 est évidemment indispensable!
Jérôme Partage
© Jazz Hot 2023
|
 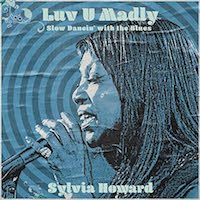 Sylvia Howard Sylvia Howard
Luv U Madly
Secret Love, Love You Madly, Sunny, Wouldn’t It Be Lovely,
But Beautiful, Slow Dancing With the Blues, L.O.V.E., When Did You Leave
Heaven, Beautiful Friendship, You’ve Changed, Someone to Watch Over Me
Sylvia Howard (voc), Pierre-Olivier Govin (as, ss, bar),
Olivier Hutman (p, kb), José Fallot (b), Etienne Brachet (dm)
Enregistré du 3 au 5 janvier 2023, Courcité (Mayenne)
Durée: 48’ 31’’
Sergent Major Company 344 (Plaza Major Company)
Sylvia Howard est un diamant brut, à la voix d’une
expressivité rare qui a émergée du plus profond de la culture afro-américaine
et dont le talent naturel a été poli et enrichi par les années et les
épreuves de la vie (cf. son interview dans Jazz Hot n°683). C’est ce qui fait la personnalité
musicale de Sylvia, pas diva pour un sou, simplement vraie, sortant ses tripes
sur chaque note. L’époque étant peu favorable aux personnalités indociles et à
l’âme nomade –comme Rasul Siddik qui l’avait aidée à son arrivée à Paris, au début
des années 2000– Sylvia Howard n’a pas eu les faveurs des grandes maisons de
disques et a peu enregistré: son précédent album, le superbe Time
Expired (Blue Marge), remontant à 2016… On se réjouit donc de
l’initiative de José Fallot, bassiste et programmateur de la saison Jazz au
Chesnay Rocquencourt (JACP), qui a proposé à la chanteuse
d’effectuer une session avec une approche «plus contemporaine» des standards et
des musiciens partageant cet état d’esprit. Aux saxophones, Pierre-Olivier
Govin est passé par le Big Band Lumières de Laurent Cugny, l’ONJ de François
Jeanneau puis celui d’Antoine Hervé, a cofondé le groupe Ultramarine avec Mario
Canonge mais a aussi accompagné LaVelle et Lucky Peterson. A la batterie, on
retrouve un autre partenaire régulier de José Fallot, Etienne Brachet dont le
parcours éclectique l’a mené entre jazz (Biréli Lagrène, Mike Stern, Ronnie
Lynn Patterson), blues-rock, gospel (Linda Hopkins) et musiques du monde.
Enfin, le quintet est complété au piano par le solide Olivier Hutman dont la
liste des collaborations atteste d’une carrière bien remplie: Christian
Escoudé, Barney Willen, Steve Williams, parmi beaucoup d’autres, jusqu’à Denise
King, amie et consœur de Sylvia.
La voilà donc en condition pour faire son miel de quelques
grands thèmes du jazz avec un orchestre qui swingue impeccablement («Love You
Madly») mais qui sait aussi être efficace sur les parties funky («Sunny») et
sur le blues où Sylvia Howard excelle («Slow Dancing With the Blues», un
régal). Mais c’est sur les ballades que la grande Sylvia donne le plus
d’intensité, comme «When Did You Leave Heaven», bien servi par la section
rythmique, tandis que pour les deux derniers titres, José Fallot fournit à la chanteuse
un accompagnement épuré à la contrebasse (très beau «You’ve
Changed») avant de la laisser conclure l’album a capella sur un magnifique «Someone to Watch Over Me» qui paraît émerger
du chœur gospel d’une église. Il serait temps que les responsables de majors et
de grands festivals se débouchent les oreilles et se rendent compte du trésor qu’ils
négligent. Mais on ne se fait guère d’illusion sur l’ordre de leurs priorités entre
la trinité marketing-mode-rentabilité et la diffusion au plus grand nombre d'un art profond.
Jérôme Partage
© Jazz Hot 2023
|
  Michel Pastre / Louis Mazetier / Guillaume Nouaux Michel Pastre / Louis Mazetier / Guillaume Nouaux
Fine Ideas
Georgianna, Black & Blue, Moonlight on the Ganges,
Potato Head Blues, I Guess l'II Have to Change My Plans, I Want to Be Happy,
Nuages, The Mule Walk, Lester's Be-Bop, Fine's Idea, Wild Man Blues, Jumpin'
Punkins, Tiny's Exercise, Mean to Me
Michel Pastre (ts), Louis Mazetier (p), Guillaume Nouaux
(dm)
Enregistré les 27 et 28 mars 2023, Meudon (Hauts-de-Seine)
Durée: 48’ 52’’
Une longue complicité unit Michel Pastre, Louis Mazetier et Guillaume Nouaux qui ont commencé à jouer ensemble, comme ils le rappellent
dans le livret, à partir de 2006 dans une formation entre quintet et sextet qui
comprenait également Jérôme Etcheberry. En trio avec le trompettiste, le ténor
et le pianiste avaient enregistré 7:33 to Bayonne (2015, Jazz aux
Remparts), tandis que sur le Charlie Christian Project de Michel
Pastre (2015, autoproduit) on retrouvait Guillaume Nouaux. C’est d’ailleurs
le batteur qui lui a suggéré d’adopter le trio sax-piano-batterie de
Gene Krupa qui a laissé plusieurs enregistrements entre 1952
et 1956 sous cette formule, le plus souvent avec Charlie Ventura (ts) et Teddy Napoleon (p), mais
également avec son frère cadet Marty Napoleon (p) ou Eddie Shu (tp, hca) en
remplacement du saxophone. Rappelons que cette période correspond à la
collaboration de Gene Krupa avec Norman Granz qu’on retrouve derrière les
albums At Jazz at the Philharmonic (1952, Mercury) et The Gene Krupa Trio
Collates (1952, Mercury).
Sur ce second LP figure d’ailleurs le titre «Fine’s Idea» (Gene
Krupa) repris par le trio Pastre-Mazetier-Nouaux dans un esprit proche de
l’original si ce n’est que le jeu de Michel Pastre est plus suave que celui de
Charlie Ventura. Pour autant, le propos de cet album n’est pas de rendre
spécialement hommage à Gene Krupa et à son trio mais, de façon plus large, aux
«maîtres» qui ont fait l’histoire du jazz. Parmi les standards et les compositions
du jazz proposés, on peut d’emblée signaler la reprise particulièrement réussie
de «Nuages» avec une introduction chaloupée piano-batterie qui
tisse un canevas autour des harmonies du morceau avant que le ténor ne vienne
exposer le thème. Superbe! Michel Pastre est au sommet de son art sur les
ballades, déroulant avec une puissance maîtrisée sa belle sonorité ronde et
charnue («Black & Blue», «Mean to Me»…). Quant à la rythmique, elle
maintient une dynamique swing constante entre, d'une part, l’as du stride, Louis Mazetier
(«The Mule Walk» de James P. Johnson) également à son affaire sur le middle jazz
(«I Guess l'II Have to Change My Plans») et le blues «Wild
Man Blues», d'autre part le spectaculaire Guillaume Nouaux qui prend quelques solos
décoiffants («Moonlight on the Ganges», «Jumpin' Punkins») se plaçant dans une
filiation qui relie Gene Krupa, Buddy Rich, Butch Miles et Duffy Jackson.
Encore un joli coup de Camille
Productions!
Jérôme Partage
© Jazz Hot 2023
|
  François Laudet Big Band François Laudet Big Band
Basie-Nestico Project
The Heat’s On, Fun Time, The Queen Bee, Basie Straight
Ahead, Tall Cotton, All My Life, Freckle Face, Ya Gotta Try, Switch in Time,
That Warm Feeling, Hay Burner, Magic Flea
François Laudet (dm, lead), Michel Feugère, Guy Bodet, Jean
Gobinet, François Biensan (tp), Guy Figlionlos, Patrick Bacqueville,
Jean-Claude Onesta (tb), Pascal Koscher (btb), Nicolas Montier, Marc Richard
(as), Thomas Savy, Pascal Gaubert (ts), Claudio De Queiroz (bar, fl), Nicolas
Peslier (g), Carine Bonnefoy (p), Pierre Maingourd (b)
Enregistré live les 28 et 29 avril 2004, Jazz Club du
Méridien Etoile, Paris
Durée: 1h 03’ 26’’
Ahead 844.2 (Socadisc)
François Laudet aime les big bands et doit en partie sa
vocation de batteur à Sonny Payne qui tenait les baguettes chez Basie quand il
eut l’émerveillement d’assister à un
concert du mythique orchestre en 1973 ( cf. ses interviews dans Jazz Hot n°509 et n°573).
Et c’est au début des années 1990 que François Laudet réalisa son rêve de
monter son propre big band avec un premier album consacré au répertoire de
Buddy Rich: My Drummer Is Rich (1993,
Big Blue). On peut également signaler qu’il remplaça en 1997, le temps d’une
tournée européenne, Butch Miles au sein du Count Basie Orchestra –sous la
direction de Groover Mitchell– avec un invité de marque qui n’était autre que
Benny Carter... Quant au présent enregistrement, il a près de vingt ans
puisqu’il fut capté au club de l’Hôtel Méridien (anciennement Jazz Club Lionel
Hampton) en avril 2004, au cours de deux soirées comprises dans un «festival
big band» mitonné, pour le centenaire du Count,
par Jean-Pierre Vignola qui édite aujourd’hui ce live inédit sur son label. C’est l’occasion de se rappeler qu’à
cette époque le grand hôtel de la Porte Maillot ouvrait régulièrement sa scène
aux big bands –dont celui de Claude Bolling qui y passait chaque mois– et
proposait également une excellente programmation blues. Mais ça, c’était avant…
Cet enregistrement du big band de François Laudet sous
l’égide de Basie met en lumière un de ses collaborateurs de renom, Sammy
Nestico (1924-2021) qui écrivit des thèmes et des arrangements pour le
Count de 1968 à 1983 ( cf. discographie
détaillée de Count Basie sur cette période dans Jazz Hot Spécial 2003). La disparition de Sammy Nestico en
janvier 2021 a sans doute participé à la décision de François Laudet de sortir
ces bandes des cartons. Le leader lui rend par ailleurs hommage dans le livret. L’intégralité du répertoire joué ici, composé et
orchestré de la main Sammy Nestico, provient donc directement de sa fructueuse association avec
le pianiste de Kansas City. «Basie Straight Ahead», extrait de l’album du même
nom (Dot Records, 1968) –que Laudet signale dans le livret comme une référence–,
en marque les débuts. Ce morceau met en évidence le soutien très dynamique de
la section rythmique –on en n'attendait pas moins– avec une Carine Bonnefoy qui
imprime le swing sur chaque note, un Pierre Maingourd aux robustes lignes de
basse et un François Laudet dont le drive tire tout l’orchestre. Six autres thèmes sont issus du
même album: «Fun Time», «The Queen Bee» (superbe solo du toujours profond
Patrick Bacqueville), le très swinguant «Switch in Time», «That Warm Feeling» (belle
introduction puis solo de Nicolas Peslier), «Hay Burner» et «Magic Flea» où
François Laudet nous régale de son drumming vrombissant, Thomas Savy et Nicolas
Montier de leurs solos véloces et nerveux. De l’album Basie Big Band (1975, Pablo), on retrouve: «The
Heat’s On» (autre titre mené à un train d’enfer par François Laudet), «Tall
Cotton», «Freckle Face» (intervention tout en subtilité de François Biensan); de
l’album Prime Time (1977, Pablo): «Ya
Gotta Try» avec toujours le drive très
énergique du batteur. Enfin, «All My Life» (à ne pas confondre avec le
standard de 1936 de Sidney D. Mitchell et
Sam H. Stept, même s’il en reprend les trois premières notes), n’a jamais été
enregistré –à notre connaissance– par le Count Basie Orchestra mais
certainement joué en concert puisque la partition publiée vers 1971 l’indique.
A ce titre, le big band de François Laudet nous propose ici une forme de
reconstitution en live, dans l’esprit
Nestico-Basie, de ce thème qui fut d’ailleurs enregistré par d’autres big
bands.
Jérôme Partage
© Jazz Hot 2023
|
  Nicolas Montier Nicolas Montier
Jazz Circus
Mad Madec Blues, Huuuu, She Winked at You, Paris sous la
neige, Panama Waltz, Knock Knock Knock, Eclipse, Piece of Chance, Melancholy
Dandy, Claude & Nathalie, J’ai deux amours*, Le Cirque de Caracas°
Nicolas Montier (as, ss), Patrick Bacqueville (tb), Shona
Taylor, Michel Bonnet (tp), Marc Bresdin (as, cl), Matthieu Vernhes (ts, cl),
Christophe Davot (g, sifflet, voc*), Jacques Schneck (p), Pierre Maingourd (b),
Vincent Frade (dm) + Françoise Codol (récitante)°
Enregistré live le 27 octobre 2022, Petit Journal St-Michel,
Paris
Durée: 53’ 02’’
Ahead 845.2 (Socadisc)
Proposer un disque de middle
jazz avec un répertoire exclusivement original, ou presque, peut passer
pour un pari audacieux face aux montagnes de chefs-d’œuvre laissées par Duke
Ellington, George Gershwin ou Cole Porter. Il est vrai qu’en matière de
composition il est salutaire que les musiciens conservent un premier réflexe
d’humilité. Pour autant, s’interdire d’offrir au public des œuvres
personnelles constitue l’excès inverse de ceux qui ne jurent que par la composition dite créative, d’autant qu’elle-seule est subventionnée, quelque soit son intérêt! En revanche lorsque la composition s’ancre dans la mémoire collective pour l’enrichir, on est bien dans l’esprit du jazz, un collectif où chacun puise et apporte davantage que par un ersatz parfois mécaniste, parfois à contre-sens, donc sans esprit-jazz. C’est bien ici ce qu’a réussi Nicolas Montier avec son collectif: de vraies mélodies écrites par Patrick Bacqueville et Michel Bonnet et lui-même, des arrangements soignés, une belle mise en place d’ensemble avec ses échappées de chorus.
Ce Jazz Circus tient en effet ses promesses de festivité d’autant que la chaleur du live –au Petit Journal, où nous avions
découvert ce projet quelques mois avant l’enregistrement– conforte ce sentiment
de générosité et de partage qu’inspire la musique de Nicolas Montier. Disons-le
d’emblée, à nos oreilles le meilleur thème est «Paris sous la neige» (Montier),
une superbe ballade, très blues, que chaque soliste enrichit de son
intervention, Montier et Bacqueville en tête, pleins de profondeur. De la
graine de standard! Blues again: «Mad
Madec Blues» (Montier) est introduit par un Jacques Schneck toujours subtil,
rejoint par le reste de l’orchestre qui fait affluer l’énergie. Dans le
registre swing, le tempo rapide de «She Winked at You» (Montier) entraîne les
musiciens à un degré d’intensité supérieur. Le titre «Claude & Nathalie»
(Montier) se situe dans le même esprit, tenu par le drive solide de Vincent Frade. On se laisse également porter avec
plaisir par les couleurs latines de «Panama Waltz» (Bonnet-Montier) tandis que
sur son «Piece of Chance», Patrick Bacqueville est au sommet de sa forme! La
thématique du cirque est directement évoquée avec le titre final, «Le Cirque de
Caracas» (Michel Bonnet) où la musique est mêlée à un récit raconté par la
comédienne Françoise Codol. Seule reprise de l’album (d’ailleurs légèrement
en-dessous des plages précédentes), «J’ai deux amours» est chantée par
Christophe Davot sur des paroles quelque peu modifiées. Avec sa troupe de saltimbanques chevronnés, Nicolas Montier nous fait redécouvrir le lien entre les arts populaires du cirque et le jazz, quand les roulottes allaient à la rencontre d'un public pas encore colonisés par les écrans et les réseaux a-sociaux.
Jérôme Partage
© Jazz Hot 2023
|
  Esaie Cid Esaie Cid
La Suite audonienne
Cressé Mambo, La Bibliothèque du Marquis, L’Abbé
Machiavelli, Boigues le dépeceur, Chevauchée Fantôme à rue Dhalenne,
...Et comme fait une coquette..., Rue Charles Garnier, Le Bain de Dadon, René
(Je te rembourse mardi)
Esaie Cid (as, cl), Benjamin Dousteyssier (bar, ss), Alex
Gilson (b), Paul Morvan (dm)
Enregistré en juin 2022, Draveil (Essonne)
Durée: 38’ 45’’
Swing Alley 046 (www.freshsoundrecords.com/Socadisc)
Après avoir exploré une part méconnue du patrimoine jazz sur
les deux volumes de son Kay Swift Songbook, Esaie Cid nous
revient avec une œuvre originale et très personnelle consacrée à la ville de
Saint-Ouen-sur-Seine où il s’est établi il y a plusieurs années. Cette Suite audonienne (épithète relatif à
cette commune) esquisse, avec l’humour, la fantaisie et la culture savante
qu’on connaît à cet amoureux de Balzac, un tableau historique, à travers
l’évocation de personnages et de lieux (souvent disparus) emblématiques
–également décrits dans le livret–, de cette ville populaire située au nord du
périphérique parisien. Pour cet album, l’altiste s’est adjoint le baryton
Benjamin Dousteyssier qui à l’époque où se montait le projet habitait lui aussi
Saint-Ouen; formé au Conservatoire de Toulouse et au CNSM de Paris, il est impliqué
dans différentes formations comme le Ulmaut Big Band avec Pierre-Antoine
Badaroux, Post K et Paris Swing Collectif consacrés au jazz mainstream. Quant à
la rythmique, elle est aux mains de la paire Alex Gilson-Paul Morvan qu’on a
récemment entendue sur son Danger Zone. C’est donc à la tête d’un quartet pianoless qu’Esaie Cid déroule cette Suite qui s’ouvre sur le chaloupé
«Cressé Mambo» inspiré de «La Marche de la cérémonie des Turcs» que Lully
écrivit pour Le Bourgeois gentilhomme de
Molière. C’est d’ailleurs au grand-père maternel du dramaturge, Louis Cressé
–qui possédait une maison à Saint-Ouen–, qu’est dédié ce thème. Swinguante ballade emmenée par la clarinette et le soprano, soutenu par les lignes de
basse d’Alex Gilson, «La Bibliothèque du Marquis» fait référence au Marquis de
Sade qui trouva quelques temps refuge à Saint-Ouen. Il reste de ce séjour un
procès verbal de 1797 qui détaille les biens du marquis et décrit sa
bibliothèque… Toujours bien rythmé, «L’Abbé Machiavelli» est consacré au
fondateur de la nouvelle église de Saint-Ouen à la toute fin du XIXe siècle,
époque à laquelle la commune avait multiplié par dix le nombre de ses habitants
sous l’effet de l’industrialisation, et l’Eglise souhaitait regagner du terrain
dans ce foyer ouvrier où circulaient les idées révolutionnaires. Sur un tempo
rapide, comme le galop d’un cheval, «Chevauchée Fantôme à rue Dhalenne»
rappelle, avec une pointe d’onirisme, l’existence d’un hippodrome abandonné en
1917. Le titre «...Et comme fait une coquette...» est quant à lui tiré d’un
vers du poème Promenade à l’Ile
Saint-Ouen-Saint-Denis d’Auguste de Châtillon (1808-1881) ainsi joliment mis
en musique sous la forme d’une élégante ballade. Autre bon thème, au dynamisme
bop, qui conclut cette œuvre, «René (Je te rembourse mardi)» retrace le
souvenir d’une figure contemporaine du quartier Garibaldi, René, qui y faisait
la manche et disait invariablement à ceux qui lui donnaient une pièce: «Je te
rembourse mardi». Un morceau plus en phase avec la réalité populaire de
Saint-Ouen alors que son ancrage jazz, avec ces célèbres Puces, haut-lieu de la
tradition Django, n’est étonnamment pas évoqué dans cette Suite plus encline à raviver la mémoire du charmant village des
XVIIe et XVIIIe siècles. Esaie Cid ayant proposé en mars dernier au Sunset, lors
de la présentation du disque, quelques inédits, un second volet de cette Suite offrira peut-être un autre
éclairage sur l’histoire de Saint-Ouen.
Jérôme Partage
© Jazz Hot 2023
|
  Janczarski & Siddik 4tet Janczarski & Siddik 4tet
Contemplation
Contemplation, Sweet Love of Mine, Self-Portrait in Three
Colors, Witchi Tai To*, Complete Communion, Dedication, Caribbean Fire Dance
Rasul Siddik (tp, fl, voc*), Borys Janczarski (ts), Michal
Jaros (b), Kazimierz Jonkisz (dm)
Enregistré live le 24 janvier 2020, 12 on 14 Jazz Club,
Varsovie (Pologne)
Durée: 57’ 40’’
Ce live, capté juste
avant le covid, est le dernier enregistrement connu laissé par le regretté
Rasul Siddik dont vous pouvez lire l’hommage de Jazz Hot. Il prend
place au 12 on 14 Jazz Club, l’un des derniers sanctuaires du jazz à Varsovie,
depuis emporté par la frénésie d’enfermements qui a frappé une partie de la
planète entre 2020 et 2021. On doit ce témoignage musical au label For Tune qui
développe depuis dix ans un catalogue éclectique avec une thématique jazz entre
post-bop, free et musiques improvisées au sein de laquelle on trouve quelques jazzmen
américains comme Charles Gayle ou Ed Cherry venus à la rencontre de leurs
homologues polonais. Ce Contemplation vient ainsi après Liberator (For Tune, 2016), dans
lequel le ténor Borys Janczarski accueillait Steve McCraven en coleader et déjà Rasul Siddik en sideman. Ce bon
saxophoniste, émule de Joe Henderson, est né à Varsovie le 23 mars 1974 et a
effectué des études de droit en France tout en y travaillant l’instrument avec
Jean-François Bonnel, Olivier Temime, Eric Barret et Lionel Belmondo. De retour
en Pologne, Borys Janczarski a eu pour professeur le trompettiste Piotr Wojtasik
(1964), puis à partir de 2002, il a monté ses propres formations,
notamment avec le batteur Kazimierz Jonkisz (1948), une institution du jazz
polonais, qu’on retrouve sur ce disque.
Ce dernier a été primé à 18 ans au festival Jazz nad Ordra
de 1967 –mis en œuvre depuis 1964 à
Wroclaw par l’Association des étudiants polonais (son organisation s’est
professionnalisée à partir de 1989)–, un des nombreux événements qui atteste
de la vitalité du jazz dans la Pologne communiste (cf. Le jazz à l’Est au temps du
Communisme). Kazimierz Jonkisz a accompagné les principaux jazzmen
polonais –Tomasz Stanko (tp), Michał Urbaniak (vln), Adam Makowicz (p)– et a
commencé à se produire avec son propre quintet en 1980 (Jazz Jamboree Festival,
Varsovie). Il a aussi partagé la scène avec des musiciens de renommée
internationale comme Al Cohn, Eddie Henderson, Amina Claudine Myers, Kevin
Mahogany ou encore Roy Hargrove. A la contrebasse, Michal Jaros appartient à la
même génération que le leader (il est né en 1976). Il a suivi un cursus classique et jazz (Académie de musique de Katowice) et a eu
l’occasion depuis les années 2000 d’apparaître en sideman dans de nombreuses formations
polonaises.
Ces trois solides partenaires offrent un bel espace d’expression
à Rasul Siddik sur des compositions du jazz correspondant bien à l’univers
musical du trompettiste qui signe également un original, «Dedication». Le duo
ténor-trompette porte une complainte profonde («Contemplation» de McCoy Tyner)
dont l’intensité atteint un sommet sur la prise de parole de Rasul qui résonne
comme un cri étranglé. Celui-ci sait aussi se servir de sa voix pour susciter
encore l’émotion sur le superbe «Witchi Tai To» de Jim Pepper, une incantation
entre douceur et âpreté, à l’image de sa personnalité musicale. L’énergie et le
swing sont également présents avec un Rasul à la trompette bouchée sur
«Complete Communion» (Don Cherry) et un Borys Janczarski tout en rondeur,
soutenus par la frappe sèche de Kazimierz Jonkisz. Tandis que Michal Jaros
offre un solo plein de relief sur «Self-Portrait in Three Colors» de Charles
Mingus.
Cet ultime enregistrement de Rasul Siddik met en
valeur la palette expressive du trompettiste, tantôt volcanique, tantôt
méditatif et toujours ancré dans le blues. Peut-être qu’il participera à
réévaluer aux yeux et aux oreilles du public et des «critiques» la place
qu’occupe dans la scène post-coltranienne ce musicien qui avait tracé son
chemin artistique et de vie dans une certaine marginalité
.
Jérôme Partage
© Jazz Hot 2023
|
  Champian & Stephen Fulton Champian & Stephen Fulton
Live From Lockdown
I Hadn’t Anyone Till You, You’ve Changed, Satin Doll, Blow Top Blues, Moonglow, What Is This Thing Called Love, What Will I Tell My Heart, Look for the Silver Lining, I Had the Craziest Dream, Pass the Hat, I’m Forever Blowing Bubbles, Midnight Stroll, A Message From Champian and Stephen (message parlé)
Champian Fulton (p, voc) Stephen Fulton (flh, tp)
Enregistré le 13 novembre 2020, New York, NY
Durée: 1h 02’ 58’’
Champian Records 004 (www.champian.net)
  Champian Fulton Champian Fulton
Meet Me at Birdland
Welcome to Birdland (annonce), Too Marvelous for Words, Every Now and Then, Evenin', Theme for Basie, Happy Camper, Just Friends, I Didn't Mean a Word I Said, I've Got a Crush on You, I Don't Care, Spring Can Really Hang You Up the Most, I Only Have Eyes for You, It's Been a Long Long Time
Champian Fulton (p, voc), Hide Tanaka (b), Fukushi Tainaka (dm)
Enregistré live du 2 au 4 septembre 2022, Birdland Jazz Club, New York, NY
Durée: 1h 09’ 04’’
Champian Records 005 (www.champian.net)
Pendant la longue éclipse démocratique et artistique de 2020 et 2021, plusieurs musiciens de jazz ont maintenu le contact avec le public via des livestreams sur les réseaux sociaux. On a bien sûr en tête les initiatives d’Emmet Cohen et Rossano Sportiello qui durant des mois ont réagi à la politique d’enfermement planétaire en organisant des concerts chez eux avec leurs amis musiciens, concerts tous excellents et toujours disponibles sur leurs chaînes YouTube respectives, lesquelles continuent d’être alimentées malgré le retour à la «normale». Durant le covid, Champian Fulton a elle aussi développé une activité online, avec des Live From Lockdown diffusés sur Facebook le dimanche soir (l’historique des vidéos n’étant disponible que pour ceux qui possèdent un compte sur la plateforme), où elle apparaît soit en piano solo, soit en compagnie de ses partenaires habituels Nick Hempton (ts), Hide Tanaka et Fukushi Tainaka ou de son père Stephen Fulton.
Et c’est avec ce dernier que Champian a souhaité graver en novembre 2020 un album témoignant de l’esprit de ces sessions faites-maison –se nommant également Live From Lockdown –mais avec les moyens techniques d’un studio d’enregistrement. Le duo père-fille, complice et intimiste, fonctionne à merveille, en particulier sur les parties purement instrumentales où l’on profite pleinement de la sonorité veloutée de Stephen –trompettiste-bugliste d’une grande sensibilité (à fleur de peau sur «What Is This Thing Called Love»)– et des accents garnériens de Champian (superbe «Moonglow»). Toujours bonne vocaliste, elle est pleine de gouaille sur «Blow Top Blues» offrant ainsi différentes atmosphères selon les thèmes, même si ce sont les ballades qui dominent (magnifique «You’ve Change ») avec une nuance de mélancolie sans doute due à la «situation».
Le disque suivant, Meet Me at Birdland, enregistré en septembre 2022 dans le mythique club enfin rendu à la vie, offre un saisissant contraste et proclame le besoin de l’artiste de renouer physiquement avec le public. En trio avec ses fidèles Hide Tanaka et Fukushi Tainaka, la pianiste-chanteuse enchaîne les standards (qui viennent selon l’inspiration) avec naturel et là encore en totale complicité avec ses partenaires. Soit une Champian Fulton telle qu’on l’apprécie, s’épanouissant dans la chaleur du live et au son des applaudissements. Le swing est présent de bout en bout, les thèmes choisis avec goût («Theme for Basie» de Phineas Newborn, «It's Been a Long, Long Time», «I Don't Care» de Ray Bryant…) et l’original de la chanteuse, «Happy Camper» aux couleurs latines, n’est pas non plus pour déplaire.
Voilà encore deux bons disques à mettre à l’actif de Champian Fulton, musicienne d’une remarquable constance..
Jérôme Partage
© Jazz Hot 2023
|
  Dave Stryker Dave Stryker
Baker's Circle
Tough, El Camino*, Dreamsong, Everything I Love, Rush Hour, Superstar, Baker's Circle*, Inner City Blues*, Love Dance, Trouble (No. 2)
Dave Stryker (g), Walter Smith III (ts), Jared Gold (org) McClenty Hunter (dm), Mayra Casales (perc)*
Enregistré le 11 janvier 2019, Paramus, NJ
Durée: 57’ 17’’
  The Dave Stryker Trio The Dave Stryker Trio
Prime
Prime, Lockdown, Captain Jack, Hope, As We Were, Mac, I Should Care, Deep, Dude's Lounge
Dave Stryker (g), Jared Gold (org) McClenty Hunter (dm)
Enregistré le 23 octobre 2020, Paramus, NJ
Durée: 57’ 52’’
  Dave Stryker Dave Stryker
As We Are
Overture, Lanes, River Man, Hope, Saudade, One Thing at a Time, As We Were, Dreams Are Real, Soul Friend
Dave Stryker (g), Julian Shore (p), John Patitucci (b), Brian Blade (dm) + String Quartet:
Sara Caswell, Monica K.Davis (vln), Benni von Gutzeit (avln), Marika Hughes (cello)
Enregistré les 2, 10 et 11 janvier 2021, Paramus, NJ
Durée: 55’ 52’’
Chaque année ou presque depuis
1988, le prolifique Dave
Stryker sort un album sous son nom et a donc atteint avec Prime (enregistré en 2020 mais publié après As
We Are gravé en 2021) son 35e opus en leader. Une discographie
consistante et de qualité qui a fait l’objet de chroniques dans Jazz Hot, dont les plus récentes sont accessibles
en ligne. Ainsi, Baker’s Circleet Prime, deux albums très proches
dans l’esprit, reposent majoritairement sur les compositions du guitariste et
s’inscrivent dans la droite lignée des productions précédentes. L’ancien
accompagnateur de Stanley Turrentine et de Jack McDuff s’y distingue par son
jeu ciselé mais ancré dans le blues, le tout baigné dans un
groove permanent assuré par les fidèles Jared Gold et McClenty Hunter. Le
premier, que nous avons aussi croisé auprès de Kevin Mahogany et de Joris
Dudli, est un organiste solide, à l’aise dans des contextes variés mais
toujours enraciné dans le jazz. On peut rappeler son excellent disque en
leader, Reemergence (2018), produit par et avec le concours de Dave
Stryker, tout comme celui du subtil McClenty Hunter, The Groove Hunter (2015-2018), un autre très bon album à l’image de ce batteur lui aussi ancré
dans le swing.
Sur Baker’s Circle,
on retrouve une autre habituée des enregistrements de Dave Stryker, la
percussionniste cubaine Mayra Casales, également entendue dans le sillage de Carmen
Lundy, et qui apporte une touche latine sur trois titres, en
particulier le très chaloupé «El Camino» (Dave Stryker). Nouveau venu
dans la galaxie Stryker, le bon ténor Walter Smith III, dont les
expérimentations le mènent régulièrement aux confins entre le jazz et les
musiques improvisées européennes, participe pleinement ici à l’énergie post-bop
du disque, avec ses colorations blues et soul. Son jeu nerveux et véloce donne
une densité supplémentaire à la musique («Rush Hour» de Jared Gold), avec plus
de rondeur sur les ballades («Everything I Love» de Cole Porter). Le
morceau-titre de l’album, «Baker’s Circle» (avec un solo de Jared Gold),
évoque David Baker (1931-2016), chef d’orchestre et pédagogue qui fut l’un des
mentors de Dave Stryker avant de l’embaucher comme professeur de guitare à
l’Université d’Indiana des années après leur première rencontre. Ce feu
d’artifice, ponctué de pépites groovy («Inner City Blues» de Marvin Gaye et
James Nyx Jr.), se conclut avec le
swinguant «Trouble No2» (Harold Morgan et Lloyd Price), un thème en référence à
Stanley Turrentine et son album Hustlin’(1964, Blue Note).
Dans la même veine, Primea été gravé en octobre 2020, en pleine crise du covid à l’occasion d’un concertstreamlive en studio. Dave Stryker en
a profité pour concevoir un nouvel album à partir d’un répertoire presque entièrement
écrit de sa main et pour la première fois simplement en trio avec ses complices
Jared Gold et McClenty Hunter, en compagnie desquels il n’avait plus joué
depuis huit mois. Enregistré en une seule prise, le disque attaque très fort
dès le premier morceau éponyme, «Prime» (époustouflant McClenty Hunter!) dédié
à Jack McDuff comme «Captain Jack» et «Dude’s Lounge»,
superbement introduit par Dave Stryker avec une grande finesse et toujours le
blues! Autre bon thème, «Lockdown» fait bien sûr référence à l’enfermement des
populations. Le trio y est plus tempéré. Signalons enfin une jolie ballade
méditative, «As We Were», avec une introduction très churchy de Jared Gold,
titre qui sera repris sur le disque suivant.
As We Are se distingue nettement des
deux enregistrements précédents et du reste de la discographie de Dave Stryker
par l’emploi d’un quatuor à cordes. Le guitariste est ici en quartet avec le
jeune pianiste Julian Shore (né en 1987), auteur de tous les arrangements, et
des solides John Patitucci et Brian Blade, pour un album hybride, entre
expression jazz-blues et musique improvisée, contraste particulièrement
saisissant sur le titre «River Man» (Nick Drake) qui s’ouvre sur un âpre solo
de violon (Sara Caswell), sobrement soutenu par la contrebasse, où la guitare
finit par trouver un espace entre deux nappes de cordes. Un projet surprenant
mais auquel Dave Stryker rêvait depuis longtemps à en croire le livret. On espère
que le guitariste s’est fait plaisir et qu’il a refermé cette parenthèse. En
tous cas, avec sa prochaine sortie, prévue pour 2024, annonçant la retour Jared Gold
et McClenty Hunter, et le renfort de Bob Mintzer, nous devrions retrouver
très prochainement un Dave Stryker revenu à ses fondamentaux.
Jérôme Partage
© Jazz Hot 2023
|
  Bill Henderson Bill Henderson
Señor Blues: Complete Recordings 1958-1961
CD1: Busy Signal, How Long Has This Been Going On, Señor
Blues, Ain't That Love, Angel Eyes, Ain't no Use, Willow Weep for Me, Free
Spirits, Free Spirits (alt. take), Joey Joey Joey, Bye Bye Blackbird, Sweet
Pumpkin, Sweet Pumpkin (alt. take), It Never Entered My Mind, Love Locked Out,
My Funny Valentine, Moanin', Moanin' (alt. take), This Little Girl of Mine, Bad
Luck, The Song Is You, You Make Me Feel so Young, Without You
CD2: Sleepy, I Go for That, Sleepy, Never Kiss and Run,
Sleepin' Bee, Don't Like Goodbyes, Old Country, Slowly, Opportunity, Never Will
I Marry, My How the Time Goes By, Hooray for Love, Skylark, Royal Garden Blues,
Twelfth of Never, Love Is a Bug, Bewitched, The More I See You, I Can't Give
You Anything But Love, Accentuate the Positive, Yes Indeed, Please Send Me
Someone to Love, Sweet Georgia Brown, Am I Blue?
Billy Henderson (voc) avec:
• Charlie Rouse (ts) Quintet (avec Julius Watkins, flh, Hank
Jones, p, Wilbur Ware, b, Philly Joe Jones, dm)
• Horace Silver (p) Quintet (avec Donald Byrd, tp, Junior
Cook, ts, Gene Taylor, b, Louis Hayes, dm)
• Jimmy Smith (org) Trio (avec Ray Crawford, g, Donald
Bailey, dm)
• Ramsey Lewis (p) Trio (avec Eldee Young, b, Isaac Holt,
dm)
• Benny Golson (lead) Jazz Octet (avec Booker Little, tp,
Bernard McKinney, tb, euph, Yusef Lateef, ts, Wynton Kelly, p, Paul Chambers,
b, Jimmy Cobb, dm)• Bobby Bryant (tp) Octet (avec Benny Powell, tb, Billy
Mitchell, ts, Frank Wess, ts, Charlie Fowlkes, bar, Gildo Mahones, p, Bob
Cranshaw, b, Al Duncan, dm)
• MJT +3 (avec Willie Thomas, tp, Frank Strozier, as, Harold
Mabern, p, Bob Cranshaw, b, Walter Perkins, dm)
• Jimmy Jones (lead) Orchestra (détail non communiqué)
• Richard Evans (lead) Orchestra (détail non communiqué)
• Thad Jones (lead) Orchestra (avec Nat Adderley, Clark
Terry, Snooky Young, tp, Jimmy Cleveland, Benny Powell, Bill Hughes, tb,
Marshal Royal, as, Billy Mitchell, Frank Foster, Frank Wess, ts, Charlie
Fowlkes, bar, Tommy Flanagan ,p, Freddie Greene, g, Milt Hinton, b, Elvin
Jones, dm)
• Tommy Flanagan (p) Quartet (avec Freddie Green, g, Milt
Hilton, b, Elvin Jones, dm)
• Riley Hampton (lead) Orchestra (avec Paul Serrano, Sonny
Turner, tp, John Avent, tb, Edde Harris, Cliff Davis, ts, McKinley Easton, bar,
Eddie Higgins, p, Joe Diorio,g, Rail Wilson, b, Al Duncan, dm)
• Eddie Higgins (p) Trio (avec Richard Evans, b, Marshall
Thompson, dm)
Enregistré entre
avril 1958 et le 25 avril 1961, New York, NY, Hackensack, NJ, Chicago, IL
Durée: 1h 18’ 33’’ + 1h 18’ 27’’
Fresh Sound Records 1127 (www.freshsoundrecords.com/Socadisc)
Le chanteur Bill Henderson (19 mars 1926, Chicago, IL–3
avril 2016, Los Angeles, CA) compte parmi ces protagonistes du jazz dont le
temps a estompé la trace, tout du moins en Europe. Dans sa démarche de réactivation de la mémoire, Fresh Sound lui consacre cette anthologie correspondant au début de sa
carrière discographique, une réédition au livret bien
documenté signé Jordi Pujol. William Randall
Henderson débute sur scène dès l’âge de 4 ans, le temps d'un show avec l’accordéoniste Phil Baker. Sa mère ne souhaitant pas qu'il poursuive l'expérience, il reprend une
scolarité classique, mais toujours attiré par le spectacle, il participe au lycée à des pièces de théâtre
et des comédies musicales en amateur, avant de poursuivre sa formation dans une
école de musique. A l'issue, Bill Henderson intègre l’armée –probablement à la fin de la Seconde guerre mondiale– qui le
fait tourner comme «entertainer» à
travers les Etats-Unis et en Europe. Démobilisé en 1952 et de retour à Chicago,
il entame une carrière de chanteur de jazz, ce qui n’est pas sans difficultés à
cette époque où la musique de consommation de masse (le rock & roll) inonde les radios pour mettre à bas le jazz et les musiques populaires (chanson, tango, etc.). Bill Henderson partage ces débuts modestes avec Ramsey
Lewis en compagnie duquel il travaille la journée chez un disquaire et
joue le soir au Sutherland Lounge.
Sa rencontre avec Billy Taylor en 1955, qui
l’entend dans un club de Windy City, marque un tournant. Le pianiste lui
conseille en effet d’aller à New York et de l’appeler une fois sur place, ce
que Bill Henderson fera deux ans plus tard. Comme promis, et donnant beaucoup
de son temps, Billy Taylor, avant tout militant du jazz conscient de son devoir de solidarité, l’aide à prendre des contacts, notamment auprès des
maisons de disques. En attendant que ces démarches aboutissent, il faut vivre
et Bill Henderson reprend des petits boulots, comme celui de ramoneur dans les
beaux quartiers: le livret nous rapporte que se retrouvant dans la maison de la
mère de Duke Ellington, le chanteur donne de la voix tout en effectuant sa tâche,
espérant être remarqué par le chef d’orchestre qui malheureusement ne fit pas
de visite à sa mère ce jour-là…
En avril 1958, le vent tourne enfin: le producteur Orrin
Keepnews propose à Bill Henderson d’enregistrer un 45 tours pour le label
Riverside. Accompagné d’emblée par la crème du jazz, soit le quintet de Charlie Rouse
(Julius Watkins, Hank Jones, Wilbur Ware, Philly Joe Jones), le chanteur grave
un original, «Busy Signal», qui ouvre cette anthologie. On y découvre
un chanteur mainstream à la voix chaude et claire, au swing naturel et à l’expression marquée par le blues (le terroir chicagoan) qui le rapproche davantage de son idole Joe Williams, chanteur fétiche de Count Basie des années 1950, que la nouvelle vague d'alors les Jon Hendricks ou Eddie Jefferson, et que les frères Nat et Freddy Cole, malgré leur origine et leur tempérament communs d'entertainer.
Toujours est-il que son implantation new-yorkaise commence à porter ses
fruits: il a ainsi l'occasion de chanter devant Horace
Silver qui lui propose dans la foulée d’interpréter son «Señor
Blues», contenu dans l’album 6 Pieces of
Silver (Blue Note) de novembre 1956, sur lequel il vient de poser des
paroles. Voilà le chanteur dûment parrainé pour faire son entrée dans la grande maison Blue Note, une entrée réussie puisque ce deuxième 45 tours devient un hit de jukebox et restera comme l’une
des meilleures ventes de single pour le label d'Alfred Lion (dont Horace Silver est un proche). Deux autres 45 tours suivent pour Blue Note: le chanteur entre ainsi
en studio cette fois avec Jimmy Smith, le 14 octobre 1959, notamment pour une
reprise un peu lisse, malgré le groove de l’organiste, d’un succès de Ray
Charles, «Ain't That Love».
Les grandes scènes jazz sont désormais ouvertes à
Bill Henderson qui passe à l’Apollo
Theater de Harlem, au Cotton Club d’Atlantic City, à l'Howard Theater de
Washington et, en janvier 1959, au Village Vanguard avec Sonny Rollins. Il fait
également plusieurs apparitions à la télévision en compagnie de Randy Weston,
Roy Eldridge et Billie Holiday avant d’être approché par le label chicagoan
VeeJay qui lui consacre un LP, Bill Henderson
Sings, enregistré les 26 et 27 octobre 1959 avec, selon les plages, le trio
de son ami Ramsey Lewis (VeeJay réunit ainsi deux artistes originaires de Windy City, au sommet du swing sur
«Free Spirits») et un octet dirigé par Benny Golson. Le timbre enveloppant de Bill Henderson fait merveille sur la superbe ballade «Without You».
De janvier 1960 à avril 1961, Bill Henderson enchaîne
sur huit nouvelles sessions réalisées à Chicago (CD2), avec différentes formations
allant du trio au big band. VeeJay rassemblera une partie des titres
enregistrés sur le LP Bill Henderson,
paru à l’été 1961. Le label met ainsi des moyens importants à disposition du
chanteur, pour le meilleur s’agissant du trio d’Eddie Higgins (excellent «Sweet
Georgia Brown») et du big band de Thad Jones («My How the Time Goes By», magnifiquement
arrangé), tandis que l’orchestre à cordes de Jimmy Jones entraîne Bill Henderson
du côté de la variété jazzy (signalons qu'il existe une autre version de «Never Kiss and Run» et «Sleepin' Bee» enregistrée avec Jimmy Jones le 21 novembre 1960 à Chicago, absente de ce CD).
Les autres bandes resteront
dans les cartons jusqu’à l’édition en 1974 d’un troisième LP, Please Send Me Someone to Love, dont la
sortie tardive est sans doute due au fait que Bill Henderson
interrompt sa collaboration avec VeeJay en 1962 et signe avec MGM Records pour quelques titres pop. Certains jazzmen commencent en effet à se positionner dans la musique commerciale, notamment Quincy Jones, Miles Davis, Aretha Franklin et Ramsey Lewis. On trouve encore sur ces sessions de très
belles plages, en particulier les thèmes avec le quartet de Tommy Flanagan (qui
cite avec malice la Marche nuptiale de
Mendelssohn sur «Love Is a Bug») et le quintet MJT +3 de Willie Thomas, Frank
Strozier et Harold Mabern («Sleepy», encore un blues qui va comme un gant à Bill
Henderson). Deux excellents titres jazz-soul, gravés avec l’orchestre de
Richard Evans, «Slowly» et «Opportunity», revêtent une couleur à part et sont d’ailleurs
restés inédits tout comme la première version de «Sleepy» (avec l’octet de
Bobby Bryant) qui ouvre ce CD2.
Ces Complete
Recordings s’achèvent donc sur les ultimes sessions VeeJay d’avril 1961, période
à laquelle Bill Henderson est au sommet: il voyage au Japon avec
les Jazz Messengers d’Art Blakey, retrouve Sonny Rollins en avril 1962 à la New
York Jazz Gallery, grave pour Verve en 1963 un Bill Henderson With the Oscar Peterson Trio, tourne de 1965 à 1967
et enregistre avec le Count Basie Orchestra, comme son modèle Joe Williams. En 1967,
sur les conseils de son ami le comédien Bill Cosby, il déménage à Los Angeles,
CA, et entame une carrière d’acteur pour la télévision qui prendra le
dessus sur le jazz, même s’il continue à se produire dans les clubs et les
festivals, y compris sur la Côte Est, et à enregistrer quelques albums, jusqu’à
un Live at the Kennedy Center en 2004
(WebOnlyJazz), sans doute à l’initiative de son «ange gardien» Billy Taylor qui
était le directeur artistique de l’institution. En 2000, il fut l'invité du Charlie Haden West Quartet au festival JazzBaltica.
Bill
Henderson avait déclaré, comme le rapporte le livret, que les trois musiciens auxquels il devait le plus étaient Billy Taylor, Horace Silver et Cannonball
Adderley. Si le chanteur a enregistré avec Nat Adderley (membre de
l'orchestre de Thad Jones), ce n'est a priori pas le cas pour Julian. La question de sa relation avec l'altiste reste d'ailleurs en suspens (est-ce Cannonball qui a présenté Bill Henderson à Horace Silver en 1958, lui ouvrant ainsi les portes de Blue Note?). Le livret nous signale en tous cas un concert commun au Half Note en avril 1960.
© Jazz Hot 2023
|
  Fulvio Albano / The Italian Sax Ensemble feat. Dusko Gojkovic Fulvio Albano / The Italian Sax Ensemble feat. Dusko Gojkovic
Venice
Fair Weather*, Stolen Moments*, Jeru*, Prelude to a Kiss*,
April Skies*, Watz for Debby°, Parker's Mood°, Up Town°, I Wanna Go Home+,
Tickle Toe*, Fata Morgana*, Blues for Gianni*, Venice+, Streamer°,
The Scene Is Clean*
Fulvio Albano (lead*+, ts) & The Italian Sax
Ensemble*+: Dusko Gojkovic (tp)*, Danilo Moccia (tb), Claudio
Chiara, Valerio Signetto (as), Luigi Grasso*, Nicola Tonso (ts)+, Michael
Lutzeier*, Helga Plankensteiner+ (bar), Gianluca Tagliazucchi (p),
Aldo Zunino*, Lorenzo Sandi+ (b), Alfred Kramer*, Adam Pache+(dm); Andrea Ravizza (lead)° & Chamber Music Orchestra°: même personnel
sauf *, reste de l’orchestre détaillé dans le livret
Enregistré le 22 juillet 2010, Mocalieri (Italie)* et le 30
avril 2012, Turin (Italie)°+
Durée: 1h 10’ 11’’
JazzCity Records 002
(albanofulvio@gmail.com)
  Fulvio Albano / Torino Jazz Orchestra Fulvio Albano / Torino Jazz Orchestra
The Golden Age
Golden Age, Vecchi Amici, Angola Adeus (Riusciranno i nostri
eroi…), L'anatra all'arancia, El negro zumbón, Matrimonio all'italiana, Jazz
prelude, Roma nun fa’ la stupida stasera, 7 Uomini d'oro
Fulvio Albano (lead, cl, ss, ts) & Torino Jazz Orchestra:
Mirco Rubegni, Paolo Russi (tp), Tolga Bilgin, Franco Piana (tp, flh), Davide
Ghidoni (flh), Pierluigi Filagna (cor), Luca Begonia, Stefano Calcagno (tb),
Gianfranco Marchesi (btb), Dino Piana (vtb), Claudio Chiara (as, fl), Valerio
Signetto (as, cl, bcl), Gianni Virone (ts, fl), Helga Plankensteiner (bar,
bcl), Alessandro Molinaro (fl, picfl), Fabio Gorlier (p), Aldo Zunino (b), Adam
Pache (dm) + Terell Stafford (tp), Scott Hamilton (ts)
Enregistré entre 2016 et 2018, Turin (Italie)
Durée: 53’ 09’’
JazzCity Records 033 (albanofulvio@gmail.com)
Peu de musiciens ont un C.V. aussi polyvalent que celui de
Fulvio Albano, pilier de la scène jazz de Turin, où il est né le 22
juin 1961. En quarante ans de carrière, le saxophoniste ténor a donné
évidemment des milliers de concerts, d’abord en sideman –en particulier au sein
du Gianni
Basso Big Band (1981-2006)– puis à la tête de ses
propres formations: depuis 2000, The Italian Sax Ensemble qui a reçu Uri Caine
(2010) et Terell Stafford (2015); depuis 2006, le Torino Jazz Orchestra qui a
notamment invité Dee Dee Bridgewater (2007), le groupe Mingus Dynasty (2013),
Dianne Schuur (2014), Stefano Di Battista (2015), Denise King (2017), Carla
Bley et Steve Swallow (2018); et d’autres ensembles où l’on retrouve Alvin
Queen, Phil Woods, Lee Konitz ou encore Tom Harrell. Plus récemment, Fulvio
Albano a joué auprès de Ramona Horvath et au sein du Jazz Legacy Quintet avec
Kirk Lightsey et Stéphane Belmondo. A cela s’ajoute une œuvre de compositeur, une
activité suivie d’enseignant depuis 1986 et la direction artistique de nombreux
événements, festivals ou organisations, y compris à l’international, dont
certains créés à son initiative comme le Jazz Club Torino (fondé en 2005), le Due
Laghi Jazz Festival & Workshop (Avigliana, Piémont, 1994-2018), l’Altitude
Jazz Festival de Briançon (2007-2011) ou encore l’Italian Jazz Festival di Hong
Kong e Macau (2009-2010). Ce dynamisme, en lien avec le tissu économique
turinois, lui a même valu d’être nommé en 2016 président de la Chambre de commerce italienne au Vietnam! Enfin, dernière corde à son arc, Fulvio Albano a
mis sur pied en 2013 sa propre maison de disque, JazzCity Records, laquelle
publie les enregistrements de ses diverses formations, à l’image des deux
albums dont il est ici question.
Venice réunit deux
sessions studio de l’Italian Sax Ensemble: l’une du 22 juin 2010 (9 titres) avec
le regretté Dusko Gojkovic en invité, l’autre, du 30 avril 2012 (2 titres).
Pour cette seconde date, sont également proposés 4 titres avec une autre
formation, le Chamber Music Orchestra dirigé par le chef d’orchestre,
compositeur et arrangeur Andrea Ravizza, (né en 1971), constitué d’une partie
des musiciens de l’Italian Sax Ensemble (voir détail dans la notice), dont
Fulvio Albano, et d’une vingtaine d’autres, dont une large section de cordes.
Le répertoire joué par l’Italian Sax Ensemble regroupe essentiellement des
compositions du jazz, dont «Venice» de John Lewis qui donne son nom à l’album. On
retrouve avec plaisir la sonorité chaude de Dusko Gojkovic dès le premier
titre, «Fair Weather» (Benny Golson), d’une sensibilité encore accrue avec la
sourdine sur «Stolen Moments» (Oliver Nelson) où l’excellent Luigi
Grasso, à l’époque sociétaire de l’orchestre, donne un solo plein de
profondeur et de lyrisme. Tout en rondeur, Fulvio Albano est également au ténor
sur «Fata Morgana» (Lars Gullin). La musique est bien jouée, du
célèbre «Tickle Toe» (Lester Young) –auquel la section de saxophones insuffle
une formidable énergie, dans un joli dialogue avec Dusko Gojkovic, le tout
impeccablement porté par la section rythmique–, à un bel original du
trompettiste invité, «Blues for Gianni», très probablement dédié à Gianni
Basso, qui fut un de ses partenaires réguliers, décédé l’année précédant cet
enregistrement. Quant aux 4 titres avec le Chamber Music Orchestra, ils offrent
une démonstration réussie de ce que peut donner la rencontre entre big band et
section de cordes. Les deux compositions du jazz –«Watz for Debby» (Bill Evans),
introduit avec finesse par Gianluca Tagliazucchi, et «Parker's Mood» (Charlie
Parker)–, comme les deux originaux d’Andrea Ravizza, «Uptown» et
«Streamer», sont au même niveau que le reste du disque.
La remarque vaut également pour l’autre album, The Golden Age, avec le Torino Jazz
Orchestra, formation un peu plus large de dix-neuf musiciens auxquels
s’ajoutent quatre invités de marque: d’une part, Terell Stafford et Scott
Hamilton, d’autre part, le tromboniste Dino Piana (né en 1930) et son fils le
trompettiste Franco Piana, auteur de l’ensemble des arrangements, pour un
hommage au compositeur Armando Trovajoli (1917-2013). En 2008, à la Casa del
Jazz de Rome, le père et le fils avaient déjà interprété le répertoire du
maestro qui avait alors lui-même supervisé les arrangements (CD Omaggio a Armando Trovajoli, Casa del
Jazz). D’abord connu pour ses musiques de films –Riz amer (Giuseppe De Santis, 1949), Pauvres millionnaires (Dino Risi, 1959), Les Monstres (Dino Risi, 1963), Nous
nous sommes tant aimés (Ettore Scola, 1974), Affreux, sales et méchants (Ettore Scola, 1976), Une journée particulière (Ettore Scola, 1977)…–,
Armando Trovajoli est également auteur de pièces classiques, de comédies
musicales et de musiques de variétés. Mais c’est en tant que pianiste de jazz
qu’il a débuté sa carrière en 1937. Il a même représenté l’Italie au Festival
International de Jazz de Paris de 1949 organisé par Charles Delaunay. Egalement
actif à la radio, il a fondé en 1956 le Rai Jazz Orchestra. Si son œuvre pour
le cinéma est évidemment imprégnée de jazz, central dans certains de ses thèmes
comme «Anna With the Rolls» (Hier,
aujourd'hui et demain, Vittorio De Sica, 1963), Armando Trovajoli a aussi
enregistré plusieurs albums de jazz sous son nom dans les années 1950-1960, a l'instar de The Beat Generation (RCA, 1960)
avec lequel a débuté Dino Piana.
Les pièces jouées ici par le Torino Jazz Orchestra sont
principalement tirées de musiques de film, à commencer par le morceau-titre, le
très frais «The Golden Age» –avec de bons solos de Scott Hamilton,
Dino et Franco Piana– suivi de «Vecchi Amici» (Toto sexy, Mario Amendola, 1963). C’est l’occasion d’apprécier
l’art de la mélodie qu’a cultivé Armando Trovajoli, avec des thèmes qui restent
dans l’oreille, tel «Angola Adeus» (Nos
héros réussiront-ils à retrouver leur ami mystérieusement disparu en Afrique?,
Ettore Scola, 1968) –impérial Terell Stafford!, et à la dimension orchestrale
superbement mise en valeur par Franco Piana comme sur «7 Uomini
d'oro» (Sept hommes en or, Marco
Vicario, 1965). Dans la même veine, «Roma nun fa’ la stupida stasera» a été
écrit pour la comédie musicale Rugantino (1978) de la compagnie Garinei e Giovannini. Un peu à part du reste de cet
album, l’entêtant «Jazz Prelude», une composition pour
musique de chambre de la fin des années 1950, mêle avec habileté classique et
jazz (le solo de Fulvio Albano à la clarinette est lui bien ancré dans le
jazz!).
Bravo à Fulvio Albano pour ce travail de musicien, de chef d’orchestre, d’arrangeur, de producteur qui documente, jusque dans les dialogues italo-américain et cinéma-jazz, la vie jazzique italienne.
Jérôme Partage
© Jazz Hot 2023
|
  Virgil Gonsalves Sextet & Big Band Virgil Gonsalves Sextet & Big Band
featuring Rudy Salvini Big Band
Jazz in the Bay Area 1954-1959
CD1: Bounce, Out of Nowhere, Too Marvelous for Words, It
Might As Well Be Spring, Yesterdays, Love Me or Leave Me, Whitewash, Our Love
Is Here to Stay, Lost World, I’ll Take Romance, Searle’s Corner, Viva Zapata,
Half Mine, Goody-Goody, Gar-din, My Heart Stood Still, Fascinatin’ Rhythm,
Bags’ Groove
CD2: Wail for Patrick, Smithsonian, Yesterdays, Topsy
Returns, Boot’s Boots, Little Melonae, Sharon, Oasis, Lover Man, Stablemates, A
Sunday Kind of Love*, Moment’s Notice, Steresis, Blue Bird
Virgil Gonsalves (bar)
• en sextet: Bob Enevoldsen (vtb), Buddy Wise (ts), Lou Levy
(p), Harry Babasin (b), Larry Bunker (dm), 1954
• en sextet: Bob Badgley (vtb), Dan Patiris (ts), Clyde
Pound (p), Ron Crotty, Max Hartstein (b), Gus Gustafson (dm), 1955
• avec le Rudy Salvini (tp) Big Band (personnel détaillé
dans le livret), 1956
• en sextet: Mike Downs (tp), Dan Patiris (ts), Merril
Hoover (p), Eddie Kahn (b), Al Randall (dm), 1959
• en big band: John Coppola, Billy Catalano, Dick Mills,
Mike Downs, Jerry Cournoyer (tp), Leo Wright, Bob Davidson (as), Dan Patiris,
Chuck Peterson (ts), Junior Mance, Merril Hoover* (p), Eddie Kahn (b), Benny
Barth (dm), 1959
Enregistré entre le 29 septembre 1954 et mai 1959,
Hollywood, CA, Oakland, CA, San Francisco, CA
Durée: 54’ 27’’ + 1h 03’ 12’’
Fresh Sound Records 1114 (www.freshsoundrecords.com/Socadisc)
Ce double CD, édité avec le soin habituel de Fresh Sound
Records, documente, essentiellement dans sa dimension euro-américaine, la scène jazz de la Bay
Area, la région de la baie de San Francisco, CA. Cette scène, moins en vue que
celle de New York ou New Orleans, n’en n’a pas moins une histoire riche et
ancienne qui prend naissance au nord-est de la ville, dans le secteur appelé
«Barbary Coast» ou «Vice District», où se concentrent sur Pacific Street –surnommée
«Terrific Street» par les musiciens pour la qualité de la musique qui y est
jouée–, bars, salles de danse et de jeu. Haut-lieu de la prostitution, ce
quartier est celui de toutes les libertés et transgressions, en particulier des
lois Jim Crow, avec des clubs comme The Jupiter –géré en 1918-1919 par Jelly
Roll Morton et sa compagne Anita Gonzales– où se pressait un public non
ségrégué. Un autre Néo-Orléanais, Kid Ory, marquera l’histoire par sa venue en
1921 au Purcell’s où se produit régulièrement le chef d’orchestre et pianiste
de ragtime, Sid LeProtti (1886-1958), une figure de cette scène. Le
quartier subit à partir de 1911 un harcèlement des autorités municipales qui
multiplient les interdictions, et finit par péricliter avec la politique de
prohibition (1920-1933). Le jazz se déplace ailleurs en ville, mais la reprise
en main se poursuit via la section locale blanche de l’American Federation of
Musicians (AFM), farouchement ségrégationniste, qui cherche à contrôler les
emplois de la Bay Area et bataille entre 1934 et 1946 sur le plan judiciaire
contre la section afro-américaine, d’abord contrainte de s’incliner avant que
l’Etat de Californie n’ordonne la fusion des deux sections en 1960. Dans ce
contexte tendu, l’influence originelle de New Orleans ressurgit à la fin des
années 1930, avec le Great Revival, un mouvement de
redécouverte d'abord mené par des collectionneurs et des critiques (dont la Hot Records Society, cf. Walter E. Schaap) qui va éveiller l'intérêt de jeunes musiciens euro-américains de San Francisco comme Lu Watters (tp) et Turk
Murphy (tb) du Yerba Buena Jazz Band, formation inspirée par King Oliver et l'Original Dixieland Jass Band, qui fera les beaux jours du
Dawn Club, un ancien speakeasy qui
fermera en 1947, et inaugurera en 1941 le label Jazz Man dédié au jazz «traditionnel ». Ce Great Revival relance la carrière de Kid Ory, tandis que Bunk Johnson est au centre d'une session produite à New Orleans par Jazz Man en 1942 et séjourne ensuite à San Francisco en 1943-44 où il enregistre plusieurs faces et joue avec Lu Watters et les membres du Yerba Buena Jazz Band qui ne sont pas sous les drapeaux (cf. «Le Revival» par Gérard Conte, Jazz Hot n°98, 1955).
Au début des années 1950, San Francisco demeure un bastion
du dixieland où émerge progressivement la nouvelle scène bop, emmenée dans sa
version West Coast par le jeune Dave Brubeck. C’est le début d’une
dynamique qui voit les clubs proliférer dans les différents quartiers –Fillmore
(dont l’essor immobilier tient à la déportation de ses résidents japonais),
North Beach, Tenderloin–, et à laquelle participe la guerre de Corée
(1950-1953) en attirant des musiciens mobilisés, tels John Handy (ts) ou Chet
Baker (de même que Lennie Niehaus effectue son service militaire à Fort Ord, à moins de 200km de San Francisco). En 1955, toujours dans Jazz Hot n°98, Charles Delaunay écrit qu' «il semble bien que depuis quelques années, ce soit la Californie qui représente aux Etats-Unis le foyer (de jazz) le plus intense», dont le développement doit beaucoup à l'industrie du cinéma d'Hollywood (1), tandis que le «jazz moderne » s'est diffusé parmi les jeunes musiciens grâce à «l'activité déployée par les promoteurs locaux comme Norman Grantz, Gene Norman, Eddie Laguna, par Stan Kenton et son orchestre, le séjour de Lester Young, de Coleman Hawkins, de Charlie Parker, de Dizzy Gillespie, puis plus tard de l'orchestre de Woody Herman, de Stan Getz et Gerry Mulligan» (dossier «Californie 55» qui se poursuit dans le n°99). Ces fertiles années 1950-1960 voient l’émergence de musiciens euro-américains (2),
emblématiques comme Vince Guaraldi (p, 1928-1976) et Caj Tjader (vib, 1925-1982),
et d’autres à la notoriété plus modeste comme le saxophoniste baryton Virgil Gonsalves (1931-2008) dont Fresh Sound présente ici l’intégrale (connue) des
enregistrements réalisés en leader, entre 1954 et 1959, ainsi qu’une session de
1956 au sein du big band du trompettiste Rudy Salvini (1925-2011).
Leurs deux parcours étant largement détaillés dans le livret
et sur le site internet de Fresh Sound, on passera rapidement sur les
circonstances entourant ces enregistrements. Fraîchement diplômé de
l’Université de San Francisco (1952), Virgil Gonsalves commence à attirer sur
lui l’attention des producteurs quand en 1954 le label Nocturne, basé à Los
Angeles, accepte de l’enregistrer à condition d’être accompagné de musiciens de
la Cité des Anges, plus réputés. Bon instrumentiste (sa sonorité enveloppe joliment «Out of Nowhere») Virgil Gonsalves est effectivement entouré ici de professionnels aguerris. La session de novembre 1955,
où cette fois le baryton, toujours en sextet, dirige ses propres musiciens, est également bien exécutée. Elle intervient à l’issue d’un engagement de six
mois dans le plus fameux club de San Francisco, le Black Hawk (1949-1963), au cours duquel Virgil
Gonsalves accompagnera Carmen McRae. Rudy Salvini, un vétéran
qui a appartenu avec Tony Bennett au 314th Army Special
Services Band et a repris des études après sa démobilisation, a
rencontré Virgil Gonsalves à l’université. En janvier 1956, il lance son propre
big band, lequel fait sa première apparition, avec le Virgil Gonsalves Sextet, à
l’occasion d’un bal du samedi après-midi, destiné à un public de jeunes gens. En novembre, le big band –dans lequel figure
Virgil Gonsalves– enregistre cinq titres pour un nouveau label franciscanais,
Jazz Records. A défaut d'intensité dans l'interprétation, l’orchestre –intégré– délivre une musique très plaisante, pourvue d'une décontraction toute West
Coast («Topsy Returns»). Plusieurs de ses membres feront carrière dans la Bay
Area, comme Allen Smith (tp), un pilier de
l’éphémère Blanco's Cotton Club (1948-1950) –premier club déségrégué de l’après-guerre– puis du fameux Jimbo's Bop City (1950-1965) à Fillmore qui reçut Charlie Parker, Miles Davis et dont Freddie Redd fut le pianiste maison en 1957 durant 6 mois. En mai 1959, on retrouve Virgil Gonsalves –qui n’a pas
manqué d’activités depuis trois ans (cf.
livret)– sur deux sessions, en sextet et en big band, qui occupent chacune
une face du LP Jazz at Monterey (Omega
Records). Le big band de Virgil
Gonsalves possède un peu plus de caractère que celui de Salvini, avec une orientation post-bop («Moment’s
Notice» de John Coltrane), mais reste toujours un peu lisse. Signalons tout de même la présence de Junior Mance dont la prestation, notamment sur «Blue Bird» (solo très blues), se détache de l'ensemble. Quant au sextet, son personnel a été totalement renouvelé depuis la session de 1955, en dehors de Dan Patris
(ts).
On vous laisse découvrir par
la lecture du livret, la suite du parcours de Virgil Gonsalves jusqu’à son
virage jazz-rock puis funk dans les années 1970, de même que celui de Rudy
Salvini, professeur de musique jusqu’à sa retraite en 1985. Deux acteurs importants
de la vie jazzique de San Francisco des années 1950 qui méritaient pleinement
d’être l’objet de ce travail de mémoire poursuivi par Jordi Pujol.
Jérôme Partage
1. A partir de 1956, la télévision gagnant des parts de marché sur tout le territoire et fortement implantée en Californie, deviendra un employeur important pour les jazzmen, cf. chronique du livre Stars of Jazz.
2. Charles Delaunay relève également cette prédominance dans Jazz Hot n°98: «Une des premières constatations qui s'impose c'est que la plupart de ces mouvements sont menés par des musiciens blancs et, comme l'a remarqué Leonard Feather (DownBeat du 9 février 1955), les Noirs semblent avoir été maintenus à l'écart d'une façon plus visible encore que dans le Middle West ou l'Est de l'Amérique du Nord».
© Jazz Hot 2023
|
 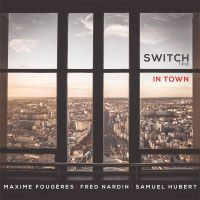 Switch Trio Switch Trio
In Town
Blue Tempo, Out of the Past, Don't Forget the Blues, Mister
K.B., Song for My Mother, Ding, Moore's Alphabet, Second Thought, Take the A
Train
Maxime Fougères (g), Fred Nardin (p), Samuel Hubert (b)
Enregistré du 8 au 10 juillet 2017, Paris
Durée: 50’ 20’’
  Fred Nardin Trio Fred Nardin Trio
Live in Paris
CD1: Green Chimneys, Just Easy, The Giant, Lost in Your
Eyes, Voyage, In the Skies Intro, In the Skies
CD2: Parisian Melodies, Colours, I Mean You, New Waltz,
Don't Forget the Blues, Turnaround
Fred Nardin (p), Or Bareket (b), Leon Parker (dm, perc)
Enregistré live les 18 et 19 février 2020, Sunside, Paris
Durée: 47’ 32’’ + 44’
26’’
Jazz Family 079 (www.fredericnardin.com)
Bien installé dans le paysage jazz parisien, Fred Nardin
continue de mener une activité discographique soutenue (il en est déjà à une
quinzaine d’enregistrements en leader ou coleader, notamment avec l’Amazing
Keystone Big Band). Après At Home! (2014, Ahead), In Town est son
deuxième album avec le Switch Trio, dont les deux autres membres sont Maxime
Fougères et Samuel Hubert. Le premier est né en 1980. Il a débuté la musique à
11 ans à l’Ecole de musique de Roanne avant d’étudier au Conservatoire de Lyon
puis au CNSDP de Paris. Il participe alors à différents projets avec Manuel
Marchès, Yoann Loustalot, Timothy Hayward, entre autres, et sort en 2012 un
premier CD en leader, Guitar Reflections,
qui sera suivi d’un volume 2, cinq ans plus tard (tous deux chez Gaya Music Production).
Samuel Hubert a débuté à Montpellier avant de suivre un cursus jazz au
Conservatoire de Marseille puis à l’IMFP de Salon-de-Provence. Il intègre
ensuite la scène parisienne où on le retrouve auprès de Florin Niculescu,
Christian Escoudé, Alain Jean-Marie ou Mourad Benhammou. Ces derniers temps, on
l’a régulièrement entendu dans les formations d’Esaie Cid et d’Olivier Temime.
Des compositions du jazz et quelques originaux constituent
cet album qui repose sur la formule piano-guitare-contrebasse popularisée par
Nat King Cole et Oscar Peterson, avec une sonorité feutrée issue de
la finesse de Maxime Fougères et Samuel Hubert («Out of the Past» de Benny Golson). Imprimant de légères percussions («Mister
K.B.», un thème du pianiste), Fred Nardin, donne quelque relief à l’ensemble qui se conclut
sur une version lente et bluesy de «Take the 'A' Train» (Duke Ellington).
On retrouve ensuite Fred
Nardin en live au Sunside, à la tête
de son trio, qui dans la
droite lignée du précédent album (studio), Look Ahead (2018, Naïve), comprend toujours Or Bareket et Leon Parker: il y a une certaine densité tant dans le jeu du leader, perlé («Just Easy», un original) comme dans celui de Leon Parker qui d’emblée fait monter la tension
(«Green Chimneys» de Thelonious Monk). Les soubassements rythmiques dressés par
Or Bareket («The Giant», autre original du pianiste) parachèvent
ce bel ouvrage. Là
encore, la conclusion arrive comme une confirmation avec «Turnaround»
(Ornette Coleman), un blues sur lequel Fred Nardin affirme sa maîtrise.
Jérôme Partage
© Jazz Hot 2023
|
 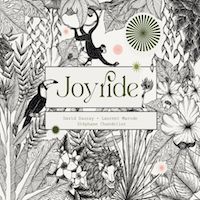 David Sauzay / Laurent Marode / Stéphane Chandelier David Sauzay / Laurent Marode / Stéphane Chandelier
Joyride
Joyride, Le Chant du lion, Alban Little Monkey, Last Minute
Blues, Chemin de l'eau vive, Bugs Ritual Dance, Two Bossas, Chapter Eleven,
Minotaure, Quiet Time*
David Sauzay (ts, fl*), Laurent Marode (org), Stéphane
Chandelier (dm)
Enregistré le 9 juin 2021, lieu non précisé
Durée: 43’ 21’’
Sunny Side Up (www.davidsauzay.com)
  David Sauzay Quartet David Sauzay Quartet
Featuring
Max’s View, Hiroshi’s Time, Taketori*, G, Paul’s Beard, The
Spirit of Alice, Eden of Darkness*°, Mas que nada, Carthage**, Yeah Yeah Yeah**
David Sauzay (ts, ss°, fl*), Hiroshi Murayama (p), Gabriel
Sauzay (b), Paul Morvan (dm) + Hillel Salem (tp)**
Enregistré en décembre 2021 et en avril 2022, lieu non précisé
Durée: 57’ 30’’
Sunny Side Up (www.davidsauzay.com)
Au cours de l’interview que nous avions publiée l’année
dernière, David Sauzay avait évoqué son
rapport au jazz et notamment son travail de composition, alors qu’il sort
consécutivement en 2023 deux albums alignant essentiellement des originaux: le
premier, Joyride est servi par un
trio dont David Sauzay partage le leadership avec Laurent Marode (ici à
l’orgue) et Stéphane Chandelier, des complices de longue date; sur le second, Featuring, le ténor est à la tête de son
«nouveau» quartet, constitué de son fils Gabriel, 22 ans, encore étudiant au
Conservatoire National de Musique et de Danse de Paris (et qui avait déjà été
invité pour quelques titres sur Playing With), d’Hiroshi Murayama, installé
à Paris depuis 2005 –il a notamment joué avec Michele Hendricks, Martin
Jacobsen, Renato D’Aiello, enregistré avec Yves Nahon et, en leader, avec Philippe
Soirat– et de Paul Morvan dont nous avons récemment chroniqué l’album Danger
Zone. Deux projets aux couleurs harmoniques différentes mais ancrés dans
une même esthétique post-bop, terrain jazzique de prédilection de David.
A l’écoute de Joyride,
on pense aux différentes rencontres, organisées sous l’égide du label Prestige
au début des années 1960, entre Jack McDuff et les ténors Jimmy Forrest, Harold
Vick, Gene Ammons, Red Holloway et bien sûr Sonny Stitt. A ceci près qu’elles
se sont généralement déroulées en quartet, notamment avec la guitare de Grant
Green, quand nous avons ici affaire à un trio sax-orgue-batterie. Pour autant,
quelque chose de cet esprit groove, ancré dans le blues, est passé dans le jeu
de nos musiciens, David Sauzay en tête, au son plein et velouté («Last Minute
Blues»). Laurent Marode, qu’on connaît avant tout comme un pianiste de haut vol,
est épatant de vélocité et de swing («Chapter Eleven»), tandis que Stéphane
Chandelier maintient tout au long du disque la pulsation qui lui donne sa
densité (avec un bon solo sur «Joyride»). Soulignons également la qualité des
thèmes de cet opus qui font honneur à la tradition hard bop (a priori écrits par les membres du trio mais sans que cela soit précisé), du morceau-titre,
«Joyride», à la magnifique ballade «Chemin de l’eau vive», en passant par
«Quiet Time» qui nous entraîne davantage du côté de Lalo Schiffrin avec un
David Sauzay à la flûte, léger et onirique, qui crée, avec les sonorités
poétiques de Laurent Marode, une atmosphère un peu à part du reste de l’album.
Sans surprise, Featuring possède les mêmes qualités de swing, d’intensité et
d’enracinement dans l’héritage des maîtres, célébré avec des compositions
toujours à la hauteur. On constate d’emblée que la transmission –chère au cœur
de David– a opéré avec succès auprès de Gabriel qui signe le dynamique «Max’s
View» en ouverture, justement bien dans l’esprit des Messengers d’Art Blakey. Après une belle introduction du ténor, le
jeune contrebassiste y donne un solo qui retient l’attention. Le même Blue Note feeling est à l’œuvre sur «G»
(Paul Morvan) avec un David Sauzay impérial et un Hiroshi Murayama superbe de
swing et d’expressivité. Ce dernier a d’ailleurs donné «Taketori», aux accents
japonisants, et «Eden of Darkness», deux thèmes où la poésie est encore au
rendez-vous, toujours bien amenée par David Sauzay à la flûte et au saxophone
soprano. Les originaux du leader ne sont pas en reste avec le nerveux
«Hiroshi’s Time», le swinguant «Paul’s Beard», le coltranien «The Spirit of
Alice» et le subtil «Carthage» sur lequel intervient le bon trompettiste
israélien Hillel Salem, installé depuis peu à Paris et dont la sonorité
s’inscrit dans une filiation avec Lee Morgan. On le retrouve sur le calypso «Yeah
Yeah Yeah» (Eddie Harris), un des seuls titres appartenant au répertoire avec
«Mas que nada» (Jorge Ben Jor), célèbre bossa qui s’intègre parfaitement à cet
album incandescent de jazz de la première à la dernière note. L’excellent travail mené par David Sauzay et ses
partenaires de prolongement et d'enrichissement du jazz de culture est à saluer.
Jérôme Partage
© Jazz Hot 2023
|
  Dmitry Baevsky Dmitry Baevsky
Soundtrack
Evening Song/вечерняя песня, Vamos Nessa,
Baltiyskaya/балтийская, Grand Street, The Jody Grind, La Chanson de Maxence,
Over and Out, Le Coiffeur, Invisible, Autumn in New York, Stranger in Paradise,
Tranquility, Afternoon in Paris
Dmitry Baevsky (as), Jeb Patton (p), David Wong (b), Pete
Van Nostrand (dm)
Enregistré le 25 novembre 2019, Paramus, NJ Durée: 1h 05’ 45’’
  Dmitry Baevsky Dmitry Baevsky
Kid's Time
Mr. H., Imintagante, Kids' Time*, Minor Delay, Time Flies,
Deep in a Dream*, Morningside Waltz, Rollin', MTA, Soy Califa*, The End, Don't
Blame Me,
Dmitry Baevsky (as), Clovis Nicolas (b), Jason Brown (dm) +
Stéphane Belmondo (tp, flh)
Enregistré en juillet 2022, Malakoff (Hauts-de-Seine)
Durée: 1h 08’ 21’’
Fresh Sound New Talent 646 (www.freshsoundrecords.com/Socadisc)
La constance dans la qualité de ses productions est l’un des grands mérites de Dmitry Baevsky, comme il le confirme avec ses deux derniers
albums, les 9e et 10e en leader: Soundtrack et Kid’s Time, édités par Fresh Sound New
Talent.
Sur Soundtrack on
retrouve l’altiste américano-russe en quartet avec deux complices new-yorkais
de longue date: les excellents Jeb Patton et David Wong. A la batterie, Pete Van Nostrand a pris la place de
Joe Strasser. Rien de bien surprenant: il fait partie du trio de Jeb Patton
depuis plusieurs années et possède un pedigree des plus flatteurs (Kenny Barron, Cécile McLorin-Salvant, Aaron Diehl, Gerald
Clayton, Eric Reed...). Revenant longuement
sur son parcours personnel dans le livret, Dmitry Baevsky dresse ici un portrait musical des trois
villes qui ont marqué trois grandes étapes de sa vie: Leningrad/Saint-Petersbourg où il
est né et a grandi, New York où il a débarqué à 19 ans pour s’immerger dans le
monde du jazz durant vingt-et-un ans, Paris où il s’est établi depuis 2016 et a fondé
une famille. Le disque s’ouvre ainsi sur «Evening Song» (1957), une ode à la ville dont elle est devenue l’hymne
officieux. Un beau thème qu’on doit au compositeur de
musique classique et populaire Vassili Soloviov-Sedoï (1907-1979), figure de la
vie artistique soviétique, lui aussi originaire de la Venise du nord. La chanson se prêtant très naturellement au jazz, Dmitry Baevsky en
fait son miel, s’exprimant avec une sonorité particulièrement suave et
profonde à la convocation de ses racines russes. Un original de sa main, joliment
chaloupé, «Baltiyskaya», fait également référence à sa ville natale. On
traverse l’océan avec «Autumn in New York» marqué par une longue et superbe intervention
de Jeb Patton, dont on ne cesse d'admirer la maîtrise, tandis que sur le «Grand Street» de Sonny
Rollins le quartet porte le swing à sa quintessence. Dmitry est plein d’agilité
sur «Afternoon in Paris» (John Lewis) où David Wong donne un solo tout en
swing et musicalité. L’évocation de Paris passe aussi par Michel Legrand, un
cliché musical à lui tout seul. Le compositeur des Demoiselles de Rochefort n’en était pas moins habile et avait en commun avec Vassili Soloviov-Sedoï cette fibre mélodique populaire offrant un terrain favorable au jazz, ce qui donne matière aux musiciens sur «La Chanson de Maxence»
(beau jeu d’archer en contrechant du saxophone). Les autres titres,
essentiellement des compositions du jazz, permettent tout au long du disque
d’apprécier ce quartet de haut vol, y compris le drive de Pete Van Nostrand sur
l’autre original de Dmitry, «Over and Out», déjà présent sur l’album du même
nom.
On retrouve d’ailleurs sur Kid’s Time la formule pianoless qui caractérisait cet enregistrement de 2014. Cette fois ce sont les solides Clovis Nicolas et Jason Brown, autres partenaires familiers depuis l’époque
new-yorkaise, qui entourent Dmitry pour une session gravée en région
parisienne, le contrebassiste –installé Outre-Atlantique depuis vingt ans–
revenant régulièrement en France et le batteur y résidant depuis quelques
années. S’y ajoute, sur trois titres, un des grands noms de la scène jazz
française, Stéphane Belmondo venu dialoguer avec l’altiste. De l’absence de
piano résulte un son plus sec, dominé par le sax véloce de Dmitry (dès le
premier titre, «Mr. H.»), d’un côté, et le soutien rythmique de Jason Brown,
intense et robuste (en particulier sur «Time Files»), de l’autre. Moins exposé,
Clovis Nicolas ne demeure pas moins essentiel à l’architecture du trio, avec
aussi des prises de parole marquantes sur «Morningside Waltz» et «MTA». Quant à
la seconde voix portée par Stéphane Belmondo, elle amène de l’épaisseur, comme
sur «Soy Califa» de Dexter Gordon, un des trois titres qui n'est pas de la
main du leader. On ne peut que recommander l'écoute ces deux opus de Dmitry
Baevsky, musicien talentueux qui s’est bâti au fil du temps un univers bop
cohérent.
Jérôme Partage
© Jazz Hot 2023
|
  Orchid Big Band Orchid Big Band
Eclosion
Orchid Ouverture, Masque et tuba, Traversée du désert (et sa
tempête), La Machine d’Anticythère, We Miss the Forest Café: Interlude
improvisé, Jokari, Interstellar, Surfin’, Petite nuit, Nature Abstraction 1:
Matin calme
Thomas Julienne (lead), Gabriel Levasseur, Olivier Gay,
Laure Fréjacques, Julie Varlet (tp), Rozann Bézier, Sébastien Iep Arruti,
Gabrielle Rachel, Sébastien Llado (tb), Olga Amelchenko, Nora Kamm, Maxime
Berton, Jeanne Michard, Julien Dubois (s, fl, détail non précisé), Mathilda
Haynes (g), Clément Simon (p), Nolwenn Leizour (b), Gaétan Diaz (dm)
Enregistré à Hommes (Indre-et-Loire), date non précisée
(prob. 2022)
Durée: 59’ 45’’
Déluge 011 (www.collectifdeluge.org/Socadisc)
Issu du collectif «Déluge», créé en 2017 à Bordeaux pour
fédérer les musicien-nes de jazz entre l’Aquitaine et Paris, l’Orchid Big Band se
décrit comme une «jeune formation paritaire» (visiblement biberonnée au
discours normatif institutionnel) qui serait en outre «le chaînon manquant entre Thad
Jones et Stravinsky». «Vaste programme!» aurait répondu Mongénéral. L’orchestre
est dirigé par le contrebassiste-compositeur-arrangeur bordelais Thomas
Julienne, la trentaine, formé à Agen, Bordeaux et en Ile-de-France, notamment
par Gilles Naturel, Christophe Dal Sasso et Carine Bonnefoy. Il a depuis
participé à divers projets –jazz et danse, jazz et photo…– dont certains aussi dans d'autres esthétiques musicales. Par ailleurs, tous les musiciens du big band ne nous sont pas
inconnus, en particulier Sébastien Llado qu’on a entendu
depuis 2000 dans les big bands de François Laudet et Thierry Maillard, dans l’ONJ
de Claude Barthélemy ou auprès d’Archie Shepp, Cécile McLorin Salvant, Magic
Malik, Médéric Collignon, entre autres. On connaît également Olga
Amelchenko, ténor russe de 35 ans, établie à Paris depuis quelques
temps après des études musicales en Allemagne.
Sur un répertoire original, écrit par les membres du big
band, et dans l’ensemble de bonne facture, Orchid déploie une énergie swinguante
et des arrangements ciselés: «Orchid Ouverture» (Clément Simon), «Traversée du désert»
(Jeanne Michard), «Jokari» (Clément Simon), «Petite nuit» (Maxime Berton) ou
encore «Nature Abstraction 1: Matin calme» (Julien Dubois) sont effectivement bien
dans la filiation du Thad Jones-Mel Lewis Orchestra ou d’autres big bands
modernes comme celui de Maria Schneider. Autre bon thème, «La Machine
d’Anticythère» (Julien Dubois) propose une rencontre réussie entre jazz et
musique classique du XXe siècle. On
est moins convaincu par l’ouverture binaire de «Surfin’» (Sébastien Llado),
malgré un thème bien ficelé, ou le patchwork jazz symphonique-fusion
«Interstellar» (Thomas Julienne) qui abuse des répétitions du motif. Bien qu’un peu scolaire, le travail réalisé est de
qualité et ne manque pas de bonnes idées mélodiques et harmoniques.
Jérôme Partage
© Jazz Hot 2023
|
  Louis Hayes Louis Hayes
Exactly Right!
Exactly Right!, Is That So?, Hand in Glove, So Many Stars, Carmine's
Bridge, Nefertiti, Mellow D, Theme for Ernie, Scarborough Fair, Ugetsu
Louis Hayes (dm), Abraham Burton (ts), Steve Nelson (vib), David
Hazeltine (p), Dezron Douglas (b)
Enregistré les 16-17 décembre 2022, Paramus, NJ
Durée: 54’ 47”
Rentrer dans un disque de Louis Hayes, c’est la sensation de
se retrouver dans un bain de jazz à température idéale; tout y parfait, porté
par une conviction d’une telle fermeté qu’elle détermine une esthétique d’une
précision et d’un naturel intemporel. Il ne faut pas chercher loin les raisons
d’une telle réussite, le livret le dit en conclusion: «Cet album est l'histoire que Louis Hayes veut raconter sur le fait
d'être un musicien de jazz avec une histoire qui a commencé à Detroit, Michigan.
Sa philosophie est de jouer la musique en toute honnêteté avec des musiciens
qui ont le même feeling que lui. Selon Lou, l'album est «Exactly Right!».
Louis Hayes et le fondamental bassiste Dezron Douglas, sont
les producteurs de ce bel enregistrement, et les commentaires d’ Abraham Burton,
l’excellent ténor (magnifique sur «Is That So?») lors de la cérémonie où Louis
Hayes a été nommé Jazz Master en 2023 (National Endowment for the Arts),
reproduits dans le livret confirme que Louis Hayes a passé son message à ses (relativement)
jeunes compagnons comme un excellent messenger du jazz qu’il est: « Lou est fait de l’étoffe des plus grands, un
musicien qui vit la musique qu'il crée. Un de ceux dont la chaleur est toujours
au rythme du battement de ses tambours. Il insuffle la vie à chaque motif de sa
cymbale ride, le rendant unique dans sa conception et exquis dans son
exécution. Quand vous l'entendez, vous le sentez, et vous savez que cela ne
peut être que Lou.»
Louis Hayes faisait la couverture de Jazz Hot n°685 en 2018 et il faut se référer à ses propos, toujours très fermes et réfléchis, comme
souvent chez les musiciens de Detroit, pour comprendre la profondeur de ce
titre, Exactly Right!, qui correspond
si bien à sa personnalité soucieuse de perfection, d’honnêteté et d’intensité,
le point d’exclamation n’étant pas superfétatoire pour un batteur dont le
drive, la présence sont simplement magiques.
Le choix du répertoire est aussi précis que le reste, avec deux thèmes de Cedar Walton, dont «Ugetsu» qui fut un succès des Jazz
Messengers d’Art Blakey, de Duke Pearson, Wayne Shorter, Horace Silver, le beau
«Theme for Ernie», immortalisé par John Coltrane et ici magistralement repris
par Abraham Burton, un thème de David Hazeltine, «Carmine’s Bridge», in the spirit, enfin un traditionnel
festif trempé dans le blues qui devrait animer votre prochaine soirée dansante,
sans oublier le «Exactly Right!» qui ouvre l’album, une sorte de manifeste de
l’énergie du jazz où Steve Nelson et David Hazeltine, brillants, rivalisent
avec un leader omniprésent, pendant qu’Abraham Burton y va de ses riffs pour
lancer cette heure de jazz éternel, pétri de culture, comme sorti de l’âge
d’or.
Yves Sportis
© Jazz Hot 2023
|
  Eric Reed Eric Reed
Black, Brown, and Blue
Black, Brown, and Blue, Lean on Me*, I Got It Bad (and That
Ain't Good), Peace, Search For Peace, Christina, Infant Eyes, Cheryl Ann, Along
Came Betty, Variation Twenty-Four, One For E, Pastime Paradise°, Ugly Beauty
Eric Reed (p), Luca Alemanno (b), Reggie Quinerly (dm), Calvin
B. Rhone (voc)*,
David Daughtry (voc)°
Enregistré le 24 juin 2022, Van Nuys, CA
Durée: 1h 07’ 36”
Eric Reed a fait la couverture de Jazz Hot n°671, en 2015
en compagnie de la chanteuse Mary Stallings qu’il accompagnait alors. Il a
atteint aujourd’hui la cinquantaine, c’est un pianiste en pleine maturité de la
grande tradition du piano jazz qui propose toujours un abord original du
répertoire dans toute son étendue d’un siècle de jazz, de Duke Ellington à
Wayne Shorter en passant par Thelonious Monk, Horace Silver, McCoy Tyner, qui
compose également, ajoutant sa touche spiritual et soul comme ici, en
compagnie de deux vocalistes.
C’est ce qu’il propose avec cet album dont le titre fait
explicitement référence à Duke Ellington par un thème qu’Eric Reed a composé. On
retrouve la dimension churchy invariablement présente chez lui («Lean on Me») avec l’intervention d’un chanteur,
Calvin B. Rhone. Horace Silver est aussi présent avec une belle version de
«Peace», à laquelle succède le non moins émouvant «Search for Peace» de McCoy
Tyner, repris avec sensibilité par Eric Reed. La section rythmique est au
service du message limpide du pianiste, aux accents blues prononcés quel que
soit le thème et la couleur rythmique.
Il y a encore une composition, plus rare et non moins
réussie, de Buster Williams, «Christina», toujours sur un rythme médium-lent
qui semble être l’atmosphère de ce disque, atmosphère qu’on retrouve aussi bien
sur «Cheryl Ann» de Buddy Collette que sur «Infant Eyes» de Wayne Shorter.
«Along Came Betty», la splendide composition de Benny Golson immortalisée par
Art Blakey et Archie Shepp de manières assez différentes, est ici réinventée sur
un rythme légèrement bossa nova agrémenté des accents blues dans la manière
d’Eric Reed. Il y a aussi une composition de chacun des membres de la section
rythmique, «Variation Twenty-Four» de Reggie Quinerly, et «One for E» de Luca
Alemanno, toujours dans un mood assez doux, plus swing et mélodique pour le
second. Sur le thème de Stevie Wonder, «Pastime Paradise», il accompagne de façon magistrale David Daughtry, avant de finir sur «Ugly Beauty» de
Thelonious Monk, un compositeur qu’il a largement exploré dans une veine très
originale (The Adventurous Monk, en
2013, et The Dancing Monk en 2011
chez ce même label Savant Records), et cette version très swing, aussi surprenante
que réussie, restitue un Thelonious Monk dansant et joyeux, des facettes de ce
pianiste.
Yves Sportis
© Jazz Hot 2023
|
  Catherine Russell Catherine Russell
Send for Me
Did I Remember, Send for Me*, At the Swing Cats Ball, Make
It Last, Going Back to New Orleans, If I Could Be With You, You Can Fly High,
East of The Sun (and West of The Moon), In the Night, You Stepped Out of a
Dream, Blue and Sentimental, Sticks and Stones, Million Dollar Smile
Catherine Russell (voc, perc, hand claps*), Matt Munisteri
(g, bjo), Tal Ronen (b), Mark McLean (dm, tambourin) et selon les thèmes
Jon-Erik Kellso (tp), John Allred (tb), Philip Norris (tu), Evan Arntzen
(reeds), Aaron Heick, Mark Lopeman (ts), Paul Nedzela (bar), Mark Shane, Sean
Mason (p), Paul Kahn (hand claps)*
Enregistré les 10-11 juin, 4 et 14 septembre 2021, New York,
NY
Durée: 47’ 11’
Dot Time Records 9107 (https://dottimerecords.com)
Dans le prolongement direct de son précédent album, Alone Together, la grande chanteuse
Catherine Russell poursuit l’exploration de ses racines jazz et l’hommage à ses
parents: le pianiste et chef d'orchestre Luis Russell, évoqué dans la précédente chronique, a fait
l’objet d’une anthologie parue chez Dot Time Records; la guitariste,
contrebassiste et chanteuse, Carline Ray (1925-2013), elle même fille de
musicien et diplômée de la Juilliard
School débuta en compagnie d’Edna Smith (b) avec laquelle elle rejoignit le big
band féminin et non-ségrégé The International Sweethearts of Rhythm puis l’orchestre
d’Erskine Hawkins (tp). Elle se produisit ensuite dans des contextes divers
(jazz, latin, variétés, classique), comme les chœurs dirigés par Leonard
Bernstein et auprès de Mary Lou Williams. L’année de sa disparition, elle avait
publié le disque Vocal Sides produit
par sa fille.
Sur ce Send for Me, on retrouve autour de Catherine Russell une bonne partie des musiciens du
précédent opus, dont le guitariste Matt Munisteri, directeur musical du projet, et Jon-Erik Kellso, trompettiste qu'on entend régulièrement en compagnie de Rossano Sportiello, Scott Robinson ou Evan Christopher. On retrouve également un panorama de standards dont le choix, lié à l'histoire familiale de la chanteuse, est éclairé par le livret signé de l'historien du jazz et guitariste
Paul Kahn (l'époux de Catherine).
Ces thèmes ont un ancrage particulier dans le
blues et le musique de New Orleans. Le blues est d'abord présent dans l'expression de Catherine Russell, tout à son affaire pour évoquer la grande Billie Holiday avec «Did I Remember» dont
l’orchestration est très proche de la version de 1936. Blues
encore avec le bouillonnant «Send for Me», un titre popularisé par Nat King
Cole, qui est l’occasion de bons solos de Matt Munisteri à la guitare et de Sean Mason au piano. Blues toujours avec «Blue and
Sentimental», un classique de Count Basie, le chaloupé «Million Dollar
Smile» de Lionel Hampton qui fut enregistré par Dinah
Washington, ou encore le magnifique «In the Night» «Going Back to New Orleans» (Joseph C. Liggins) nous emmène
bien sûr du côté de Crescent City où le jeune Luis Russell débarqua de son Panama
natal en 1921. La même atmosphère irrigue «If I Could Be With You» –un thème de
James P. Johnson où s’illustre, à la manière de Louis Armstrong, Jon-Erik Kellso–, et «Sticks
and Stones» que Luis Russell avait gravé en 1937 aux côtés de Red Allen. New
Orleans est encore présente sur «You Can Fly High» d’Earl King, titre aux
résonances gospel (le piano de Mark Shane n’y est pas pour rien!). On retiendra enfin le très enlevé «At the Swing Cats Ball», co-écrit par
Luis Russell et William Campbell, une des moments intenses de ce superbe album de famille.
Jérôme Partage
© Jazz Hot 2023
|
  Bobby Watson Bobby Watson
Back Home in Kansas City
Back Home in Kansas City, Red Bank Heist, Our Love Remains*,
Bon Voyage, The Star in the East, Mind Wine, Celestial, Dear Lord, Side Steps, I'm
Glad There Is You, Blues for Alto
Bobby Watson (as), Jeremy Pelt (tp), Cyrus Chestnut (p),
Curtis Lundy (b) , Victor Jones (dm), Carmen Lundy (voc)*
Enregistré le 5 avril 2022, New York, NY
Durée: 1h 05’ 42”
Smoke Sessions Records 2205 (www.smokesessionsrecords.com/www.uvmdistribution.com)
Pour un amateur de jazz, la lecture des noms des
participants à cette session d’enregistrement organisée autour de Bobby Watson
suffit à générer l’impatience: il y a en effet des musiciens d’un niveau
exceptionnel sur chaque instrument. C’est donc un all stars, sans oublier
l’invitée d’un titre Carmen Lundy.
Le titre et premier thème de l’album, Back Home in Kansas City, renvoie précisément à Charlie Parker et sa ville natale, l’aîné sur
l’instrument et l’inspirateur de Bobby Watson. On n’en sera pas étonné si on se
remémore l’interview de Bobby Watson paru dans le Jazz Hot n°664 dont le saxophoniste faisait la couverture. Le second titre, «Red Bank Heist», un titre humoristique et
un blues de Victor Jones, remonte dans
le temps, malgré le registre plutôt hard bop de la musique elle-même, à l’un
des personnages illustres de la ville de Kansas City, Count Basie, «The Kid of
Red Bank», né à Red Bank dans le New Jersey mais qui est devenu un de ces Blue
Devils qui ont fait la légende de Kansas City, cf. les films The Last of the Blue Devils de Bruce Ricker
(1979) et Kansas City de Robert
Altman (1996). Cyrus Chestnut, ici présent, faisait d’ailleurs partie de la
distribution de Kansas City, mais pas
Bobby Watson…
Passés ces deux thèmes, on retrouve le climat habituel de
cette génération du jazz post bop fait de belles mélodies dans l’esprit de
Wayne Shorter-Art Blakey, avec quelques références solides comme John Coltrane
(«Dear Lord»), John Hicks («Mind Wine»), un traitement original d’un magnifique vieux
thème, «I’m Glad There Is You» de Jimmy Dorsey et Paul Madeira, et quelques
compositions de ses sidemen du jour et du
leader, dont le remarquable «Blues for Alto» qui clôt cet album.
Ces all-stars d’artistes aussi complices qui représentent la
permanence de la tradition du jazz la plus authentique, qui a les pieds dans
l’histoire et la tête dans les nuages de la création, sont ce que le jazz
propose de plus profond et novateur au XXIe siècle, même s’il est certain que
ni le public des scènes dites «de jazz», ni la plupart de la critique dite «de
jazz» ne sont en état de l’apprécier, par manque de références culturelles et
parce que ces musiciens ne sont pas suffisamment présents sur les scènes
internationales dites «de jazz». Il reste ce bon travail de quelques rares
labels pour prolonger cette queue de la comète du jazz et l’illusion que Bird is alive.
Yves Sportis
© Jazz Hot 2023
|
 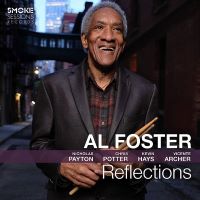 Al Foster Al Foster
Reflections
T.S. Monk, Pent-Up House, Open Plans, Blues on the Corner, Anastasia,
Six, Punjab, Beat, Alone And I, Half Nelson, Monk's Bossa
Al Foster (dm), Nicholas Payton (tp), Chris Potter (ts, ss),
Kevin Hays (p, clav), Vicente Archer (b)
Enregistré le 25 janvier 2022, New York City, NY
Durée: 1h 07’ 49”
Chez Smoke Sessions Records, on aime le jazz de culture, et
dans l’ensemble, c’est une vraie ligne éditoriale garantissant des
enregistrements de qualité. Ici, Al Foster qui faisait la couverture de Jazz Hot n°670 et qui a fêté ses 80 printemps en ce début d’année 2023, a réuni autour de lui
d’excellents musiciens pour un hommage délicat à Thelonious Monk, inventif avec deux originaux du batteur –le premier et le dernier thèmes–, le reste
proposant des compositions historiques du jazz comme le «Pent-Up House» de Sonny
Rollins, «Blues on the Corner» de McCoy Tyner, «Punjab» de Joe Henderson, «Half
Nelson» de Miles Davis, «Alone and I» d’Herbie Hancock… Que du premier choix,
pourrait-on dire, car ces titres sont effectivement parmi les grands thèmes des
géants du jazz qu’Al Foster a côtoyés avec son jeu si délicat, musical, aérien
sur les cymbales. C’est donc un hommage à la génération du jazz avec laquelle
le batteur a débuté et grandi avant d’en devenir un membre accompli. A côté, les trois morceaux de Chris Potter («Open Plans»), de Nicholas Payton («Six») et de Kevin Hays («Beat») semblent plus «pâles», sans
doute une question de génération, d’autant qu’en dehors des deux thèmes
consacrés à Thelonious Monk, très réussis, Al Foster donne un «Anastasia» doté
d’une belle mélodie. Le goût de la mélodie se perd quelque peu devant celui de
l’harmonie dans les générations plus jeunes. Cela dit, les musiciens sont très investis dans ce projet
d’Al Foster, et chacun apporte son talent à une heure de musique de qualité,
expressive, avec ce qu’il faut de blues et de swing, avec la belle trompette de
Nicholas Payton, la sonorité aérienne de Chris Potter et la délicatesse d’une
section rythmique de qualité. L’univers est plutôt celui de Miles Davis ou de
ses enfants, ça n’étonnera pas venant d’Al Foster (cf. son interview déjà citée). Le thème de Nicholas Payton en est
le témoignage pour la partie la plus récente, comme «Half Nelson» rappellera à
ceux qui l’ont oublié l’auteur de belles mélodies qu’a aussi été Miles Davis,
au-delà de la sonorité qui a été à la base de sa légende.
Yves Sportis
© Jazz Hot 2023
|
  Nicola Sabato Nicola Sabato
California Hang
These Are Soulful
Days, The Masquerade Is Over, Brigas Nunca Mais, Bad Motor Scooter Blues,
Jingles, I Guess I'll Hang My Tears Out to Dry, Happy Go Lukey, Buhaina
Buhaina, L.A. Bounce
Nicola Sabato (b),
Graham Dechter (g), Tamir Hendelman (p), Jeff Hamilton (dm)
Enregistré les 13-14 novembre 2021, Los Angeles, CA
Durée: 52’ 09’’
Autoproduit NSM 006
(www.nicolasabatojazz.com)
Nicola Sabato aime
le jazz de culture et va avec constance à la rencontre de ses interprètes au-delà de l'océan. On pense notamment à Harry Allen dont il a longtemps
organisé les tournées françaises, ou Mandy Gaines qu’il accompagne lors de ses
venues estivales. C’est encore le cas avec le grand Jeff Hamilton qu’il avait
déjà invité sur un précédent album, Lined
With a Groove (Djaz Records, 2006, cf.
Jazz Hot n°647) et qu’on retrouve sur ce Californa Hang enregistré à Los Angeles où vit l’ancien sideman de
Ray Brown auquel Nicola ne cesse de rendre hommage au fil de ses disques. Le
livret nous apprend d’ailleurs que Nicola, cherchant une contrebasse pour la
session, s’est vu prêter celle du maître! L’hommage est cette fois irrigué par le groove solaire et décontracté de la Santa Monica Bay présent
tant dans le jeu coloré de Jeff Hamilton que dans celui des excellents Tamir
Hendelman et Graham Dechter, musiciens familiers du batteur. Nous avions déjà
rencontré Tamir Hendelman dans le précédent opus de Nicola Sabato, Bass
Tales… Le pianiste, né à Tel-Aviv en 1971 et installé aux Etats-Unis
depuis 1984, a remporté à l’âge de 14 ans la Yamaha's National Keyboard Competition
donnant ainsi ses premiers concerts au Japon et au Kennedy Center de
Washington. Il débute son activité professionnelle en 1996 à Los Angeles,
collaborant notamment avec Natalie Cole et Barbra Streisand, avant de rejoindre en
2000 le trio de Jeff Hamilton qui l’embarque dans le Clayton-Hamilton Jazz
Orchestra et auprès de Diana Krall. En 2008, Tamir enregistre un disque en trio
avec Jeff Hamilton et John Clayton, Playground(Swingbros Co.).
La même année, Graham Dechter utilisait pour son compte
cette rythmique sur son premier disque en leader, Right on Time (Capri). Le guitariste de 37 ans, originaire de la
région de Los Angeles, a commencé l’apprentissage du violon dès 5 ans avant de
découvrir le jazz et d’étudier avec Marshall Hawkins (b, 1939) –notamment connu
pour avoir succédé à Ron Carter au sein du Second Great Quintet de Miles Davis–
et Jim Fox (g). A 19 ans, il intègre le Clayton-Hamilton Jazz Orchestra à
l’invitation de Jeff Hamilton et, en parallèle, parfait son expérience en
compagnie de Benny Golson, James Moody, John Pizzarelli, Benny Green ou encore
Wynton Marsalis. Six compositions du
jazz et trois originaux du leader constituent ce disque dont le bel équilibre
repose sur chacun des membres du quartet. Dès le premier titre, «These Are
Soulful Days», ouvert par les roulements de Jeff Hamilton, l’énergie est de mise. La
guitare bluesy de Graham Dechter répond au swing petersonien de Tamir
Hendelman, tandis que Nicola Sabato glisse quelques phrases mélodiques. Le swing permanent repose tant sur les lignes de basse robustes de Nicola Sabato («The Masquerade Is Over» d'Allie Wrubel) que sur le drive extraordinaire de Jeff
Hamilton («Jingles» de Wes Montgomery qui met à l’honneur le
guitariste). L’album distribue aussi des nuances latines («Brigas Nunca Mais» d’Antonio Carlos Jobim) ou
blues («Bad Motor Scooter Blues» de Nicola Sabato) et évoque bien sûr Ray Brown avec
son «Buhaina Buhaina».
Jérôme Partage
© Jazz Hot 2023
|
  Buster Williams Buster Williams
Unalome
Stairways, Estate, Tayamisha, In the Middle of a Rainbow, The
Wisdom of Silence, 42nd Street, I've Got the World on a String, Here's to Life
Buster Williams (b), Jean Baylor (voc), Bruce Williams (s,
fl), Stefon Harris (vib), George Colligan (p), Lenny White (dm)
Enregistré les 26-27 avril 2022, New York, NY
Durée: 51’ 22”
Buster Williams est généreux et aime les chanteuses de
longue date, auxquelles il apporte le soutien de sa basse chantante, sans doute
depuis qu’il a croisé la route de Sarah Vaughan qui lui a offert la basse de
ses rêves, et depuis qu’il a accompagné parmi les plus grandes chanteuses dont Nancy
Wilson, Betty Carter, Shirley Horne, Carmen Lundy et beaucoup d’autres. On le
sait depuis son interview dans Jazz Hot
n°581, en 2001, et
plus encore depuis le film que lui a consacré Adam Kahan, Bass to Infinity.
Accompagnateur de légende de ce que le jazz a de plus remarquable depuis les
années soixante, on le retrouve ici encore en 2022, entouré de musiciens de talents
et admiratifs de leur aîné, Bruce Williams, Stefon Harris et George Colligan, avec
un complice de longue date, Lenny White, pour offrir un enregistrement très
jazz à Jean Baylor, une chanteuse qui a débuté dans les années 1990 dans un
registre plus grand public entre soul, rhythm & blues et hip hop (Zhané, un
duo avec Renée Neufville et Jean Norris, devenue par la suite Jean Baylor par
mariage avec Marcus Baylor, le batteur des Yellowjackets. Le duo a été notamment
édité par Epic et Motown), et qui depuis a créé avec son époux le Baylor Project,
largement récompensé, dans un esprit jazz
in the tradition, avec notamment Eric Reed (p), Dezron Douglas (b) et Keith
Loftis (ts) et bien sûr Marcus Baylor (dm) ( cf. Festival de Moers 2015) Ce disque, dont le titre fait référence aux convictions du
leader, est, sur le livret, un disque de Buster Williams, mais il met en valeur
avec générosité la chanteuse, qui possède les qualités de blues et d’expression,
avec quatre compositions du leader et quatre standards bien choisis. Buster
Williams intègre la chanteuse comme une musicienne de plus, dans des
arrangements où chacun a ses moments d’expression, lui-même «se contentant»
d’introduire, de soutenir, d’enrichir et quand on connaît la splendide sonorité
de Buster Williams («Here’s to Life»), son sens de la mélodie, on sait qu’il
tire la musique vers le haut. Ainsi la voix de Jean Baylor devient un élément
de la texture du groupe («Stairways») comme le vibraphone de Stefon Harris, le
piano de George Colligan ou le saxophone de Bruce Williams et alternativement
soliste («Estate», «42nd Street»), selon les moments. Avec générosité et sans
doute un grand plaisir, les deux anciens Buster Williams et Lenny White sont
aux petits soins pour mettre en valeur les plus jeunes, Jean Baylor mais aussi
Bruce Williams, Stefon Harris et George Colligan. Le résultat est très réussi, de
la belle musique naturelle et pourtant sophistiquée, même sur cette bossa nova
très italienne, «Estate», pourtant si jouée, qui retrouve ici une fraîcheur naturelle.
Seule petite critique, le premier thème «Stairways», une
composition de Buster Williams où justement la voix est particulièrement
intégrée au son d’ensemble, est shuntée avant son terme.
On écoute avec intérêt le traitement original et pourtant dans la tradition de
«I've Got the World on a String» et «Here’s to Life» met en valeur le fond soul de la voix de Jean Baylor hérité de son parcours.
Smoke Sessions Records continue d’honorer le jazz de
culture; on leur souhaite une longue vie, le jazz a un besoin essentiel après
l’épisode covid de labels de cette qualité capables d’offrir au jazz de culture
l’espace d’expression dont il manque depuis sur les scènes du monde entier, la
pauvreté des programmes des festivals en Europe en témoigne.
Yves Sportis
© Jazz Hot 2023
|
  Bacos Hot 7 Cruisers Bacos Hot 7 Cruisers
Bacos Hot 7 Cuisers
Drummer’s Delight, After You’ve Gone, You Can’t Have Your
Cake and Eat It, Diga Diga Doo, Two Sleepy People, Peckin’, I Would Do Anything
for You, Below the Azores, Who’s It, Prelude to a Kiss, Linger Awhile,
Oo-Shoo-Bee-Doo-Bee, The Sphinx, Krum Elbow Blues, Downtown Uproar/Coquillages
et crustacés
Patrick Bacqueville (tb, voc, sifflet), Malo Mazurié (tp),
Esaie Cid (as, cl), Nicolas Peslier (g, bjo), César Pastre (p), Sébastien Girardot (b), Guillaume
Nouaux (dm)
Enregistré live le 15 septembre 2022, Auditorium de La
Garenne-Colombes (Hauts-de-Seine)
Durée: 55’ 59’’
Ahead 841.2 (Socadisc)
Cela fait plus de quarante-cinq ans que Patrick Bacqueville apporte son énergie et sa fantaisie à tout ce que le courant jazz dit
«classique» compte d’orchestres, notamment ceux de Maxim Saury, Gérard Badini,
Marcel Zanini, Olivier Franc, François Biensan, Nicolas Montier, Michel Bonnet,
sans oublier ses propres formations comme ce Bacos Hot 7 Cruisers dont il nous
relate la création dans le livret: embarqué en avril 2019 sur
une croisière jazz par Jean-Pierre Vignola –programmateur émérite,
organisateur de tournées et aussi fondateur du label Ahead– ce dernier lui
demande de monter au débotté un orchestre swing pour un concert «bonus» en recrutant
quelques-uns des musiciens présents à bord. On appelle ça un «orchestre
téléphone», constitué en quelques coups de fil pour une occasion précise
(comme récemment encore au Caveau de La Huchette). Jean-Pierre Vignola faisant bien les
choses, se trouvent à bord quelques-uns des compagnons habituels du
tromboniste, par ailleurs rompus à l’interprétation du répertoire. C’est donc
très facilement que celui-ci improvise un septet dans l’esprit du mythique Hot
Seven de Louis Armstrong, faisant le ravissement des croisiéristes amateurs de jazz. Content
de son bon coup, «Bacos» conserve la formule et la propose dans les festivals
et scènes jazz. Une vingtaine de concerts plus tard, pause covid comprise, le
Hot 7 marin de l’ami Bacqueville grave à l’automne 2022 un live des plus réjouissants. Il faut dire qu’avec de tels ingrédients, il était
difficile de rater la mayonnaise! Les musiciens sont tous excellents et jouent
le hot dans la grande tradition. Malo
Mazurié demeure phénoménal par sa maturité et son expressivité (magnifique «Two Sleepy People»), Esaie Cid possède un son superbe, tout en rondeur à l’alto et en intensité à la clarinette (quel
solo sur «Diga Diga Doo»!). Le soutien rythmique est parfaitement assuré par
Nicolas Peslier, en particulier au banjo, avec aussi de belles phrases bluesy à
la guitare (introduction de «Two Sleepy People»), par César Pastre qui donne à
l’ensemble un relief supplémentaire par son jeu ancré dans le blues et le stride («I Would Do
Anything for You»), par le très musical Sébastien Girardot et par le
solide Guillaume Nouaux en maître du tempo: toute la section rythmique est
formidable sur «Diga Diga Doo». Quant au leader, au jeu toujours très profond,
il sait susciter l’émotion sur les ballades («Prelude to a Kiss»), se faire
aussi facétieux (citation du thème de La
Panthère rose sur le chaloupé «Below the Azores») et amène
de la légèreté par ses interventions vocales à la Louis Prima («After You’ve Gone»). Alternant
standards et originaux méconnues, le Bacos Hot 7 Cruisers fait ainsi
vivre le répertoire avec fraîcheur. Un vrai bonheur!
Jérôme Partage
© Jazz Hot 2023
|
  Emmet Cohen Emmet Cohen
Uptown in Orbit
Finger Buster, Uptown
in Orbit*, My Love Will Come Again*, Spillin' the Tea, Li'l Darlin', The
Loneliest*, Uptown in Orbit* (reprise), Distant Hallow*, Mosaic, Venus De Milo,
Braggin' in Brass
Emmet Cohen (p), Russell Hall (b), Kyle Poole (dm), Patrick
Bartley (as)*, Sean Jones (tp)*
Enregistrés les 1-2 décembre 2021, New York, NY
Durée: 56’ 48”
Mack Avenue 1195 (www.mackavenue.com)
Dans le jazz, deux artistes ont activement lutté contre la mise à mort
du jazz et plus largement de toute vie culturelle et humaine, orchestrée par
les pouvoirs en Occident, dans l’opération baptisée «covid 19». Ces deux artistes, si rares dans le monde du jazz à avoir
réagi avec leurs moyens d’artistes, sont tous les deux de bons pianistes de
jazz, dotés d’une vision encyclopédiste du jazz, et ont eu l’idée et la force
de contourner le diktat de silence imposé en organisant des rendez-vous en live, des jam-sessions filmées,
construites avec des invités, musiciens de qualité, des sortes de rent parties, plus seulement pour payer le loyer,
mais pour maintenir de véritables bulles d’oxygène, bulles d’expression, pour
le jazz et les artistes qui ont la chance d’y participer, en associant le
public urbi et orbi grâce à internet,
car il ne s’agissait pas de gagner sa vie mais de sauver son humanité. Tant
d’artistes sont simplement morts d’être enfermés dans l’anonymat et
l’indifférence qu’on n’est pas près de comprendre à quel point ces deux initiatives,
au cœur de New York –l’un des centres de cette ignominie– étaient subversives, une
manifestation de résistance d’une grande portée philosophique, pour la liberté,
l’indépendance.
L’un est italien d’origine, new-yorkais d’adoption, Rossano
Sportiello, avec ses rendez-vous en direct sur son site, Live at the Flat in Greenwich Village, c'est ainsi que Rossano les appelle, qui en sont à leur 96 e épisode. L’autre est Emmet Cohen, l'inventeur du concept dès avril 2020 sur YouTube, avec ses 108 Live From Emmet’s Place,
rendez-vous at home autour du trio
maison d’Emmet Cohen, Russell Hall et Kyle Poole, ce dernier coproducteur de ce
disque avec Emmet, les trois musiciens invitant une pléiade d’artistes
exceptionnels du jazz qu’on ne citera pas, il y en a des centaines. Malgré la reprise des tournées en 2022, l'expérience continue, et des millions de personnes dans le monde se sont
connectées à ces moments, sans aucun fondement commercial ou de mode,
simplement pour respirer quelques bulles de liberté. Dans ces deux îlots sont passés entre autres Houston Person,
Paquito D’Rivera, Kenny et Peter Washington, Russell Malone, et on arrête là
une longue liste d’artistes de tous les âges et de toutes les notoriétés, qui a
été et reste une rare respiration salvatrice de l’esprit du jazz, si absent de
ces deux années, de l’ensemble des scènes qui retransmettent une atmosphère délétère, avec et sans masque, qui perdure même
après le covid, même dans une bonne partie de ce qui se réclame du jazz. Cette
initiative est restée isolée chez les acteurs du jazz, quelle que soit leur
nationalité, comme si ce décret du covid avait réussi à museler une expression
née dans la résistance à l’esclavage, le pire des arbitraires, et dans une recherche de liberté de par le
monde qui portent en elles des risques, de mort parfois, et depuis des siècles,
risques et urgence, dans lesquels le jazz a puisé sa force et sa substance, ce qui
en a fait l’art musical essentiel du XXe siècle. Emmet a d’ailleurs été l’invité de Rossano en même temps que
Johnny O’Neal, l’un de ses maîtres, car Rossano et Emmet complices dans le
projet comme dans la vie, entretiennent une sorte de correspondance musicale,
l’un et l’autre aimant la musique, le jazz et le piano en particulier, comme des artistes,
au-delà de tout danger, respectueux en cela et dignes de leurs prédécesseurs
qui comme tant d’artistes ont risqué leur vie entière pour exprimer ce qu’ils
avaient au fond du cœur.
Uptown in Orbit est un titre porteur de sens en référence à cet Uptown de New York, le quartier
où se sont déroulées ces réunions Live from
Emmet’s Place. Le bâtiment du 555 Edgecombe du quartier de Sugar Hill, au
nord de Manhattan, a abrité Count Basie, Duke Ellington, Coleman Hawkins, Lena
Horne, et un peu plus loin Sonny Rollins, parmi beaucoup d’autres artistes, de
jazz et pas seulement. C’est cet esprit de résistance des Anciens, cet instinct
de vie et de création, qu’ont voulu réactiver, dans ce quartier, le jeune
pianiste et ses deux complices bassiste et batteur, dans leurs émissions, leur
musique, dans ce disque, et il suffit d’écouter avec attention pour en saisir
la portée. Uptown in Orbit (urbi et orbi, donc, on n’est pas à Rome
mais à New York), c’est un peu le refus de cette mort décrétée par un pouvoir
mondialisé, une déclaration de vie et une volonté d’expression faite à la ville
et au monde. Emmet et Rossano partagent cette idée que l’art n’a pas
d’âge; tout art est moderne, toujours, comme nous l’écrivons depuis pas mal
d’années. Le premier thème, de Willie Smith the Lion, rappelle que New York fut
la ville de pianistes extraordinaires, et le traitement, à la fois classique et
avec les bruits de l’aiguille dans le sillon, avec la personnalité d’Emmet de
2023, confirme l’intention d’associer l’esprit des Anciens à cette affirmation
de vie, comme «Li’l Darlin’» de Neal Hefti, immortalisé par Count Basie,
«Braggin’ in Brass» de Duke Ellington, ou «Mosaic» de Cedar Walton et «Venus de
Milo» de Gerry Mulligan. Il y a aussi la vie d’aujourd’hui, la musique d’Emmet Cohen,
cinq compositions dont «Uptown in Orbit», une de Russell Hall («The Loneliest»),
et ce trio qui nous a enthousiasmés pendant l’enfermement du covid et après, et
qu’on retrouve ici avec ses qualités: le jeu brillant d’Emmet Cohen, qui malaxe
ce qu’il y a de meilleur dans l’histoire du jazz et du piano pour en faire sa
création, le drive de Russell Hall qui relance et encadre cette exubérance
maîtrisée du pianiste, et le sens musical de Kyle Poole qui est comme la toile
de fond qui sous-tend ce trio, lui donne de la chair. Sur cet enregistrement et
pour cinq thèmes, comme pour les Live
from Emmet’s Place, il y a des invités: Patrick Bartley, indiqué
saxophoniste alto (brillant sur cet instrument), qui semble jouer aussi du ténor
sur le beau «Uptown in Orbit» (deux prises), et Sean Jones apportent cette
dimension de l’échange et de la découverte, et donc une énergie supplémentaire
comme lors de ces sessions d’Emmet’s Place.
Le disque s’écoute bien sûr sans nécessité de réfléchir à
tous ces aspects, c’est du bon jazz, trempé dans le swing et le blues, couleur
new-yorkaise, mais apprécier pleinement une œuvre et un artiste consiste aussi
à essayer d’approcher son cheminement, à le supposer parfois, ça apporte des
dimensions supplémentaires à la sensibilité, ça fait partie de l’échange, et
c’est particulièrement vrai dans le jazz, une musique de la vie, populaire.
Yves Sportis
© Jazz Hot 2023
|
  Alexis Tcholakian / Lilian Bencini Alexis Tcholakian / Lilian Bencini
Dialogos: Live in Marseille
How Deep Is the Ocean, Someday My Prince Will Come, Easy
Living, Rachid, I Remember Clifford, Lucie’s Perfume, Elm
Alexis Tcholakian (p), Lilian Bencini (b)
Enregistré live le 21 mai 2022, Roll’Studio, Marseille
(Bouches-du-Rhône)
Durée: 1h 02’ 34’’
Camille Productions MS012023 (www.camille-productions.com/Socadisc)
Nous avions rencontré Alexis Tcholakian à l’automne 2021, en
pleine crise sanitaire et démocratique. Il avait été parmi les rares artistes à protester contre la politique liberticide et à refuser de jouer devant
un public ségrégué (on a déjà oublié ces contrôles honteux de vaccination à l'entrée des clubs quand ils se sont réouverts). Une réaction courageuse qui aurait dû être une évidence pour
le monde du jazz, à Paris comme à New York, mais force est de constater que le
conformisme et la soumission (cf. George Orwell) ont depuis longtemps colonisé les têtes, fussent-elle sensibles
à la note bleue. Six mois plus tard, la masqu’arade ayant pris fin, Alexis Tcholakian reprenait le cours de sa vie musicale et donnait
au Roll’Studio, un club associatif de Marseille, un superbe concert, en duo
avec un contrebassiste bien connu dans la région: l’excellent Lilian Bencini, qui
fait partie de son trio complété par le batteur Cédrick Bec. On entend sinon
régulièrement Lilian Bencini aux côtés, entre autres, de Laure Donnat, Perrine
Mansuy, Jean-Pierre Como ou Fred Pasqua.
Le disque issu de ce concert renferme une heure de beauté
jazzique mitonnée dans l’intimité d’un duo complice, avec la respiration du live qui donne à la musique une
proximité immédiate. Tout est magnifique, de la première à la dernière note, à
commencer par le thème inaugural, «How Deep Is the Ocean» (Irving Berlin),
comme une évasion vers le large –nous sommes dans un port!– après les mois
d’enfermement. Introduisant le morceau en piano solo, Alexis déploie un jeu
aéré et perlé, plein de swing, qui rappelle Cedar Walton, une de ses
inspirations. A partir de «Someday My Prince Will Come» (Frank Churchill/Larry
Morey) –un petit bijou de subtilité– le dialogue promis s’engage véritablement entre le
pianiste et le bassiste dont le son boisé apporte beaucoup de profondeur. On entend
aussi par moment Lilian Bencini scatter les notes, comme sur «Easy Living» (Leo
Robin/Ralph Rainger), où il donne un solo tout en musicalité. Comme un peintre
qui trace au fil du pinceau différentes nuances, Alexis Tcholakian nous emmène ensuite
vers le gospel avec «Rachid» de Michel Petrucciani, tandis que le blues
affleure sur «I Remember Clifford» (Benny Golson). Le pianiste a par ailleurs
glissé un original (du moins nous le subodorons, car le livret ne fait pas
mention des noms des compositeurs), une élégante ballade, «Lucie’s Perfume»,
qui se fond parfaitement dans l’ensemble. Enfin, Alexis Tcholakian et Lilian
Bencini achèvent leur conversation dans une atmosphère de rêverie dessinée avec
beaucoup de sensibilité sur «Elm», un joli thème de Richie Beirach.
Encore un disque de grande qualité qui s’ajoute au
catalogue de Camille Productions qui doit sa diversité aux oreilles affutées de
Michel Stochitch.
Jérôme Partage
© Jazz Hot 2023
|
  The Grasso-Ravita Jazz Ensemble The Grasso-Ravita Jazz Ensemble
Jagged Spaces
Jagged Spaces, Her Life Incomplete,
Songhai, Blue Sunshine, Circles, All About Cynthia, Latin for Leandro, The
Homecoming, Chasing Shadows
Skip Grasso (g), Phil Ravita (b, eb),
Benny Russell (ts, ss), Greg Small (p), Nuc Vega (dm)
Date et lieu d’enregistrement non
communiqués (prob. 2019-2020)
Durée: 1h 00’ 46’’
Cité portuaire du Maryland située au
nord de Washington, DC, Baltimore abrite une scène jazz dont nous parviennent régulièrement
les échos. C’est bien sûr la ville du pianiste Eubie Blake (1883-1983) en mémoire
duquel y a été fondé, après sa mort, l’ Eubie Blake National Jazz Institute and
Cultural Center. C’est également à Baltimore que Todd Barkan a créé en 2019 un
nouveau Keystone Korner avec une programmation de haut niveau. Quant aux
musiciens locaux qui évoluent entre Baltimore et Washington, voire au-delà, le
long de la Côte Est, nous en avons ponctuellement connaissance par les sorties
de disques. Il en va ainsi du Grasso-Ravita Jazz Ensemble, quintet créé et
codirigé par le guitariste Skip Grasso et le contrebassiste Phil Ravita. Le
premier a suivi un cursus universitaire et a également étudié avec le pianiste
Charlie Banacos (1946-2009), sur les conseils de Mike Stern qui fut également
son élève. Il a participé à diverses formations en sideman, dans le jazz et à
côté. Il est aussi enseignant, notamment à la Mount Saint Mary’s University à Emmitsburg,
MD, tout comme Phil Ravita qui paraît davantage implanté dans les institutions
(universités et orchestres) et a appartenu, de 1999 à 2013, au Baltimore
Philharmonia Orchestra où a joué aussi Skip Grasso. Par ailleurs, Phil Ravita
dirige son propre ensemble, Ravita Jazz, compose et présente une émission jazz hebdomadaire sur une radio locale. Le reste du groupe est complété par le pianiste (et
aussi trompettiste) Greg Small, le batteur Nucleo (ou Nuc) Vega –qui partagent
également leur activité entre concerts et enseignement–, et le saxophoniste Benny
Russell que nous avions déjà présenté dans une chronique consacrée à un
autre groupe de la région.
Ce Jagged
Space repose sur les compositions du quintet, surtout des deux coleaders, à
commencer par le morceau éponyme (Skip Grasso) qui ouvre l’album avec un jazz
post-bop nerveux dont l’intensité doit à la fois à la section rythmique –et en
particulier à la pulsation maintenue par la batterie– et à l’attaque du saxophone
(ici soprano), sans oublier le solo énergique de Skip Grasso (guitare
électroacoustique) qui parachève cette bonne entrée en matière. Cette intensité
inspirée des plus fameuses références du catalogue Blue Note des années 1950
traverse une grande partie du disque. Autre morceau très réussi, «Blue Sunshine»
(Phil Ravita) donne l’occasion d’apprécier à se juste valeur le beau son rond
de Benny Russell au ténor, lequel nous tient en haleine tout du long avec de ses
montées en gamme qui flirtent avec le free. Les ambiances varient selon les
titres, comme sur «Latin for Leandro», aux accents caribéens, où Skip Grasso intervient
longuement dans l’esprit Grant Green, ou la jolie ballade «All About Cynthia» qui
met en avant le superbe toucher de Greg Small qui ne manque jamais de swinguer. Egalement de bonne facture, «The Homecoming» (Skip Grasso) évoque directement
les Jazz Messengers.
Du jazz de création connecté à l’Histoire,
servi par des interprètes solides qui mériteraient d’élargir leur audience.
Jérôme Partage
© Jazz Hot 2023
|
  Ed Cherry Ed Cherry
Peace
In a Sentimental Mood, Kōjō no Tsuki, Tres palabras, Edda,
Peace, Road Song, Ugly Beauty
Ed Cherry (g), Darryl Hall (b), Greg Hutchinson (dm)
Enregistré le 21 octobre 2019, Clermont-Ferrand
(Puy-de-Dôme)
Durée: 1h 03' 22”
Space Time Records 2252 (Socadisc)
Le festival Jazz en Tête de Clermont-Ferrand, où est
enregistré ce disque, en était en 2022 à sa 35 e édition, et son directeur, Xavier Felgeyrolles, par
ailleurs responsable du bon label Space Time Records, s’attache depuis sa
création à défendre le jazz de culture, avec un souci, à l’ancienne, de faire
découvrir des musiciens rares, de haut niveau, mais peu exposés en Europe,
comme ceux de la galaxie de Memphis, Donald Brown & Family en particulier.
Il confirme ce flair de passionné de jazz avec la venue, en 2019, d’Ed Cherry,
guitariste original dans la tradition de son de Wes Montgomery, un son chaud et
au pouce semble-t-il à l’oreille, qui est surtout connu en Europe pour sa
longue collaboration avec Dizzy Gillespie de 1978 à 1993.
Né le 12 octobre 1954 à New Haven, dans le Connecticut, Ed
Cherry a aussi côtoyé d’autres musiciens de l’univers de Dizzy, comme Jon
Faddis, Paquito D’Rivera avec qui il a enregistré, mais également Roy Hargrove et,
par ailleurs, dans l’univers du free jazz Hamiet Bluiett (un disque) et Henry
Threadgill (trois disques), comme le monde des formations guitare-orgue hammond
de son inspirateur, Wes Montgomery. Il a ainsi enregistré avec Big John Patton, Dr. Lonnie
Smith, Reuben Wilson, Jared Gold, Brian Charrete, une musique qui appartient à
la grande tradition d’un jazz où le blues est la matière essentielle.
Ce disque, Peace, enregistré
en 2019 et publié en 2022, s’insère dans une petite discographie en leader (une
dizaine d’albums), commencée à la mort de Dizzy Gillespie avec First Take (label Groovin High). Dans
les années 2010, Positone a publié deux de ses derniers albums: It's All Good (2012) et Soul Tree (2016). Après l’album Peace, en 2019, Ed Cherry a enregistré
en 2022 Are We There Yet? (Cellar
Live), et on espère vous en parler bientôt. Ici, dans un trio
guitare-basse-batterie, il déploie toute ses qualités de son et de
mélodiste avec de formidables musiciens, Darryl Hall, qu’on connaît bien en
France, auteur de beaux chorus, et Greg Hutchinson, batteur élégant d’une
musicalité certaine, parfait dans ce contexte. On apprécie particulièrement la
sonorité chaude, l’omniprésence des accents du blues, qui convient si bien à ce
répertoire très mélodieux, non seulement la révérence attendue à Wes Montgomery
(«Road Song») mais aussi «Ugly Beauty» de Thelonious Monk, «In a Sentimental
Mood» de Duke Ellington, le splendide «Peace» d’Horace Silver, «Edda» de Wayne
Shorter… Ed Cherry n’a choisi que de belles mélodies et de grands compositeurs,
comme «Tres palabras» d’Osvaldo Farrés, un compositeur cubain (1902-1985), où
son délicat toucher de guitariste fait merveille. La petite surprise, the Cherry on the cake, dans cet
enregistrement, sera «Kōjō no Tsuki» de Rentarō Taki, un compositeur japonais
du XIX e siècle (1879-1903), déjà
reprise par Thelonious Monk dans l’album Straight
No Chaser, sous le titre «Japanese Folk Song», où Ed Cherry fait briller sa
sonorité aux accents d’un Japon bleu dans une version de plus de 12 minutes,
brillamment soutenu par Darryl Hall et Greg Hutchinson, magnifiques tous les
trois de musicalité.
Pour information, signalons qu’Ed Cherry, perfectionniste
jusqu’au bout du pouce, joue entre autres sur des guitares fabriquées par l’un
des derniers luthiers traditionnels d’Amérique du Nord, canadien, Wyatt Wilkie
(Wilkie Guitars), avec lequel il collabore depuis des années.
Yves Sportis
© Jazz Hot 2023
|
 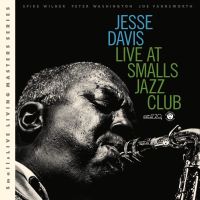 Jesse Davis Jesse Davis
Live at Smalls Jazz Club
Gingerbread Boy, Ceora, Cup Bearers, These Foolish Things, Juicy
Lucy, Rhythm-A-Ning, Street of Dreams, Love for Sale
Jesse Davis (as), Spike Wilner (p), Peter Washington (b),
Joe Farnsworth (dm)
Enregistré le 17 février 2022, New York, NY
Durée: 1h 08’ 02”
Cellar Music SLF005 (www.cellarmusicgroup.com)
  The Hitters The Hitters
The Heavy Hitters
Hub, A New Day, Silverdust, Un Dia Es Un Dia, Big Richard,
Chainsaw, This Is Something New, Cedar Land, Bluesit
Jeremy Pelt (tp), Eric Alexander (ts) Mike LeDonne (p),
Peter Washington (b), Kenny Washington (dm)
Enregistrés les 8-9 mai 2022, Englewoods Cliffs, NJ
Durée: 1h 01’ 16”
Cellar Music 070122 (www.cellarmusicgroup.com)
Enregistré en liveau Smalls Jazz Club, le premier disque permet de retrouver Jesse Davis, ce bel
héritier de la tradition parkérienne, dans un contexte live et new-yorkais, lui qui est si souvent en Europe, un cadre où
il excelle, en club, et avec une section rythmique de choix composée de Spike Wilner, qui délaisse ses responsabilités de
patron de club pour le clavier, sa première vocation, Peter Washington et Joe Farnsworth, soit deux des piliers de la scène new-yorkaise des clubs et donc
de ce jazz post bop qui fait sa réputation. Si la section rythmique est
conforme à ce qu’on attend, efficace, blues, swing et dans l’esprit, ce sont
surtout la sonorité et l’expression de Jesse Davis qui crèvent les hauts parleurs.
Sur un répertoire de standards (de Victor Young, Cole Porter, Strachey &
Link) et de belles compositions du jazz (de Jimmy Heath, Tom McIntosh,
Thelonious Monk, Horace Silver, Lee Morgan), Jesse Davis fait montre de cette
qualité de conviction qui donne tant de poids à son expression, avec une
véhémence et un lyrisme qui raviront les amateurs de jazz de toutes les
chapelles («These Foolish Things»). Il est à lui seul indispensable. Et pour ce
qui est du blues, il n’a pas son pareil pour donner des frissons avec ce son
pulsé jusqu’à la fêlure qui sort de son alto («Juicy Lucy»). Quant au registre
parkérien développé in the tradition sur la composition de Thelonious Monk («Rhythm-A-Ning»), celle-ci confirme la
profondeur de la référence de Jesse Davis, au-delà du temps qui nous sépare
d’un des pères du jazz, Charlie Parker. Du grand art, éternel. Côté
section rythmique, Peter Washington est comme souvent très inventif dans ses
chorus, et l’album se termine sur un bon «Love for Sale» avec toujours ce son
très authentique de Jesse Davis qui est comme en relief.
On retrouve sur ce même label Peter Washington dans ce qui
est le même univers de musiciens et le même esprit post-bop, mais très
différent quant au résultat et à la musique car c’est un projet musical à part
entière, enregistré aux Studios Rudy Van Gelder, mettant en valeur les
compositions actuelles de deux des leaders. Mike LeDonne et Eric Alexander.
Comme Peter Washington et Joe Farnsworth, tous les musiciens Jeremy Pelt, Mike
LeDonne, Eric Alexander, Peter et Kenny Washington sont parmi les plus remarquables
artistes de la scène du jazz à New York. C’est, comme l’indique le nom du
groupe qui sert de titre à l’album («les gros frappeurs», on pourrait traduire «les tontons flingueurs» par cette complicité et cette énergie qui les
caractérisent), une musique directe, pétrie dans le blues, le swing,
l’expression, un jazz sur lequel personne ne se posera de question
existentielle: il y a un drive à remuer des montagnes. Lee Morgan,
Freddie Hubbard, Art Blakey, Cedar Walton,
et Horace Silver hantent les compositions («Silverdust», «Hub», «Cedar
Land»…) nouvelles et pourtant classiques, in the spirit and tradition, de cet
ensemble, et Jeremy Pelt, Eric Alexander se chargent de mettre le feu, pendant
que la section rythmique jette du petit bois, ou de l’essence selon les moments, pour l’alimenter. Inutile de dire que les arrangements sont parfaits, les
ensembles d’une perfection très jazz de culture, d’autant qu’avec Peter et
Kenny Washington, on voyage dans la meilleure des limousines, avec cette
impulsion, cette qualité de relance, ses press
rolls qui font rebondir la musique. On n’épargne aucune des dimensions de
cette splendide musique, même pas la latine qui est l’une des couleurs de New
York, avec «Un Dia Es Un Dia» qu’on pourrait croire sorti tout droit du Spanish
Harlem des années de l’âge d’or. Il y a des moments d’émotion recueillie avec
«Big Richard», dédié par Eric Alexander à son père disparu en 2017, et pour
finir, il ne manquait qu’un petit moment de folie avec «Bluesit», histoire de
bien faire comprendre de quel bois se chauffent les Hitters…
On aime ces disques «sans surprise» où le jazz de
culture transpire le blues et le swing par toutes ses notes.
Yves Sportis
© Jazz Hot 2023
|
  Claus Raible Trio Claus Raible Trio
Fugitive Figures
What Love Exotique, Fugitive Figures, Reminiscence, Accelerando
in Blue, Villa Oriental, The Aztecs, Not Yet, Blamelessly, Close Hauled, "C"
Jump, Rai Blue
Claus Raible (p), Giorgos Antoniou (b), Xaver Hellmeier (dm)
Enregistré les 30 avril et 1er mai 2022, Munich,
Allemagne
Durée: 51” 04”
Alessa Records 1109 (www.alessarecords.at)
«La passion est la clé
pour accéder à nos sources intérieures, qui se situent au-delà du seuil de la
conscience», écrit en guise de notes de livret Claus Raible pour ce nouvel
enregistrement, le premier après la grande coupure du son due au covid. C’est
aussi son premier disque composé exclusivement d’originaux, une autre raison de
s’intéresser à la musique de cet excellent pianiste que nous vous avions
présenté en 2021 dans une interview et avec quelques chroniques de disques pour ce même label le plus souvent (Trio!, Searchin' for Hope et Mo Is On, Free Fall)
en leader ou coleader.
Claus Raible, on vous le répète, c’est une combinaison aussi
inattendue que réussie entre la passion du jazz, l’amour de la musique de Bud
Powell («Fugitive Figures») et de Thelonious Monk –l’intensité donc– et un
expressionnisme qu’on dirait, sans cliché, allemand en référence au début du XXe siècle, par sa puissance, par ses
reliefs et cette manière bien à lui d’installer une atmosphère, souvent sombre,
avec en particulier son jeu de main gauche très percussif, et de ce contraste naît une musique lumineuse.
Son préambule sur l’au-delà du seuil de la conscience
explique aussi la tonalité des compositions qui, bien que toutes originales, sont
toutes familières à des oreilles d’amateurs de jazz, comme si ses compositions
avaient été élaborées dans la fièvre de l’âge d’or du jazz où toutes les époques du jazz cohabitent, dans ces années
1945-1965, où les musiciens jouaient leur vie sur les scènes et dans les
studios d’enregistrement avec une conviction et une profondeur qui ne
laissaient planer aucun doute sur le fondement de leur expression et
l’authenticité de leur art.
Il y a, comme le détaille le texte de promotion, de vrais démarquages de grands thèmes du jazz et de standards («What Love Exotique»,
«Villa Oriental»…), ce n’est pas nouveau chez Claus Raible mais, comme toujours,
il n’y a rien de systématique, pas plus que de copie; tout est neuf, différent,
profondément original, et surtout à la manière de Claus Raible, avec swing,
blues («Not Yet», «Rai Blue»), angulosité, virtuosité, avec cet attachement
indéfectible à l’univers de Bud Powell, d'Elmo Hope, de Charlie Parker, et du bebop dans l’art de rouler les
notes, de faire sonner les blocks chords, de faire ruisseler des cascades de
notes sans jamais diminuer l’intensité de la musique, ajoutant par-ci par-là
quelques dissonances («Blamelessly », relecture orientale de «Don’t Blame Me»),
évocation de l’autre passion de Claus Raible, Thelonious Monk, pour faire une
véritable recréation de cet univers sans en abandonner l’esprit qui en fait
toute la sève.
Accompagné à la basse par son fidèle et virtuose Giorgos
Antoniou et par le très musical Xaver Hellmeier à la batterie qui se fondent dans le projet, Claus Raible
développe une forme aboutie du trio dans ce qu’il offre de meilleur sur notre
continent, sans faiblesse, sans concession aux modes, ne cédant rien à la facilité de l'air du temps. Sa
musique, à peine créée, se classe par son esprit dans l’éternité du jazz, celle
qui fait qu’on l’écoute déjà comme on écoute les «classiques» du jazz, c’est-à–dire
les novateurs de tous les temps, les éternels. Claus Raible est un de ces
miracles européens capables de nous faire rêver que le jazz est encore en vie
en Europe et qu’il a de beaux jours devant lui, contre l’évidence de la
pauvreté de la programmation en général. Souhaitons aux amateurs et aux programmateurs de
festivals et de clubs d’en prendre conscience, les miracles sont rares. Signalons pour la
curiosité que le mixage a eu lieu à Trieste, la cité de Roberto Magris, et que
les photos sont de la chanteuse Anna Lauvergnac (coleader avec Claus Raible sur Free Fall). Il y a sans doute des
coins de terre plus fertiles que d’autres…
Yves Sportis
© Jazz Hot 2023
|
  Jack McDuff Jack McDuff
Live at Parnell's
CD1: Make It Good, Untitled D Minor, Déjà Vu, Fly Away, Another
Real Goodun’, Blues in the Night, Satin Doll, A Night in Tunisia
CD2: Killer Joe, Greensleeves, Take the "A" Train,
Wives & Lovers, Walkin' the Dog, Lover Man, Blues 1 & 8
Jack McDuff (org), Danny Wollinski (s), Henry Johnson (g),
Garrick King (dm)
Enregistré en juin ou juillet 1982, Seattle, WA
Durée: 1h 08' 22” + 50' 17”
Soul Bank Music 007 (https://soulbank.k7store.com)
Brother Jack McDuff est un de ces indispensables
inclassables qui confirment l’artificialité de la séparation instillée entre
jazz, blues et spirituel dans le grand ensemble de la musique populaire afro-américaine.
On le sait, on le répète, et c’est vrai depuis le début de l’histoire de cette
musique. Les formations avec orgue Hammond B3 ont ainsi réussi, avec une
cohorte d’artistes de haut niveau, à transgresser la séparation artificielle
entretenue par le monde des affaires, une séparation qui tenait aussi à la
société américaine (ségrégation et lutte des classes) et à son incapacité, par racisme plus ou moins ouvert, à
reconnaître elle-même le seul art authentiquement américain de naissance, le
jazz comme un tout, parce qu’il émanait de cette part de la société rejetée par
la majorité du fait de la ségrégation.
Jack McDuff ( 1926-2001) a passé sa vie à enfreindre les
règles et les catégories, non par esprit de contestation ouverte mais pour être
simplement lui-même, un musicien populaire authentique portant son histoire et
son art. Il choisit l’orgue pour avoir plus de travail, l’apprend en
autodidacte en s’inspirant du père fondateur de l’instrument, Wild Bill Davis dont
il garde des éléments de sonorité, mais aussi de Jimmy Smith et de ses nombreux
pairs sur l’instrument dont il partage le fort ancrage blues & spiritual. Brother Jack
McDuff est ainsi une synthèse sur son instrument aux confins du jazz mainstream, du bebop, du blues et du spiritual en tant que catégories, qu’il
joue des traditionnels comme «Greensleeves», Duke Ellington, Benny Golson, les
standards ou Jack McDuff, le compositeur.
Cet enregistrement de juin ou juillet 1982 (le livret est
imprécis), inédit, enregistré en live au club de jazz Parnell’s, à Seattle, fondé en 1976 par Roy Parnell, témoigne
de toutes ces qualités, du drive de cette musique, où les sidemen sont portés
par l’énergie et le fond de cette musique très blues, par le talent de passeur
de Jack McDuff; Henry Johnson à la guitare tirant vers le blues et
Danny Wollinski, le saxophoniste, vers le bebop à la manière d’un Eric Alexander
avant l’heure, la liaison est faite par l’orgue à la sonorité saturée, à la
Wild Bill Davis, de Jack McDuff qui apporte une nappe swing et blues
impressionnante à sa formation soutenue par Garrick King, un batteur efficace
comme toujours dans ce style des formations avec orgue.
A propos de l’enregistrement, la restauration sonore de ce
qui fut enregistré en live est parfois
elle aussi saturée, trop, et d’après le livret, ces petites imperfections
viennent aussi de l’orgue, l’instrument présentant quelques petites déficiences
que Brother Jack McDuff, tel un volcan en éruption, n’avait cure de réparer (ou
était-ce un choix de sonorité en référence à Wild Bill Davis), son drive
emportant tout, public compris, sur son passage («Blues 1 & 8»).
Nous avons donc ici deux disques, deux heures de
musique inédite et incandescente, et ceux qui aiment le jazz et le grand
artiste Brother Jack McDuff, ne s’arrêteront pas plus à ces saturations sonores
qu’aux craquements des 78 tours quand il s’agit d’écouter Louis Armstrong ou
Duke Ellington de ce temps-là…
Yves Sportis
© Jazz Hot 2023
|
  Pharoah Sanders Quartet Pharoah Sanders Quartet
Live at Fabrik Hamburg 1980
You Gotta Have Freedom, It's Easy to Remember, Dr Pitt, The
Creator Has a Masterplan, Greetings to Idris
Pharoah Sanders (ts), John Hicks (p), Curtis Lundy (b),
Idris Muhammad (dm)
Enregistré le 6 juin 1980, Hambourg, RFA
Durée: 1h 10’ 17”
Jazzline Classics/Deltan 77123 (www.jazzline-leopard.de/Socadsic)
Cet enregistrement vient enrichir la redécouverte des
concerts qui ont illuminé l’Europe et particulièrement l’Allemagne à la fin
des années 1970 et dans les années 1980, grâce à la redécouverte que le jazz de
culture, foudroyé à la fin des années 1960 par la musique commerciale, n’était
pas mort aux Etats-Unis dans la tournade. Le fil a été maintenu par des
anciens comme Art Blakey, Max Roach, Charles Mingus, McCoyTyner, entre autres, et donc Pharoah Sanders, et la flamme a été transmise à une nouvelle génération. Nous
avons ainsi droit à retrouver ces formidables concerts d’une énergie
torrentielle qui présentaient Eddie Harris, récemment chroniqué,
et ici Pharoah Sanders avec un splendide all-stars dans de nouveaux lieux comme
la Fabrik, une usine reconvertie et, par ailleurs, toujours à Hambourg, Chez
Onkel Pö,
avec les Louis Hayes, Woody Shaw, Buster Williams, Billy Higgins, Victor Lewis…
De cette époque, il reste heureusement des enregistrements
pour percevoir la musique pleine d’âme, d’énergie, de blues, de spiritualité de Pharoah Sanders, alors en pleine maturité, secondé par les grands John Hicks,
Curtis Lundy et Idris Muhammad. On retrouve toutes les recherches de son de
l’héritier le plus évident de John Coltrane, qui a développé le pan spirituel
de son mentor jusqu’à des sommets d’émotion. La sonorité, le lyrisme du ténor
justifient à eux seuls le caractère indispensable de cet album, mais comment ne
pas admirer le jeu de John Hicks, au toucher si nuancé, percutant («You Gotta
Have Freedom») ou aérien («It's Easy to Remember»). Idris Muhammad, toujours
aussi musical et parfait pour cette musique qui a besoin de douceur et de
puissance, et Curtis Lundy, précis, complète une belle formation. Dans cette heure de musique, on sent dans la sincérité des
réactions d’un public transformé par une musique intense sans complaisance, l’intensité de cette atmosphère, qui rappellent que la
conviction en art est un fondement essentiel de l’authenticité. Pour avoir
aussi écouté ces concerts en direct lors de tournées européennes, on ne peut
que remercier les auteurs de ces rééditions qui restituent une mémoire et une
matière si riche plus de quarante ans après, et qui donnent le vertige, un
vertige appréciable, quand on écoute le jazz de 2023 souvent si léger, peu
imaginatif et artificiel malgré ses bons techniciens.
Yves Sportis
© Jazz Hot 2023
|
 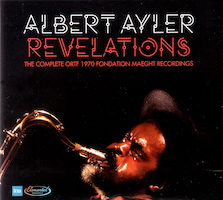 Albert Ayler Albert Ayler
Revelations: The Complete ORTF 1970 Fondation Maeght Recordings
CD1: Music Is the Healing Force of the Universe, Birth of
Mirth, Masonic Inborn,
Revelations 1, Oh! Love of Life, Island Harvest, Heart
Love
CD2: Ghosts, Love Cry, Desert Blood, Revelations 2,
Revelations 3, Revelations 4, Speaking in Tongues
CD3: Truth Is Marching In, Zion Hill aka Universal Message,
Again Comes the Rising of the Sun, Holy Family, Revelations 5, In Heart Only,
Revelations 6, A Man Is Like a Tree,
CD 4: Holy Holy, Spirits Rejoice, Spirits, Thank God For
Women, Spiritual Reunion, Music Is the Healing Force of the Universe, annonce Mary
Parks/Curtain Call
Albert Ayler (ts, ss, voc), Mary Parks (ss, voc), Call Cobbs
(p, CD3-4), Steve Tintweiss (b), Allen Blairman (dm)
Enregistrés les 25 (CD1-2) et 27 juillet (CD3-4) 1970,
St-Paul-de-Vence (Alpes Maritimes)
Durée: 43' 49'' + 1h 04' + 1h 11' 56'' + 1h 06' 41''
INA/Elemental Music 5990443 (www.elemental-music.com)
Est-il indispensable en 2023 de rééditer (à l’origine parue
en deux disques LP Shandar 10000 et 10001) dans sa version, a priori intégrale
et dans l’ordre où elle fut jouée, la musique d’Albert Ayler lors de ces deux
concerts donnés à la Fondation Maeght, à St-Paul-de-Vence les 25 et 27 juillet
1970? A cette question, il est possible de répondre très diversement.
Si l’on se place du point de vue de l’histoire de la musique
et du jazz, il ne fait aucun doute que le «détective» Zev Feldman et Jeff
Lederer ont eu raison de solliciter l’lNA, détentrice de ces archives comme de
celles en général de la radio-télévision française avant la privatisation des
années 1980, car du fait de l’intégralité, c’est un document nouveau
(au moins partiellement, respectueux de ce qui s’est déroulé en
cet été 1970, d’autant qu’Albert Ayler va disparaître mystérieusement la même
année en novembre 1970 (cf. Jazz Hot n°
268, janvier 1971 et Numéro Spécial 2001)
et qu’il s’agit de son dernier enregistrement. La discographie d’Albert Ayler
n’est pas si importante, et ce pourrait être l’occasion d’une meilleure
compréhension de son œuvre, si l’on est capable de sortir des rails des idées
convenues, qu’elles soient positives ou négatives quant à l’œuvre d’Albert
Ayler, car il est l’objet d’un véritable malentendu, au sens littéral du mot.
Si l’on se place du point de vue commercial, et Zev Feldman
le sous-entend, nul doute que ce grand travail (4 CDs, 4h de musique restaurée,
avec un livret d’une centaine de pages faisant appel à une vingtaine de
témoignages de Sonny Rollins, Archie Shepp, David Murray, Joe Lovano, Reggie
Workman pour ne citer que ceux qui nous paraissent les plus pertinents avec
ceux de Steve Tintweiss (b) et Allen Blairman (dm) qui étaient sur la scène
avec Albert Ayler), richement illustré de photos qui ont dû coûter un bras en
droits (Jean-Pierre Leloir, Jacques Robert, Philippe Gras…), ce grand œuvre donc n’a aucune
vocation à la rentabilité dans une époque où il est peu probable, en dehors
d’un phénomène de mode inattendu, que le public, de jazz ou autre, possède les
clés et l'envie pour accéder à cette musique, déjà méconnue et mal perçue en son temps par
la plupart des publics, malgré une plus grande curiosité en général, voire un certain
snobisme dans ce cas.
Si l’on fait un retour dans le temps grâce à Jazz Hot (au bas de cette chronique,
nous rappellerons quelques articles), on s’aperçoit que la musique d’Albert
Ayler a donné lieu au sein même de la rédaction à une véritable bataille
d’Hernani, les opinions allant du mépris le plus total à la béatitude, en
passant parfois par une compréhension de l’artiste: on supposa qu’Albert Ayler
ne savait pas jouer de son saxophone –critiques de la part de musiciens
pourtant savants– jusqu’au fanatisme le plus extatique décrivant cette musique
comme la modernité absolue de l’avant-garde, une sorte de point ultime de la
«liberté». Il y eut heureusement des articles et des interviews plus factuels et éclairant cette musique sortie des baraques en planches qui abritaient les esclaves afro-américains. Le public
européen en général et français en particulier, refléta cette incompréhension,
entre les insultes (salle Pleyel, 1960) et le fanatisme snob d’une grande part du public de la Fondation Maeght.
Le lieu même, la Fondation Maeght, symbolique du
progressisme de l’époque confondant l’idée de progrès, de sciences, de
modernité/contemporanéité et d’art, une confusion toujours présente en 2023, indique
qu’Albert Ayler n’était pas à sa place, consciemment ou sans le savoir, lui
seul aurait pu le dire –pas plus que Duke Ellington qui vint lui aussi donner
un magnifique concert dans ce lieu de mode d’une laideur de nouveaux riches de
l’époque malgré les oliviers et les cigales. Il est vrai que pour les musiciens
afro-américains se produire dans ce lieu de la jet set, qui jouissait de l’aura artistique de modernité en Europe d'un conformisme très bourgeois, a toujours été considéré comme une reconnaissance dont
ils avaient un besoin vital, au sens basique, pour exister dans l’Amérique
raciste et ségrégationniste de leur naissance. La mort anonyme d’Albert Ayler à
34 ans, après une disparition de trois semaines, toujours inexpliquée et
brutale (on le retrouva noyé dans l’Hudson en novembre 1970, et on conclut
rapidement et sans appel à un suicide pour un musicien de nature joyeuse, chrétien et religieux)
confirme que cette reconnaissance ne lui a malheureusement pas servi à survivre
dans son pays. Il n’est pas un cas isolé dans le jazz et dans ce temps.
L’incompréhension, et d’une certaine façon la négation, dont
a été victime Albert Ayler trouvent encoreen 2022 une confirmation dans l’importance de ce livret: Zev Feldman a besoin
de 100 pages et de témoignages parmi les plus crédibles ou les plus clinquants
ou simplement inadaptés –mais ce sont des noms connus– pour justifier d’un tel
travail. Il faut encore prouver
qu’Albert Ayler est un artiste, et c’est vrai, l’accueil délirant et positif du
public de la Fondation Maeght est plus porteur que celui méprisant de la salle
Pleyel en 1966.
Mais puisqu’en définitive, Zev Feldman a fait ce bon
travail, et quelles que soient ses motivations (la curiosité, son naturel de
détective amateur de trésors perdus ou son amour voire sa sensibilité philosophique à cette musique), ne nous privons pas de cette opportunité de retrouver, dans son
entier et sa continuité, la dernière musique d’un artiste qui sublima sa
condition humaine dans une expression marquée par la religion, le blues et plus
largement la musique populaire de quatre siècles de ségrégation, avec quelques caractéristiques qui
n’appartiennent qu’au jazz: le blues, on l’a dit, le swing, dans la voix car il
possède le phrasé de cette musique, le souci de se différencier pour exister en tant qu'individu dans un monde qui le niait, non de se
conformer, une règle du jazz et de l’art qui manque si souvent au XXIe siècle, même dans le jazz ou chez
ceux qui s’en réclament, et la spiritualité, religieuse dans son cas, dont on
trouvera les explications dans le Jazz
Hot Spécial 2001 que nous vous recommandons aussi pour la discographie. Peu de témoignages évoquent cet aspect pourtant essentiel d'un musicien enraciné dans des siècles de condition humaine, malgré 100 pages, des témoignages toujours figés, comme en 1970, dans la description d'une «modernité» abstraite.
En résumé, Albert Ayler, comme dans le jazz et chez certains artistes en peinture
à travers les siècles, a trouvé dans sa condition et dans ses croyances, la
matière d’une expression particulière, marquée par sa culture afro-américaine,
proche en définitive à bien des égards du mysticisme des prêcheurs, des acteurs
du spiritual plus que du gospel. C’est une musique intense, parfois naïve (cette
«Marseillaise» mêlée à «Mon beau sapin» dans «Spirits Rejoice» si souvent ébauchée
par un artiste qui a séjourné pour son service militaire à Orléans) comme du
Chagall, mais qui aurait osé dire que Chagall ne savait pas peindre ou qu’il
était l’avant-garde? La beauté de la musique d’Albert Ayler est parfois
sauvage, parfois enfantine, toujours populaire et parfois figurative ou si vous
préférez un récit de la vie au raz du bitume ou au fond des bayous, et toujours
une expression profonde, intense, avec des accents, des cris, des larmes.
Albert Ayler est une autre illustration de la diversité et
de la spiritualité de l’expression afro-américaine, comme Louis Armstrong, Duke
Ellington, Billie Holiday, B.B. King ou Charlie Parker et tant d’autres,
connus et moins connus. Il se place dans ce grand mouvement des années
1950-1960 qui a donné Sun Ra, John Coltrane, Pharoah Sanders et tant d’artistes
du jazz qui ont remis leurs rêves, leur foi au milieu de la vie et du peuple,
toujours différents entre eux, mais qui partagent l’essentiel du jazz: le
blues, le spiritual, le swing, et cette qualité d’expression ancrée dans la vie
qui n’existe qu’avec la conviction, la sincérité, hors des champs de la technique et du
savoir académique qui restent à leur place, comme des outils éventuels qui ne doivent jamais dicter l’art et remplacer la vie. Ne pas ressentir le poids de l'histoire, l’authenticité et l’essentialité
d’Albert Ayler, ce qui est le cas de nombreux amateurs de jazz, même chez ceux
qui l’adulent par simple conformisme progressiste, devrait
interroger, car c’est ne pas comprendre le jazz dans son ensemble.
Yves Sportis
PS: (re)découvrir Albert Ayler
Jazz Hot n°213, octobre 1965
• Albert Ayler le magicien par François Postif
Jazz Hot n°222, juillet-août 1966
Free 66: Dossier réalisé par Annette Léna, Daniel Berger et
Alain Corneau.
• Reportage photos par Annette Léna, L'East Village: Grachan
Moncur III, Albert Ayler, Archie Shepp, Sun Ra Arkestra: Sun Ra, Marshall
Allen, Ali Hassan
• La soirée Syanon au Village Gate par Daniel Berger et
Alain Corneau
• Voyage au cœur du Free Jazz par Daniel Berger et
Alain Corneau; Interviews: Introducing Bill Dixon, les Frères Ayler
Jazz Hot n°229, mars 1967
• Free jazz, l’artiste volé par son art, Don et Albert Ayler
par Michel Le Bris
Jazz Hot n°268, janvier 1971
• La mort d’Albert Ayler par Alain Tercinet, Chris
Flicker, Gérard Noël, François Postif
Jazz Hot n°273, juin 1971
• Albert Ayler Memorial Concert par Bernard Lairet
Jazz Hot n°315, avril 1975
• Albert Ayler/Sonny Rollins, même musique par Jean Buzelin
Jazz Hot n°381, février 1981
• Autour d’un disque d’Albert Ayler: The Hilversum Session
par Gérald Arnaud et Jerome Reese
Jazz Hot n°479, novembre 1990
• Albert Ayler (1936-1970) par Yves Sportis
Jazz Hot Spécial 2001
• My name is Albert Ayler par Philippe Richard et Yves
Sportis • Love Cry, discographie détaillée d’Albert Ayler par
Philippe Richard et Yves Sportis
© Jazz Hot 2023
|
  Herb Geller Herb Geller
European Rebirth: 1962 Paris Sessions
Crazeology, Brake's Sake, C.T.A., Foolin' Myself, I Didn't
Know About You, It's You or no One, I Should Care, Moanin', Tabou, There's no
Greater Love, While the Cigarette Was Burning, Tominique C, Greta No. 1, Solo
For Gaby, Oscar Is Happy, Blue 'n' Boogie, A Cool Day (Bled & Butter)
Herb Geller (as) avec selon les thèmes: Sonny Grey (tp), Bernard Vitet (tp), François Jeanneau (ts),
Jack Diéval (p), Dany Doriz (vib), René Urtreger (p), Henri Renaud (p), Kenny Drew (p), Renato
Sellani (p), Jacques Hess (b), Michel Gaudry (b), Pierre Michelot (b), Rajko
Milosavljevic (b), Franco Manzecchi (dm), Teddy Martin (dm), Larry Ritchie
(dm), Jimmy Pratt (dm)
Enregistré entre les 24 mars 1962 et 11 juillet 1962, à San Remo,
Paris et Bled (Yougoslavie)
Durée: 1h 14’ 18”
Fresh Sound Records 1117 (www.freshsoundrecords.com/Socadisc)
Fresh Sound a choisi d’isoler ici le début de la deuxième
vie d’Herb Geller, lorsqu’à 34 ans, et déjà au bout d’une longue carrière de
presque vingt années commencée dès 16 ans aux côtés de Joe Venuti, il choisit
de s’installer en Europe. Si son premier concert se déroule au Festival de San
Remo en mars 1962 (avec Kenny Drew, Pierre Michelot et Larry Ritchie), ce
disque reprend pour l’essentiel des séances en France où Herb Geller trouve un
bon accueil, notamment dans le cadre des émissions de la RTF (Radio-Télévision Française) «Jazz aux Champs Elysées», animées
par Jack Diéval, un pianiste qui fait partie de l’histoire du jazz en France,
et qui était lui-même le permanent de la section rythmique maison avec Jacques
Hess, un ancien de Jazz Hot, etFranco Manzecchi. Lors de ces émissions, il y avait d’autres invités, dont
l’excellent Sonny Grey, Bernard Vitet, François Jeanneau, Dany Doriz et René
Urtreger.
Il y a par ailleurs deux séances avec Henri Renaud, Michel
Gaudry et Teddy Martin. Enfin, lors de ce début de séjour européen qui va
préluder à une longue seconde carrière européenne qui le conduira à s’installer
en Allemagne dans la durée et à enregistrer en 2009 encore avec Roberto Magris
l’un de ses derniers disques, An Evening
With Herb Geller & The Roberto Magris Trio,
avant son décès en 2013, il fait un détour dans cette année 1962 par d’autres
festivals dont le Festival de Bled dont nous parlait justement Roberto Magris
dans son récit sur le jazz à l’Est au temps du communisme.
Jordi Pujol dans son bon livret (biographique) nous indique
qu’Herb Geller participe ensuite, en août 1962, au Festival de Comblain-la-Tour,
en Belgique. Le sax alto s’est rapidement acclimaté à la dimension européenne,
lui qui n’avait pas cessé de tourner aux Etats-Unis, et il y a trouvé un cadre
de vie dont il s’est souvent félicité.
Ce disque trace donc principalement un pan de l’histoire du
jazz à Paris en 1962 avec quelques-uns des acteurs de la scène de cette époque,
et c’est le second intérêt d’avoir réuni avec sagacité ces séances autour d’un
artiste toujours aussi impressionnant par son art de réunir le classicisme de
Benny Carter et la fougue de Charlie Parker, au demeurant une liaison qui coule
de source… Brillant, inventif, doué d’une belle sonorité, Herb
Geller est en effet un classique au pays des modernes, un intemporel, et ces
enregistrements rappellent que l’Europe s’est enrichie de sa capacité d’accueil
de centaines d’artistes de jazz auxquels elle a, alors, su laisser développer
leur langage, leur culture, pour le plus grand bien des artistes européens qui
souhaitaient accéder à cet art qu’on appelle le jazz, sans prétendre
l’inventer. De cet échange (1930-1970) est née la plus grande partie du jazz en
Europe et en France.
Yves Sportis
© Jazz Hot 2023
|
  Billy Taylor Billy Taylor
Taylor Made Jazz
Biddy's Beat*, Theodora, Mood for Mendes*, Daddy-O*, Day Dreaming*,
Cu-Blu, Can You Tell by Looking at Me, Tune for Tex*
Billy Taylor (p),
Clark Terry* (tp), Willie Cook* (tp), Britt Woodman* (tb), Johnny Hodges
(as), Paul Gonsalves* (ts), Harry Carney* (bar), Earl May (b), Ed Thigpen (dm)
Enregistré le 17 novembre 1957, Chicago
Durée: 30’ 30”
Fresh Sound Records 1670 (www.freshsoundrecords.com/Socadisc)
  The Billy Taylor Trio The Billy Taylor Trio
Complete Recordings: Custom Taylored & Uptown
Warming Up, Easy Like, That's Where It Is, Afterthoughts,
Easy Walker, Lonesome Lover, Don't Bug Me, Coffee Break, Ya Know What I Mean,
Native Dancer, Uncle Fuzzy, No Aftertaste, La Petite Mambo*, Jordu*, Just the
Thought of You*, Soul Sisters*, Moanin'*, Warm Blue Stream*, Biddy's Beat*,
Cu-Blu*, 'S Wonderful*
Billy Taylor (p), Henry Grimes (b), Ray Mosca (dm)
Enregistré les 4 février* et 26 mars 1960, New York, NY
Durée: 1h 16’ 50”
Fresh Sound Records 1122 (www.freshsoundrecords.com/Socadisc)
A l’origine paru chez Argo (Argo 650), le premier
enregistrement, de 1957, réunit le trio de Billy Taylor, une belle section
rythmique avec le solide et musical Earl May, un compagnon régulier de Billy
Taylor, et Ed Thigpen, le batteur de la nuance qui fera le bonheur d’Oscar Peterson
après celui de Billy Taylor, et une phalange de l’orchestre de Duke Ellington,
en vacances de la maison-mère, et parmi les solistes les plus relevés de l’Orchestra
avec Clark Terry, Willie Cook, Johnny Hodges, Paul Gonsalves, Harry Carney;
autant dire qu’ils sont «le son de Duke Ellington», et que l’ombre du Duke plane sur cette séance,
qui d’opportunité de calendrier, devient indispensable, d’autant que the Rabbit
(Johnny Hodges) se taille la part du lion, aussi lyrique qu’un violon et le
pied aussi léger que le voudrait son surnom, vibrant d’émotion («Day Dreaming»,
«Can You Tell By Looking at Me»), du grand art qui donne une profondeur
supplémentaire à cet enregistrement qui ne manque pas d’attraits par ailleurs.
Paul Gonsalves ne donne pas sa part au Lapin, tout aussi émouvant et lyrique
dans les ballades («Theodora», «Mood for Mendes»…). A ce sujet, sur le livret,
le chorus sur «Theodora» est crédité à Johnny Hodges, mais à notre oreille,
c’est Paul Gonsalves, un ténor, d’ailleurs tout aussi lyrique qu’Hodges. Clark
Terry, Willie Cook, Harry Carney («Cu-Blu») et Britt Woodman («Daddy-O»)
apportent évidemment leur contribution, mais c’est bien les ballades, Johnny
Hodges et Paul Gonsalves qui font de cet enregistrement un indispensable. Billy Taylor, d’une grande économie et précision dans son
rôle de maître de cérémonie, est parfait, il laisse toute la place à ses
invités.
Le second disque réunit deux enregistrements du début de
l’année 1960 en trio: Uptown (Riverside) et Custom Taylored(Sesac) avec Henry Grimes, dont on mesure toujours plus la richesse de carrière
à ce tournant des années 1950-1960, au four et au moulin dans cet âge d’or,
avec Sonny Rollins et Billy Taylor parmi d’autres. Cette réunion des deux
disques est une intégrale de ce trio. Dans ce disque, on admire davantage l’art
du trio de Billy Taylor, une de ses spécialités, et évidemment, sa part de
pianiste, avec ses qualités exceptionnelles, comme celles d’Henry Grimes, sont
plus développées. Dans Custom Taylored,
Billy Taylor est l’auteur de toutes les compositions, ce qui explique le titre
(«sur mesure» en jouant sur son
patronyme), alors que le second se partage équitablement entre compositions
personnelles et empruntées. Billy Taylor, c’est un homme de synthèse. Il n’est
pas l’initiateur d’un style de piano, mais il possède de grandes qualités dans
tous les registres de l’art du piano, car il a côtoyé Art Tatum, dont il fut un
défenseur en tant qu’écrivain-critique dans Jazz
Hot (contre l’avis d’André Hodeir). C’est aussi un enfant de Teddy Wilson, un
contemporain d’Oscar Peterson, dont il n’est finalement pas très loin dans sa
capacité à jouer tout le jazz, même dans l’esprit de Count Basie («Soul
Sisters»), possédant cet attachement au swing et au blues, à la grande
tradition du jazz, classique et moderne, avec un sens certain de la mise en
place, de la perfection qui caractérise le meilleur du jazz. Avec Billy Taylor,
un amateur de jazz ne peut être qu’aux anges, il est un classique parmi les
classiques.
Henry Grimes fait aussi l’intérêt de ces enregistrements, il
y est le brillant contrebassiste qui suit le rythme effréné du piano, d’une
grande virtuosité («Uncle Fuzzy»), comme un soliste de premier plan aux chorus
toujours imaginatifs et à la splendide sonorité. Ray Mosca, qui a accompagné
George Shearing, est magnifique aux balais («Jordu», «’S Wonderful»). Billy Taylor a eu une grande et longue carrière,
reconnu par le public et encore davantage par ses pairs, ce qui lui a valu très
vite le titre de Dr. Billy Taylor. Il est de ces musiciens auxquels on pense
toujours à propos de jazz sans qu’ils n'aient jamais eu une notoriété de premier
plan, malgré une belle discographie et une grande carrière. Il est à redécouvrir
pour la jeune génération et ces rééditions en sont l’occasion.
Yves Sportis
© Jazz Hot 2023
|
  Èlia Bastida Èlia Bastida
Tribute to Stéphane Grappelli
Clair de Lune, I Can’t Get Started, Double Concerto,
Troublant Bolero°, Anniversary Song, Flamingo, Makin’ Whoopee, Dance for
Stéphane°, Nature Boy, Django, Izaura*, My One and Only Love, Grappelia°,
Django (Bonus Track)°
Èlia Bastida (vln, voc*), Josep Traver (g), Joan Chamorro
(b), Arnau Julià (dm)°
Enregistré les 18 et 19 août 2022, Montoliu de Segarra
(Espagne)
Durée: 56’ 17’’
Jazz to Jazz 22032 (https://jazztojazz.com)
Èlia Bastida nous vient de Barcelone où elle a vu le jour en
1995. Elle commence l’étude du violon classique à 4 ans avant de rejoindre, à
17 ans, le Sant Andreu Jazz Band, un big band formé par les jeunes élèves (7 à
20 ans) de l’école municipale de musique de Sant Andreu (un quartier de Barcelone),
fondé en 2006 par Joan Chamorro, contrebassiste, pédagogue et figure de la
scène jazz barcelonaise. Comme d’autres élèves-musiciens passés par ce big band
–parmi lesquels on compte Andrea Motis (tp, as, voc), née la même année–, Èlia
a eu la possibilité d’approcher la réalité professionnelle du jazz par de
nombreux concerts et enregistrements, dont un Joan Chamorro presenta Èlia Bastida (2017) où elle est entourée,
outre du Sant Andreu Jazz Band, d’un all-stars comprenant, excusez du peu, Dick
Oatts, Scott Robinson, Luigi & Pasquale Grasso ainsi que Ignasi Terraza.
Joan Chamorro faisant décidément très bien les choses pour ses protégé(e)s,
Èlia Bastida a également eu la chance de graver deux albums sous son nom avec
Scott Hamilton: The Magic Sound of the Violin (2019) et Èlia Bastida Meets Scott
Hamilton (2022). Précisons enfin que le label barcelonais Jazz to Jazz qui a
sorti tous ces disques, ainsi que le présent album d’Èlia Bastida, a été fondé
par Ramon Motis, le père d’Andrea, afin de promouvoir les activités musicales
de sa fille et de Joan Chamorro.
Et c’est encore une fois en compagnie de son mentor qu’Èlia publie ce Tribute
to Stéphane Grappelli, avec le concours du bon guitariste (et également pédagogue)
Josep Traver et du batteur Arnau Julià sur quatre titres. L’essentiel du
répertoire proposé évoque le duo de Stéphane avec Django dans ses différentes
configurations: au sein du Quintette du Hot Club de France (entre autres «Clair de Lune», «Troublant
Bolero» superbement introduit par Joan Chamarro), en trio avec Eddie South (vln) sur le fameux enregistrement de 1937 («Double Concerto» de J.-S. Bach, un titre apporté par Charles Delaunay qui avait d'ailleurs désarçonné Stéphane à l'époque) ou encore la
session de Rome de 1949, en quintet («I Can’t Get Started», «Nature Boy»). L’hommage
est rendu avec un grand naturel, dans un langage tout à fait jazz qui s’inscrit
bien dans la filiation Django, dont le versatile Josep Traver maîtrise le
phrasé (il se produit aussi dans d’autres contextes: blues, funk, école Wes Montgomery…).
Quant à Èlia Bastida, son expression est plus dans la tradition gitane hispanique que grappellienne –dont le grain swing au lyrisme italien est si caractéristique– mais plus légère car la profondeur qui s'acquiert naturellement par la transmission orale et par le vécu, ne vient qu’avec le temps de la pratique et la multiplication des rencontres pour ceux qui veulent dépasser l’apprentissage académique. La musique n’en est pas
moins très belle, notamment le «Double Concerto» sur lequel Èlia
assure le duo de violons à elle seule en re-recording.
D’autres dimensions du parcours de Stéphane Grappelli, qui s’est poursuivi pendant
plus de quarante ans après la disparition de Django, sont également évoqués,
comme sa fréquentation de la bossa nova qui donna l’album La Grande réunion (1974, Imagem) avec Baden Powell, dont est tiré «Izaura»
où Èlia chante dans l'esprit de la regrettée Astrud Gilberto. Cette inclinaison latine est aussi rappelée par
un original, «Dance for Stéphane». Moins convaincant, un autre original, «Grappelia»
imagine un Stéphane Grappelli funk. Sinon, «Flamingo» peut être pris comme une référence directe à l’album éponyme
avec Michel Petrucciani (1995, Dreyfus), tandis que deux prises de l’immortelle
composition de John Lewis, «Django» –gravée une première fois par Stéphane en
1962 (Django, Barclay)– sont
proposées. On le voit, Èlia Bastida a beaucoup de curiosités, d'appétit et donc elle aborde beaucoup d'univers au gré de ses découvertes…
Jérôme Partage
© Jazz Hot 2023
|
  Sonny Rollins Trio Sonny Rollins Trio
Live in Europe 1959: Complete Recordings
CD1: St. Thomas, There Will Never Be Another You, Stay as
Sweet as You Are, I've Told Every Little Star #1, How High the Moon, Oleo, Paul's
Pal #1, I Remember You, I've Told Every Little Star #2, It Could Happen to You,
Oleo #2, Will You Still Be Mine?
CD2: I’ve Told Every Little Star #3, I Want to Be Happy #1,
A Weaver of Dreams,
It Don’t Mean a Thing #1, Cocktails For Two, I’ve Told Every
Little Star #4, I Want to Be Happy #2, Sonny Rollins Interview, It Don’t Mean a
Thing #2, Paul’s Pal #2, Love Letters
CD3: Woody 'N You, But Not for Me, Lady Bird
Sonny Rollins (ts), Henry Grimes (b), Pete La Roca (dm), Joe
Harris (dm)*, Kenny Clarke (dm)°
Enregistrés du 2 au 11 mars 1959, Suède, Suisse,
Pays-Bas, RFA, France
Durée: 1h 13’ 38”+ 52’ 52” + 52’ 23”
American Jazz Classics 99140 (www.jazzmessengers.com)
Voici comblés quelques petites petites lacunes dans la
mémoire de l’œuvre de Sonny Rollins puisque nous avons avec ce triple album la
réunion des enregistrements, dont certains privés et radiophoniques sont
inédits, de Sonny Rollins en trio lors de la tournée européenne de mars 1959. Ce
qui fait l’importance de ces disques est qu’ils sont les derniers
enregistrements avant la première interruption de carrière du ténor, pendant
trois années où, dans sa retraite, il travailla seul son instrument (la période
où, selon la légende, on aurait pu l’écouter en solo arpenter le pont de
Williamsburg). Depuis 1957, Sonny Rollins expérimente le trio sans piano (saxophone,
basse, batterie), et des enregistrements historiques témoignent de ce moment
comme Way Out West avec Ray Brown et
Shelly Manne (Contemporary), A Night at
Village Vanguard avec Wilbur Ware et Elvin Jones (Blue Note), The Freedom Suite avec Oscar Pettiford
et Max Roach (Riverside), Sonny Rollins Brass/Trio avec Henry Grimes et Charles
Wright (Verve). Il est donc en tournée en ce début d’année 1959, et la réussite
de ces enregistrements dans ce format du trio, et d’autres en formation plus
étoffée, ne laisse pas soupçonner cette remise en cause de trois années qui
suivra cette tournée. On retrouve ici, malgré une qualité de restitution
parfois moins bonne, ce qui fait la beauté de cette période de Sonny Rollins:
un son grave et profond, brut, puissant, un lyrisme certain porté par
une virtuosité sans pareille et un discours déjà abondant. La formule trio,
avec de grands instrumentistes, laisse beaucoup de place à chacun et à une
complémentarité-complicité entre les musiciens. C’est l’occasion aussi de
redécouvrir le jeune mais déjà grand Henry Grimes qui connaîtra lui aussi une
éclipse, beaucoup plus longue que celle de Sonny Rollins à la fin des années
1960. Dans cette tournée, c’est Pete La Roca, qui fréquente les formations de
Rollins depuis 1957 (au Vanguard), qui tient la batterie avec musicalité,
accompagnant chaque inflexion du ténor, et prenant sa part dans cette
conversation à trois.
Pour certains amateurs, c’est ce son brut, rugueux, presque
boisé (pour un cuivre, c’est une performance) du ténor, parfois seul, a capella
(«It Could Happen to You», absolument magnifique avec ses accents et ses
commentaires), qui est le plus beau de l’œuvre, le plus original, et qui est la
trace sonore de Sonny Rollins dans le grand livre des ténors du jazz où Sonny
Rollins est l’un des chapitres importants. Quoi qu’il en soit, le saxophoniste interrompra sa carrière
après cette tournée, et pour les amateurs, dont nous sommes, cela reste un
mystère quand on entend l’inventivité, le punch, la conviction, la beauté brute
de son expression et cette formule en trio qui est une vraie bénédiction. Ce coffret reprend le disque Dragon qui relatait la
tournée en Suède, et présente aussi des inédits de ce tour d’Europe (émissions
radios, enregistrements privés…). Pour quatre thèmes en Suède, Joe Harris remplace Pete La Roca, et pour trois longs thèmes de près de 20 minutes chacun
enregistrés à Aix-en-Provence, c’est un Kenny Clarke omniprésent et brillant
qui tient les baguettes et Sonny Rollins termine par un «Lady Bird» (Tadd
Dameron) qui nous dit combien la musique est belle avec l’urgence, la
conviction et l’inventivité de ce temps. Dans tous les cas, du grand Sonny
Rollins avec un magnifique Henry Grimes. Le livret est correctement écrit et
documenté, avec de bonnes photos, le son est bon et au moins authentique, et il
y a même deux minutes d’interview avec la voix claire de Sonny Rollins qui
explique à la TV suédoise pourquoi il joue avec un trio sans piano avant
d’attaquer un «It Don’t Mean a Thing» sur tempo ultra-rapide. Indispensable!
Yves Sportis
© Jazz Hot 2023
|
  Cannonball Adderley Cannonball Adderley
Live in Paris: 1960-1961
CD1: Jeannine*, The Chant*, Work Song*, Our Delight , Autumn
Leaves, Band Introduction by Cannonball Adderley, Well You Needn’t, Serenity (1er concert), Sack O’ Woe (1er concert)
CD2: Lisa, Dis Here, New Dehli°, Mean to Me°°, Arriving Soon , Serenity (2e concert), Sack O’ Woe (2e concert)
CD3: Big "P", Hi Fly°, Jeannine (2e concert), Dis Here (2e concert), Yours Is
My Heart Alone°, In Walked Ray°°°+, Bohemia After Dark
Julian "Cannonball" Adderley (as), Nat Adderley (cnt),Victor Feldman (p, vib°), Sam Jones (b, cello°°), Ron Carter (b)+, Louis Hayes (dm)
Enregistrés les 25 novembre 1960* et 15 avril 1961 (2 concerts), Paris
Durée: 1h 16’ 20” + 1h 11’ 58” + 1h 03’ 07”
Pour resituer ces excellents enregistrements, partiellement
inédits, il vous faudra replonger dans vos Jazz
Hot de janvier 1961 ( n°161) et de mai 1961 ( n°165),
maintenant disponibles en format pdf dans notre boutique, car y figurent deux
bons comptes rendus de Daniel Humair, célèbre batteur et artiste peintre, alors
rédacteur régulier dans Jazz Hot. Il
est épaulé par Philippe Adler pour le second, et Jean Tronchot, un autre
journaliste de Jazz Hot, y va aussi
de son commentaire. Ces témoignages d’un temps où de nombreux concerts d’un niveau
exceptionnel illuminent Paris, permettent de relativiser l’actualité 2023 du
jazz dans cette même ville, autant sur le plan qualitatif que quantitatif, et
ça vaut aussi pour le public. Grâce à ces articles, on apprend que les trois premiers
thèmes de novembre 1960 à la Salle Pleyel (trop courts au goût de Daniel Humair),
première apparition en France de Cannonball Adderley, s’intègrent dans une
soirée du JATP de Norman Granz, plantureuse (Coleman Hawkins, Benny Carter, Roy
Eldridge, Jo Jones, Dizzy Gillespie, Stan Getz, J.J. Johnson, Lalo Schifrin…), ce
qui explique la brièveté pour le quintet, Sam Jones et Louis Hayes tenant la
rythmique aussi bien pour les frères Adderley que pour J.J. Johnson, Gillespie
et Stan Getz. On apprend aussi que Norman Granz enregistre, ce qui nous permet
aujourd’hui de retrouver ces enregistrements, déjà partiellement édités par lui-même pour
trois thèmes sur The Cannonball Adderley
Quintet, Paris, 1960, Pablo Records 5303-2. Pour Daniel Humair, les trois thèmes joués ce soir-là sont
«Big "P"», «The Chant» et «Bohemia After Dark», et donc pas ceux indiqués
dans cette édition pour deux d’entre eux. Pour Norman Granz, dans l’édition
Pablo ( Paris, 1960), il y a sept
thèmes, dont ceux évoqués par cette édition et par Daniel Humair. Cela dit pour
l’incertitude et pour l’histoire, car ces variations peuvent venir de la source elle-même. La tournée était
européenne. Quant à la musique, le groupe est homogène
entre les deux dates, et la musique est de la même veine, l’excellent pianiste
anglais, Victor Feldman (p, vib, dm,perc, 1934-1987) –vibraphoniste sur «Hi Fly», «Yours Is My Heart
Alone»… – remplaçant l’absent des tournées en 1960 et 1961, Bobby Timmons, qui
est l’habituel pianiste de «l’organization», le groupe de Cannonball et Nat
Adderley. Avec cette formation et Bobby Timmons, ils ont en effet enregistré Cannonball Adderley Live in San Franciscopour Riverside en 1959, un disque qui a reçu en avril 1961 le prix de
l’Académie Charles Cros (jazz, cf. Jazz
Hot n°164, avril 1961) au moment de cette tournée. Cannonball Adderley, l’héritier le plus brillant de Charlie
Parker dont il possède la puissance et la finesse expressives sur fond de
blues, avec autant d’aisance et un peu plus de rondeur au niveau du son, est
déjà reconnu et adulé malgré sa rareté en Europe. Il côtoie alors le gotha du
jazz pour ses enregistrements ou en sideman. Il a formé un magnifique quintet
avec son frère Nat Adderley, excellent trompettiste resté dans l’ombre de son
frère, à la sonorité proche de celle de Miles Davis sur les tempos lents, mais
avec un phrasé virtuose très dynamique dans l’esprit de Lee Morgan dès que le
feu s’installe («Autumn Leaves», «Dis Here»…). Ils sont l’âme d’un quintet dans
la tradition hard bop, aux qualités similaires du groupe des Jazz Messengers
d’Art Blakey, des ensembles d’Horace Silver, ces formations exceptionnelles où
l’énergie se conjugue au feeling, le blues à l’invention mélodique, pour un
résultat qui enthousiasme tous les publics du monde, encore de nos jours par
les disques; cela grâce entre autres à des rythmiques hors normes avec ici les
monumentaux Sam Jones et Louis Hayes, auxquels se joint le jeune Ron (Ronald)
Carter, venu tenir la contrebasse le temps d’un «Mean to Me» avec, au
violoncelle, Sam Jones (CD2), un chorus magnifique, sans doute un hommage au grand Oscar Pettiford, décédé à l’automne 1960, car il était un spécialiste des
chorus sur la «petite contrebasse» en pizzicato.
Les deux remettent leur échange en action sur «In Walked Ray» (CD3), sans doute
dédicacé à Ray Brown, avec aussi de bons chorus de Vic Feldman et Cannonball. Dans le livret inégal (quelques imprécisions), l’auteur a eu
la bonne idée de restituer en texte les présentations de chaque thème
effectuées par Cannonball, avec humour et pédagogie, qui rendent hommage à
Bobby Timmons, l’absent déjà reconnu à Paris pour sa participation aux Jazz
Messengers, Bobby Timmons le compositeur aujourd’hui méconnu, celui qui est un
peu le responsable de l’adjectif «soul» qui colle à Cannonball, comme le fait
adroitement comprendre dans sa présentation le leader, avec humour. Cannonball
évoque Miles Davis, un chef de file de cette génération qui a été son «sideman»
sur Something’ Else (Blue Note 1958)
avant que lui-même lui rende la politesse sur Kind of Blue (Columbia, 1959), deux enregistrements historiques
pour rappeler que Cannonball est un autre génie reconnu du jazz de ce temps. Un
génie modeste qui ouvre la porte à Victor Feldman, étonnant remplaçant anglais
dans cette musique si enracinée («Dis Here») qui parvient à apporter une belle
contribution à ce groupe, sans aucune faiblesse, plusieurs
compositions également («The Chant», «New Dehli», «Serenity»). Le leader sait
enfin ce qu’il doit à Sam Jones, Ron Carter et Louis Hayes («Bohemia After
Dark») pour cette musique où l’énergie ne masque jamais l’expressivité ni le
lyrisme d’une perfection absolue. Le frère n’est mentionné qu’avec retenue
comme un autre soi-même, et Cannonball ne se présente pas lui-même. Tout juste
parle-t-il de l’orchestre de Duke Ellington où il a fait un passage, et de son
admiration pour Eddie Cleanhead Vinson dont il a choisi une splendide composition,
«Arriving Soon», brillamment arrangée et interprétée pour illustrer l’esprit
blues à la manière de Cannonball…
Enfin, et malgré la «fine bouche» d’une partie des
rédacteurs de Jazz Hot de l’époque
(Daniel Humair est enthousiaste, Jean Tronchot réservé) sur ces deux concerts
du quintet de Cannonball Adderley, des rédacteurs spécialement gâtés par la
qualité de la programmation de l’époque dans la Capitale, ces concerts
pourraient être qualifiés de «concerts de l’année» s’ils se déroulaient à Paris
de nos jours tant l’écart expressif est grand avec notre monde aseptisé, même
dans le jazz.
Cannonball Adderley, un homme-artiste entier et
naturel, est bien entendu au-delà de tout compliment. Sous ses doigts et dans
son souffle, la musique coule comme une évidence portée par un lyrisme tout
parkérien, par l’expression, la virtuosité avec la même facilité que celle de
son inspirateur, avec cette beauté directe, sans maniérisme, cette
conviction, en un mot cette authenticité qui font le génie du jazz. Il n’est
nul besoin de chercher le blues, le swing, ils sont la matière, le cœur de
cette expression. Les arrangements, la sonorité d’ensemble du quintet sont
parfaits et permettent des moments d’intensité qui font partie de l’inconscient
des amateurs de jazz («Bohemia After Dark»). Cannonball Adderley est habité par
le génie du jazz. Se plonger dans l’écoute de ces trois disques, parmi d’autres
dans l’œuvre du grand sax alto, en relisant les comptes rendus d’époque, permet
de comprendre tout ce qui est essentiel dans le jazz et tout ce que nous avons
perdu progressivement depuis cet âge d’or de l’expression, et de manière
brutale depuis cet épisode de covid, parfois même chez les artistes qui en
étaient de bons artisans avant 2020. Les réactions du public perceptibles sur
cet enregistrement en donnent une idée. Comme si le monde du jazz avait perdu
une partie de cette âme, de cette conviction, de ce courage pour prendre tous
les risques indispensables à la création et de cet humour naturel et sans prétention
de Cannonball: «do, ré, mi fa, soul…»… Indispensable!
Yves Sportis
© Jazz Hot 2023
|
  Eddie "Lockjaw" Davis With Shirley Scott Eddie "Lockjaw" Davis With Shirley Scott
Cookin' With Jaws and the Queen: The Legendary Prestige Cookbook Albums
CD1-Cookbook, Vol.1: Have Horn Will Blow, The Chef, But
Beautiful, In the Kitchen, Three Deuces, But Beautiful
CD2-Cookbook, Vol.2: The Rev, Stardust, Skillet, I Surrender
Dear, The Broilers
CD3-Cookbook, Vol.3: I'm Just a Lucky So and So*, Heat 'n
Serve, My Old Flame, The Goose Hangs High, Simmerin', Strike Up the Band*
CD4-Smokin’: High Fry, Smoke This, Pennies From Heaven*,
Pots and Pans*, Jaws, It's a Blue World*, Blue Lou*, Avalon*, Willow Weep For
Me*
Eddie "Lockjaw" Davis (ts), Shirley Scott (org),
Jerome Richardson (ts, bar, fl), George Duvivier (b), Arthur Edgehill (dm),
Enregistré les 20 juin 1958 (CD1), 12 septembre 1958 (CD3-4*)
et 5 décembre 1958 (CD2-3-4), Hackensack, NJ,
Durée: 44’ 24” + 34’ 51” + 38’ 36” + 43’ 36”
Craft Recordings 00541 (https://craftrecordings.com)
Ce coffret de quatre disques réunissant les enregistrements
de l’année 1958 d’une formation homogène, un quartet et un invité (Jerome
Richardson n’est pas présent le 12 septembre 1958) autour du saxophoniste Eddie
Lockjaw Davis (1922-1986) pour le label Prestige de Bob Weinstock est comme une
évidence. Outre le label, la formation et l’année qui sont communs, le lieu d’enregistrement
(Hackensack, NJ), et l’ingénieur du son, Rudy Van Gelder, sont également de la
partie.
Seul défaut, c’est que certains thèmes enregistrés le 12
septembre 1958 ne sont pas rassemblés ici, et il manque tout simplement le LP Eddie "Lockjaw"
Davis With Shirley Scott: Jaws, Prestige 7154, soit huit titres
de ce même 12 septembre 1958, ce qui n’est pas très cohérent avec cette idée de
coffret. Avec un disque supplémentaire, on aurait les sessions
complètes de 1958 pour Prestige. Ce qui n’enlève rien à l’intérêt artistique de
cette réédition d’un grand ténor, brillamment entouré, pour les amateurs qui ne
connaissent pas ou n’ont pas accès aux LPs d’origine.
Pour information, Prestige a poursuivi en 1959 la production
d’autres disques (Jaws in Orbit et Bacalao) avec le même quartet sans
Jerome Richardson, augmenté de Steve Pulliam (tb), Luis Perez (perc) et Ray
Barretto (perc), et au début de l’année 1958, le même quartet avait déjà
enregistré un disque pour Roost et un autre pour Roulette, tous les deux
disponibles sur le Eddie Lockjaw Davis
Trio Featuring Shirley Scott, chez Lonehill 10135.
Il y aurait donc de quoi faire une réédition intégrale d’un
bel ensemble qui a beaucoup travaillé avec cohérence, car Eddie Lockjaw Davis
est de ces artistes qui ont construit une œuvre qui aurait mérité une meilleure
mémoire des amateurs. De son vivant, le public a toujours apprécié un des
plus beaux sons du saxophone ténor de l’histoire pourtant chargée du ténor,
puissant, lyrique et virtuose, doublé d’un grand artisan de la permanence du
blues dans le jazz. Eddie Lockjaw Davis est un musicien «naturel», un de ces
instrumentistes autodidactes dont le savant Benny Carter repère tout de suite
les qualités de son. Le jazz a cela de commun avec l’opéra italien et la
musique de Django qu’il existe parfois-souvent des voix naturelles qui n’ont
pas besoin de passer par l’enseignement académique pour atteindre les sommets
de l’expression artistique. Avec son surnom (Jaws = Machoires) qui lui va comme
un gant, on retrouve chez Eddie Davis visuellement et à l’écoute cet
enracinement dans le blues qui lui valut de côtoyer non seulement Benny Carter
mais aussi, souvent, le Count Baisie Orchestra, dont il fut un invité
«permanent», un orchestre dans lequel il fit plusieurs séjours, éphémères ou de plusieurs
années, à sa guise. Count Basie savait apprécier les grands artistes, et
certains comme Jaws qui a l’art de mettre le feu dans tous les orchestres par ses chorus flamboyants, avaient «portes ouvertes»
dans son big band en fonction de ses disponibilités.
Ce coffret retrace donc une partie d’une association durable
avec la grande organiste de Philadelphie, Shirley Scott (1934-2002), exceptionnelle
pianiste également, qui a accompagné dans sa cité de naissance John Coltrane,
les frères Heath et tant de musiciens de haut niveau. Son association avec
Lockjaw s’est faite à l’occasion d’un séjour prolongé au Count Basie’s de New
York. Elle a eu une belle carrière,
d’enseignante en particulier, d’animatrice de shows, et n’a cessé de jouer en
trio (avec le grand Mickey Roker, dm), au piano en particulier. Elle a
participé en 1999 au regretté Festival de Bayonne de Dominique Burucoa, où elle
a enregistré dans le cadre des rencontres du Cloître (label Jazz aux Remparts).
Comme ses amis de Philadelphie, Shirley Scott possède cette fibre soulful qui donne à son jeu l’épaisseur
parfaite pour accompagner le discours profondément blues du ténor («My Old
Flame», «Heat 'n Serve», «Simmerin’»etc.).
La rythmique de cet ensemble est assurée par le fondamental George Duvivier («I'm Just a Lucky So and So»), un best of bassistes choisi aussi bien ici que par Hank Jones et tant
d’autres pour la précision et la sûreté de son soutien, et par Arthur Edgehill (dm, 1926, Brooklyn, NY),
dont Kenny Washington, le monsieur mémoire de la batterie jazz, se souvient
heureusement, car il a été oublié des dictionnaires et des amateurs. Il
explique, dans un livret précis et correct, qu’Arthur a été un batteur à deux
faces: un grand spécialiste du hard bop (avec Kenny Dorham au Cafe Bohemia) et
un grand accompagnateur des organistes dans le jazz et pour le blues («Simmerin'»),
avec simplicité et sobriété. Jerome Richardson (s, fl, cl, picc, 1926-2000), un
musicien aimé de tous les
musiciens, apporte dans les plages où il est présent une sorte de contrepoint
aérien à la dimension blues omniprésente, à la flûte le plus souvent, un
contraste recherché. Enfin, attardons nous encore sur les qualités d’Eddie
Lockjaw Davis, un puncheur c’est sûr, un bluesman («I'm Just a Lucky So and So»),
c’est certain, mais aussi un grand lyrique dont le gros son est aussi capable
de sinuer comme le premier Coleman Hawkins d’avant-guerre («I Surrender Dear»)
ou de se faire, selon les moments, suave ou brutal comme Ben Webster («Simmerin'»),
accompagnateur comme Lester Young pour des contrepoints et des riffs in the tradition. C’est une sonorité
splendide dotée de cette poésie indispensable au jazz qui installe certaines
interprétations dans l’éternité («My Old Flame»).
Ce beau coffret réunit en fin de compte des musiciens qui
sont aujourd’hui oubliés et mésestimés, non parce qu’ils seraient de second
plan, mais sans doute parce que la mémoire de notre époque, embarrassée par les
scories de la société de consommation, n’a plus la capacité et la sensibilité
pour apprécier l’art sous toutes ses formes. Le patrimoine du jazz, bien que
récent et disponible, est beaucoup trop vaste, riche et profond pour les petites têtes. Enfin,
pour ceux qui musclent leur cerveau, ce coffret est indispensable, c’est trois
heures d’incarnation d’un jazz le plus radical, car ancré dans le blues, sans concession.
Yves Sportis
© Jazz Hot 2023
|
  Jean-Pierre Derouard Swing Music & Co Jean-Pierre Derouard Swing Music & Co
Vol. 8: Fifty Blues Song
Fifty Blues Song*, From 2nd
Line to Swing, One By One*°, No Problem*°, Blues for Stephanie, Lazy River,
Whisper Not*°, Take the A Train, Shiny Stockings, Date Dare*°, Potato Head
Blues, I Remember Clifford*°, Caravan*°, Happy Funky°°
Jean-Pierre Derouard (dm, tp,
flh, chimes, claves) et selon les titres Philippe Desmoulins, Laurent Lair
(tb), Isabelle Melun (tu), Ewen Cousin (tp°, arr*), Jean Amy (cl), Esaie Cid (cl,
as), Thomas Leverger (as*, ts), Eric Breton (ts)*, Enzo Mucci (bjo), Philippe
Duchemin, Arnaud Labastie, Olivier Leveau* (p), Nicolas Gréory (org), Camille
Granger*°°, Patricia Lebeugle, David Salesse (b), Jean-Yves Boucherie,
Dominique Métais (perc), Fabien Eckert (cga), Laurent Cosnard (bells)
Enregistré entre juillet 2019
et décembre 2021, Maulsanne (72)
Durée: 1h 06’ 33’’
Black & Blue 1092.2 (Socadisc)
Les baguettes dans une main,
la trompette dans l’autre, Jean-Pierre Derouard présente le 8evolume de ses aventures au pays de Louis Armstrong et Art Blakey (cf. nos dernières chroniques dans Jazz Hot n°674 et Jazz Hot 2019). Un épisode au
long cours car l’enregistrement de ce disque a débuté en juillet de 2019 pour
s’achever en plein bazar sanitaire, en décembre 2021. La variété du répertoire,
qui s’étend du new orleans au hard bop, comme la diversité des formations
entourant le leader –qui totalisent vingt musiciens– donne à ce disque des
allures de superproduction où l’on ne s’ennuie jamais! Ainsi, en Cecil B.
DeMille du swing, Jean-Pierre Derouard propose une fresque pleine de relief et
de couleurs, vivifiante et salvatrice. Une bonne part du répertoire restitue
l’atmosphère des disques Blue Note de l’âge d’or, à commencer par le premier
morceau, un original fort réussi du leader (l’album en compte trois), «Fifty
Blues Song», donné par un quintet à l’énergie hard bop –Thomas Leverger (as),
Eric Breton (ts), Olivier Leveau (p) et Camille Granger (b)–, qu’on retrouve
sur six autres titres, avec le renfort d’Ewen Cousin (tp) sur des compositions
des Messengers: «One By One» de Wayne Shorter, «Whisper Not» et «I Remember
Clifford» de Benny Golson (avec un superbe duo de trompettes), «Date Dare» de
Bobby Timmons. Changement de personnel sur «Blues for Stephanie», en trio avec Philippe
Duchemin et Patricia Lebeugle, qui rappelle celui formé par James Williams, Art
Blakey et Ray Brown (auteur du morceau) sur l’album Magical Trio 1 (1987, EmArcy).
Autre original intéressant, «From
2nd Line to Swing», ouvert par Derouard à la batterie, façon marching band,
tandis qu’Arnaud Labastie (p) plaque des accords caractéristiques du piano blues de
Crescent City. Ce morceau jette un pont entre les évocations de Louis Armstrong
et Art Blakey, en cheminant ensuite vers une ambiance plus bop, offrant par la
même occasion un bon solo de David Salesse (b). Le duo batterie-piano est ici
particulièrement remarquable. Trois autres titres racontent les rives du Mississippi.
«Lazy River» (Hoagy Carmichael) où la trompette amstronguienne de Jean-Pierre
Derouard est entourée par Arnaud Labastie, Laurent Lair (tb) et Esaie Cid (cl),
au swing nonchalant, qu’on retrouve également sur le dernier original de la
série, «Happy Funky», pour lequel Esaie Cid passe à l’alto. Sur ce second
morceau très funky, comme l’annonce son titre, le piano cède la place à l’orgue
de Nicolas Gréory. Ça groove! Avec «Potato Head Blues»
(Louis Armstrong), on revient à la tradition des fanfares avec une prédominance
des soufflants –Philippe Desmoulins (tb), Isabelle Melun (tu), Jean Amy (cl)–,
en plus du leader qui assure également la rythmique avec Enzo Mucci au banjo (non
cité dans la liste des musiciens, mais bien présent sur les photos et à l’oreille).
Jean-Pierre Derouard a également
concocté deux titres ellingtoniens revisités: un «Take the A Train» à
l’introduction funk et un «Caravan» aux couleurs caribéennes où une belle
section de percussions –Jean-Yves Boucherie (maracas), Laurent Cosnard
(bells), Fabien Eckert (cga), Dominique Métais (claves)– se joint au sextet
des «Messengers». Beau travail d’arrangement, ici à mettre au crédit d’Ewen
Cousin, comme sur la moitié des morceaux. Enfin deux autres pépites, «No
Problem» (Duke Jordan), aux couleurs latines, et un très swinguant «Shiny
Stockings», où on retrouve Nicolas Gréory à l’orgue, complètent la fresque
musicale ordonnée par Jean-Pierre Derouard.
Du jazz en cinémascope!
Jérôme Partage
© Jazz Hot 2023
|
  Linda Keene Linda Keene
One More for the Road: The Dixie Songbird's Complete Recordings
CD1: Blue and Disillusioned, Poor Butterfly, White Sails, Octoroon, The Sheik of Araby, Tears From My Inkwell, Yankee Doodle, Especially for You, You’re the Moment in My Life, At the Balalaika, The Starlight Hour, As Long As I Live, Ac/Dc Current, I Love You Much too Much,Times Square Scuttle, Cigarette for Two, For Whom the Bell Tolls, Number Ten Lullaby Lane, Strictly From Dixie, Embraceable You, Somebody Loves Me, Mound Bayou
CD2: Georgia on My Mind, Way Down Yonder in New Orleans, Shine, Someone to Watch Over Me, Ja-Da, Frankie and Johnny, When My Sugar Walks Down the Street, Romance, Zero Hour, Joe-Joe Jump, Unlucky Woman, Blues in the Storm, Don’t Let It End, Gee Baby Ain’t I Good to You?, I Don’t Stand a Ghost of a Chance With You, Blues on My Weary Mind, I Must Have That Man, Muddy Water, One for My Baby
Linda Keene (voc) avec (orchestres détaillés dans le livret):
• Bobby Hacket (tp) and His Orchestra, 1938 (Pee Wee Russell, cl, Eddie Condon, g…)
• Jack Teagarden (tb, voc) and His Orchestra, 1939
• Lennie Hayton (p) and His Orchestra, 1939-40
• Tony Pastor (ts, voc) Orchestra, 1941 (Max Kaminsky, tp, Dorsey Anderson, voc…)
• Linda Keene With Henry Levine (tp) and His Strictly From Dixie Jazz Band, 1942
• Joe Marsala (cl) and His Orchestra, 1944
• Linda Keene With Charlie Shavers (tp), 1945
• Linda Keene, début des années 1950
Enregistré entre le 4 novembre 1938 et le début des années 1950, New York, NY, Hollywood, CA
Durée: 1h 04’ 15’’ + 1h 03’ 05’’
Fresh Sound Records 1115 (www.freshsoundrecords.com/Socadisc)
Qui connaît Linda Keene? Inconnue au bataillon des
chanteuses de jazz, Jordi Pujol a eu la bonne idée de nous faire découvrir
cette interprète qui ne manquait pas de qualités, notamment choisir ses accompagnateurs! Un peu moins de vingt-cinq ans de
carrière –d’après les informations recueillies– dont une partie est documentée
par des enregistrements (sessions studio, extraits radiophoniques et soundies) s’étalant de la fin des années
1930 au début des années 1950, mis à disposition dans cette intégrale en 2 CDs,
bien ficelée, dont l'atout maître est le livret très savant et richement illustré de Scott Henderson qui apporte un éclairage historique passionnant.
Née Florence McCrory (aussi orthographié «McCory») le 1er décembre 1911 à Taylorsville, MI, entre le Delta du blues et la Louisiane, elle quitte le foyer familial à 16 ans et épouse, trois ans plus tard, Spurgeon Suttle, également chanteur, avec lequel elle se produit sur scène
à Jackson, MI, où le couple réside, et dans les Etats du Sud. Repérés en 1934
lors d’un concert à New Orleans, LA, par le chef d’orchestre Jan Garber
(1894-1977), celui-ci les engage et les emmène à Chicago, IL. La carrière de
Florence et Spurgeon (qui change son prénom en Frank) Suttle s’accélère, de
nouveaux engagements arrivent, en particulier avec l’orchestre de George Duffy.
Vers 1936, le couple se sépare et Florence prend le nom de Linda Keene,
emprunté au personnage campé par Ginger Roger dans le film Shall We Dance (1937). Entre août et septembre 1938, elle chante au
sein du Glenn Miller Orchestra, mais trop brièvement pour l’accompagner en
studio et profiter de son succès populaire à partir de 1939. Elle rejoint en
octobre 1938 Bobby Hackett (tp, 1915-1976) avec lequel elle grave son premier
enregistrement à New York, NY, en novembre: «Blue and Disillusioned» (Vocalion)
où perce une personnalité vocale dotée d’un joli grain bluesy. Sa première
collaboration d’importance, pour sa dimension véritablement jazz, a lieu avec Jack Teagarden (tb, 1905-1964) auprès duquel elle enregistre quelques faces en
1939 pour Brunswick. On peut l’entendre aussi sur le savoureux «Sheik of
Araby», extrait d’une émission de radio, où le tromboniste chante sur quelques
mesures. De 1939 à 1941, les engagements se poursuivent, d’orchestre en
orchestre, avec ou sans traces discographiques, sous la direction de Willie
Farmer (dm), Lennie Hayton (p) –jolie version de «I Love You Much Too Much»
(1940)–, Red Norvo (vib), Tony Pastor (ts, voc) –Linda est en duo avec le
chanteur Dorsey Anderson sur «Number Ten Lullaby Lane», où intervient également
au chant, en imitant quelque peu la manière de Louie, Tony Pastor (1941)–, Charlie
Barnet (ts), Red Nichols (tp, cnt) et Muggsy Spanier (cnt).
Le concert du 2 juillet 1941 à l’Uptown Café Society de New
York –dont le patron, Barney Josephson, est communiste et intégrationniste– marque les débuts en leader de la chanteuse, ce qui n’empêche pas de nouvelles rencontres. Fin 1941, elle rejoint
ainsi le show radiophonique du Britannique Henry Levine (tp, 1907-1989), sur le
réseau ABC. Elle grave avec lui, en février 1942, le 78t Strictly from Dixie (du nom de l’émission), qui reste le seul album
à son actif (elle n’apparaît sinon que sur 45t). Elle y donne un «Embraceable
You» plein de justesse et d’émotion. Toujours avec Henry Levine, Linda Keene
participe en 1942 à des soundies –films
musicaux de 3 minutes, produits entre 1941 et 1947, diffusés sur des jukebox
avec écran– dont le son est reproduit sur le CD2 de l’intégrale: un «Georgia on
My Mind» tout en sensibilité côtoie l’humoristique «When My Sugar Walks Down the
Street». Dans le même temps, elle reprend une collaboration avec Tony
Pastor tout en poursuivant, entre 1943 et 1944, les apparitions en leader, dans
les clubs et les hôtels, en particulier au prestigieux Famous Door à Manhattan, où elle rencontre (ce que ne précise pas le livret) Helen Humes (voc, p, 1913-1981) qui aurait eu sur elle une profonde influence. Souvent qualifiée dans les programmes de «blues singer», ce qualificatif n’est pas usurpé comme elle le
démontre sur «Unlucky Woman» et «Blues in the Storm» gravés en 1944 avec l’orchestre
de Joe Marsala (cl, 1907-1978). On s’arrêtera avec encore plus d’intérêt sur
les quatre titres enregistrés début 1945 en compagnie de Charlie Shavers (tp,
1917-1971) avec lequel elle a chanté au Kelly’s Stable (New York) à l’automne
précédent. La séance, pour le label Black & White, est supervisée par son
ami Leonard Feather, tandis que Red Norvo est au vibraphone. Cette session qui
révèle une chanteuse en pleine maturité n’est pourtant pas suivie d’autres passages
en studio. Au contraire, l’étoile de Linda Keene pâlit progressivement. Elle
est pressentie pour des films musicaux ou des émissions de radio, mais sans
suite. En outre, elle divorce au bout d'un an de son second mari, le présentateur radio Burleigh Smith, en 1948. Sans
perspectives précises, elle continue néanmoins de tourner à travers les Etats-Unis et
enregistre, au débuts des années 1950 à Hollywood, CA, pour promouvoir son
travail, une démo de deux titres («Muddy Water» et «One for My Baby») qui
confirme la signature bluesy de la chanteuse dont la jeunesse passée non loin
des rives du Mississippi a imprégné son expression. Ces deux morceaux concluent
ces Complete Recordings. Linda Keene achève, vers la fin des années 1950, sa
carrière dans un complet anonymat; en tous cas, on perd toute trace de son
activité à compter de cette période. Elle décédera le 23 octobre 1981 à Los
Angeles, CA. L’histoire, un peu triste, ne dit pas ce qui a manqué à Linda
Keene pour ne pas connaître le succès d’une Rosemary Clooney ou d’une Peggy Lee
auxquelles elle n’avait pourtant rien à envier. On peut imaginer que le déclin de sa carrière après 1945 soit lié à la fois au retour du front des musiciens-chanteurs-hommes, qui réoccupent l'espace laissé vacant au profit des femmes, et surtout au fait d'avoir été blacklistée pour avoir partagé l'affiche avec un Afro-Américain, Charlie Shavers, tout en entretenant une certaine proximité avec les milieux communistes-intégrationnistes –auxquels appartenait Helen Humes–, après avoir déjà beaucoup fréquenté les musiciens italo-américains également mal vus. La chanteuse n’ayant jamais
pris la plume pour raconter sa vie, les indices manquent pour percer complètement les mystères de cette «Unlucky Woman» partie prenante d’une ère révolue où le jazz était
partout, se déployant à travers des armées de musiciens afro et euro-américains
dont tous n’ont pas laissé la même trace dans la grande épopée du jazz.
Jérôme Partage
© Jazz Hot 2023
|
  Fanou Torracinta Fanou Torracinta
Gipsy Guitar From Corsica, Vol. 1
How About You, C Swing, Valsa Corsa, Regards, Terranova,
Love Is Here to Stay*, Blues primitif, Fastrag, Vaghjime, Honeysuckle Rose*,
Inguernu, How About You (Take 2)*
Fanou Torracinta (g), Benji Winterstein (g rythmique),
William Brunard (b)
+ Bastien Brison (p)*
Enregistré les 27, 28 et 29 octobre 2019, Paris
Durée: 40’ 25’’
Casa Editions 43 (www.fanoutorracintamusique.com)
  Fanou Torracinta Fanou Torracinta
Gipsy Guitar From Corsica, Vol. 2
I'm Confessin' That I Love You, The Carnaby Street*, A
Nottebughju, Stockholm*, Minor Swing*, Dolce silenziu, Valsbach, Tea Time*,
Only a Papermoon*, Mars*, Four Brothers*, Appesu + bonus live*
Fanou Torracinta (g), Benji Winterstein (g rythmique), Bastien
Brison (p)*, William Brunard (b)
Enregistré les 12, 13 et 14 mai 2022, Paris
Durée: 47’ 50’’
A Loghja 005 (L’Autre Distribution)
L’histoire reliant Django à la Corse remonte à… 1914! Le
jeune Jean-Baptiste Reinhardt, alors âgé de 4 ans, y a en effet séjourné
quelques temps, pendant que son père, fuyant la guerre, y dirigeait un
orchestre de danse. Il n’y remettra jamais les pieds, mais l’histoire se
poursuit par d’autres intermédiaires: d'une part, par la présence continue de communautés tsiganes en Corse, d'autre part, disciples de Django et musiciens de l'Ile de Beauté, férus de valses et de boléros, se retrouveront autour de la guitare, instrument fortement
ancré dans les deux traditions, et adopteront, dans les années
1950, la
même guitare Selmer-Favino (dérivée de la célèbre Selmer n°503 de Django). Par ailleurs, cette proximité aboutira assez naturellement à entendre dans les cabarets parisiens Matelot Ferré ou les Frères
Briaval aux côtés de chanteurs corses comme les Frères Vincenti et Antoine
Ciosi.
C’est de ce double héritage que se réclame Fanou Torracinta,
né en 1994 dans un village de Haute-Corse. Initié très jeune à la
guitare par son père qui accompagnait les chanteurs dans les cabarets, ce
dernier lui transmet également une culture musicale qui passe par le jazz. Vers
12 ans, subjugué par le visionnage du concert Biréli Lagrène & Friends de 2002 à Jazz à Vienne, Fanou plonge dans le jazz et la musique de Django,
allant à la rencontre des musiciens de passage sur l’île. Dès 13 ans il monte
sur scène et commence à jouer comme professionnel deux ans plus tard, en
particulier durant les vacances d’été. En 2012, il est intégré à la tournée de
Tchavolo Schmitt –un maître avec lequel il reste lié– et crée la même année sa
propre formation avec William
Brunard qu’on retrouve sur les deux présents albums. Après deux premiers disques
en leader, Fanou Torracinta a enregistré deux volumes, en 2019 et 2022, d’un Gipsy Guitar From Corsica qui propose
une synthèse originale entre les différentes influences musicales qui l’ont
nourri. Une part de cette originalité tient à la présence du piano de l’excellent
Bastien Brison –en particulier sur le Volume 2– qui évoque directement les
sessions romaines de 1949 ayant réuni Django, Stéphane Grappelli, Gianni Safred
(p), Carlo Pecori (b) et Aurelio De Carolis (dm). Nous avions déjà croisé
Bastien (né à Roanne en 1991) dans le Hot Sugar Band et en invité sur le
dernier CD de Tchavolo Schmitt. On connaît mieux William Brunard (né à Paris
en 1990), qu’on a encore récemment entendu au Sunset à l’occasion d’une série
de concerts en hommage à Django. A la pompe, Benji Winterstein (né en 1991)
est d’une famille musicale manouche réputée de Forbach et a débuté à l’âge de 13 ans aux
côtés de son père Popots.
Le Volume 1 ne
compte qu'un titre de Django, «Blues Primitif» (aussi attribué à Eddie
Barclay qui, au cours de la session qu'il a dirigée en 1947, aurait suggéré à Django quelques idées musicales), des standards issus du répertoire djangolien et une
majorité d’originaux du leader (7 titres sur 12), dont deux, très réussis,
dans l’esprit du Divin Manouche: «C Swing» et «Fastrag». Porté par le soutien
rythmique bien huilé de Benji Winterstein et William Brunard, Fanou Torracinta y déploie
une vélocité sans ostentation et une expressivité jazz qui le situe bien dans
la filiation Django. Ces qualités sont d’autant plus audibles sur les thèmes du
répertoire Django: de «Blues Primitif», aux belles nuances de blues, au très
dynamique «How About You» pour ouvrir le disque et, pour le conclure, une alternate take avec Bastien Brison qui
amène une intensité swing supplémentaire. On le retrouve encore sur «Love Is
Here to Stay». Par ailleurs, l’alliage entre le stride de Fats Waller et la
guitare de Django sur «Honeysuckle Rose» est l’un des grands plaisirs de cet
album. On se sentira moins concerné par la partie du disque invoquant les
racines corses, qui s’éloigne du jazz, bien que «Valsa Corsa», plus enlevé, qui
rappelle les valses jouées par les musiciens corses, convoque aussi Django.
Quelques confinements plus tard, Fanou Torracinta a mûri son
projet qu’il a orienté plus franchement vers le jazz avec un Volume 2 qui intègre pleinement Bastien
Brison à sa formation, alors qu’il n’était invité que pour trois titres sur le Volume 1. Le pianiste livre en sus deux des six originaux du CD dont le pétillant «Tea Time» –une variation de «Tea
for Two»– qui fait la paire avec le rafraîchissant «The Carnaby Street» de
Fanou pour évoquer la scène Django de Londres particulièrement vivante (même si
on déplore la fermeture en 2022 du QuecumBar). Ce second opus propose deux compositions de Django: le superbe « Stockholm» auquel
le quartet rend toute sa poésie, et l’incontournable «Minor Swing» qui reprend
le solo gravé par Django sur la session de Rome en 1949, réarrangé au piano! On
peut d’ailleurs saluer l’habileté du leader offre
tout l’espace nécessaire à son pianiste pour introduire un formidable «Four
Brothers» avant de lui donner la réplique. La conclusion hors jazz du disque, avec un morceau de Bastien Brison, «Appesu», chanté en corse, paraît d'autant plus décalée. Fanou Torracinta est une belle découverte, une
étoile de plus scintillant dans la galaxie Django, au sein de laquelle on lui
souhaite de continuer à s’investir, avec de nouvelles trouvailles à venir.
Jérôme Partage
© Jazz Hot 2023
|
 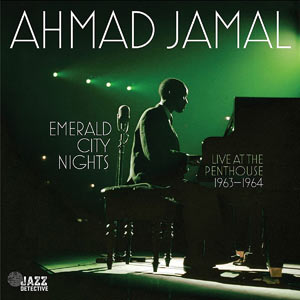 Ahmad Jamal Ahmad Jamal
Emerald City Nights: Live at the Penthouse 1963-1964 & 1965-1966
CD1&2: Johnny One Note/A, Minor Adjustments/A, All of You/A, Squatty Roo/A, Bogota/B, Lollipops & Roses/B, Tangerine/B, Keep on Keeping On/C, Minor Moods/C, But Not For Me/C
CD3&4: I Didn't Know What Time It Was/D, Who Can I Turn To?/D, My First Love Song/D, Feeling Good/D, Concern/E, Like Someone in Love/E, Invitation/F, Poinciana/F, Whisper Not/F
Ahmad Jamal (p) avec:
A/Richard Evans (b), Chuck Lampkin (dm)
B-C-D/Jamil Nasser (b), Chuck Lampkin (dm)
E/Jamil Nasser (b), Vernel Fournier (dm)
F/Jamil Nasser (b), Frank Gant (dm)
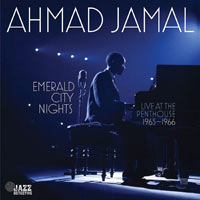 Enregistré les 20 juin 1963/A, 26 mars 1964/B et 2 avril 1964/C, 18 mars/4 et 25 mars 1965/D, 28 octobre 1965/E, 22 septembre 1966/F, Live at the Penthouse, Seattle, WA. Enregistré les 20 juin 1963/A, 26 mars 1964/B et 2 avril 1964/C, 18 mars/4 et 25 mars 1965/D, 28 octobre 1965/E, 22 septembre 1966/F, Live at the Penthouse, Seattle, WA.
Durée: 34’ 22” + 56’ 24” + 40’ 26” + 37’ 38”
Jazz Detective 004-005 (www.deepdigsmusic.com/www.elemental-music.com)
Ahmad Jamal qui vient de disparaître en ce printemps 2023
laisse une des œuvres majeures du jazz, et c’est par la grâce de
l’enregistrement et la volonté de passionnés du jazz, comme Zev Feldman et ses
complices sur le label au nom évocateur de Jazz Detective du groupe Deep Digs
(fouilles profondes) que nous avons encore accès à des inédits en live et en
club, au Penthouse de Seattle, WA, où le pianiste avait ses habitudes et ses
fidélités, c’est-à-dire dans la meilleure configuration pour le grand Ahmad
Jamal. L’hommage que nous lui consacrons, à l’occasion de sa disparition,
éclairera notre propos sur le caractère idéal de ces enregistrements pour cet
artiste qui a multiplié tout au long de sa vie l’expression en club, notamment
dans sa première grande époque de 1951 à 1966. C’est un vrai privilège de
découvrir ces deux coffrets de deux disques aussi bien produits, avec de bons
livrets comme toujours pour Zev Feldman, bien illustrés par les photos de CTSImages, Christian Rose entre autres, avec d’excellents commentaires du
producteur, du fils du patron historique du Penthouse, Charlie Puzzo, Jr., des extraits
d’interviews d’Ahmad Jamal, lui-même, une mise en situation par Eugene
Holley, Jr., un rappel par Marshall Chess, un héritier de la grande maison de
disques de Chicago, de l’importance d’Ahmad Jamal pour les labels Argo, Cadet
et Chess, car le pianiste connut une véritable célébrité très tôt dans sa
carrière chez Argo et contribua donc à l’essor de la maison de disques. Il y a
encore des souvenirs de Ramsey Lewis, un autre grand pianiste disparu à la fin
d’année 2022, qui évoque les concerts au Pershing de Chicago d’Ahmad Jamal, six
soirs par semaine, où courraient les musiciens. Ramsey raconte l’atmosphère
électrique de ces réunions de musiciens qui venaient de partout, Kansas City,
l’Ouest, New York, et qui s’installaient car tout y incitait. Il se souvient
que dans les trois studios Chess, il y avait un seul grand piano, et qu’il
croisait son aîné, Ahmad, toujours sympathique et qui l’impressionnait. Il se
souvient combien l’écoute du trio l’a inspiré sur le moment lui, et les jeunes
musiciens qui l’accompagnaient. Enfin, cette production de ces concerts est
passionnante aussi, en dehors de la qualité musicale, par la volonté de permettre aux amateurs d’aujourd’hui de sentir la fièvre créatrice
de cette époque, de ces soirées en club, à Seattle comme ici, ou à Chicago, à
New York… Ce remarquable travail est aussi disponible en vinyle.
Enfin, dans cette période de 1963 à 1966, Ahmad Jamal est au
déjà sommet de son art et depuis des années, sûr de son chemin et de ses
constructions sonores savantes, consacré par la critique et par le public, et
il s’exprime dans son format de prédilection, le trio, avec ses fidélités comme
Jamil Nasser, Richard Evans, Vernel Fournier, Frank Gant. On vous en dit plus
long sur la biographie, la discographie, l’œuvre et les caractéristiques
stylistiques, ce swing brillant, aérien, ce sens de l’ellipse, du silence, des
contrastes, et bien d’autres choses encore dans l’hommage qui accompagne la
disparition d’Ahmad Jamal, il faut vous y reporter en écoutant ces quatre
disques qui réunissent tous les ingrédients du talent hors norme de Mr. Ahmad
Jamal. Cette lecture et celle des deux livrets. Les textes
sont partiellement communs sur les deux livrets avec une iconographie
différente, bien sûr des précisions discographiques différentes. Mais sur le
premier, Ramsey Lewis évoque ses souvenirs, Hiromi raconte sa découverte
d’Ahmad Jamal, tandis que sur le second, C’est Kenny Barron qui explique le
sens de l’espace dans la musique, et ce sont les deux jeunes Jon Batiste et
Aaron Diehl qui détaillent l’importance fondatrice d’Ahmad Jamal dans
leur propre approche de la musique. Avec cet ensemble de commentaires, les
amateurs d’Ahmad Jamal sont gâtés, d’autant que d’autres éditions comme celle
de Fresh Sound pour la première période du trio d’Ahmad Jamal, The Three
Strings, ou encore le coffret Mosaic, leur offrent la disponibilité et
l’information pour toute une œuvre complètement documentée et disponible jusqu’à nos jours.
Yves Sportis
© Jazz Hot 2023
|
  Jan Harbeck Quartet Jan Harbeck Quartet
Balanced
Balanced*, One Fine Day, Silver String Valley*, The
Enchanter*, Tranquillity, Woodwind, One Step at a Time*, The Drive*, To Be
Continued
Jan Harbeck (ts), Henrick Gunde (p), Eske Nørrelykke (b),
Anders Holm (dm), Eliel Lazo (cga)*
Enregistré les 10-11 avril 2022, Copenhague (Danemark)
Durée: 55’ 50’’
Stunt Records 22102 (www.sundance.dk/www.uvmdistribution.com)
Le nom de Jan Harbeck nous est désormais familier, puisque nous le chroniquons régulièrement aux côtés de Snorre Kirk (Beat, Tangerine Rhapsody, Drummer
& Composer) ou à l'occasion de ses propres
albums, que ce soit avec son projet Live Jive Jungle ou avec son quartet.
C’est à la tête de cette seconde formation que le ténor danois, né à Aarhus le
13 avril 1975, nous revient. Formé à l’Académie royale danoise, de 1994 à 1998,
comme de nombreux jazzmen de la scène de Copenhague avant lui (Jesper
Thilo, Allan Botschinsky…) et à la New School de New York, NY (1999),
Jan Harbeck a joué et enregistré avec de nombreux orchestres, dont le Ernie
Wilkins Almost Big Band que le saxophoniste de St. Louis, MO, ancien de chez
Basie, avait fondé en 1980, après son installation définitive à Copenhague, et
qui compta notamment dans ses rangs Jesper Thilo et Bent Jædig. Héritier
direct de Ben Webster, Jan Harbeck s’inscrit donc dans cette filiation du jazz
de culture ayant fait souche au Danemark, autre terre d’élection en Europe des
musiciens afro-américains après la Seconde Guerre mondiale.
Sur ce huitième album sous son nom, on retrouve autour de Jan
Harbeck quasiment le même personnel que sur le précédent The Sound The Rhythm. Au piano, l’excellent Henrik Gunde (1969) –qui
s’est notamment illustré par trois albums en hommage à Erroll Garner– prodigue
un soutien sans ostentation mais où pointe un swing omniprésent. Doté d’une
belle profondeur de jeu, le contrebassiste Eske Nørrelykke (1979) est passé par
le Berklee College of Music de Boston, MA, et l’Université de Stavanger en
Norvège, de même qu’il a eu l’occasion d’étudier l’instrument avec Ben Street à
New York, NY et Niels Henning Ørsted Pedersen. Quant au batteur
Anders Holm (1976), ni le livret ni internet ne nous éclairent sur son parcours,
ce qui ne nous empêche pas d’apprécier ici sa finesse et son groove. Enfin, invité sur cinq
titres où il apporte une touche latine, le percussionniste cubain Eliel Lazo
(1983) –que nous avions découvert au Ystad Sweden Jazz Festival en août 2022 (cf. compte-rendu)– a enchaîné les collaborations prestigieuses avec
Chucho Valdés, Michel Camilo, Herbie Hancock, Wayne Shorter, Bob Mintzer
jusqu’au DR Big Band à la suite de quoi, il s’est installé au Danemark en 2007.
Le répertoire joué, entièrement de la main du leader, est
pour l’essentiel constitué de ballades enveloppées dans la sonorité suave de son ténor dont on retrouve ici toutes la sonorité feutrée. De cet
ensemble, on retient surtout une atmosphère, une sorte de mélancolie post-bop
aux harmonies épurées, déclinée au fil des titres dont la mélodie la plus
marquante est celle de «Silver String Valley» qui paraît évoquer les grands
espaces nordiques. «Balanced» et «The
Enchanter» sont deux autres bons thèmes, bien rythmés, mais c’est sur «The Drive», un petit bijou
de swing, que le quartet donne le meilleur, en particulier Henrik Gunde qui
oscille entre l’expressivité gospel et les arpèges classiques.
Encore un très bon disque à mettre à l’actif de Jan Harbeck.
Jérôme Partage
© Jazz Hot 2023
|
  Gwen Perry Gwen Perry
The Ability to Swing
The Ability to Swing, April in Paris, All Night Long, Straighten Up and Fly Right, At Last, The Very Thought of You, Is You Is or Is You Ain't My Baby, I Love Being Here With You, When Sunny Gets Blue, Alright Okay You Win, Everything Must Change
Gwen Perry (voc), Fredrik Carlquist (ts, cl), Michele Faber (p), Pere Loewe (b), Enrique Heredia (dm)
Enregistré les 14 et 15 mai 2019, Barcelone
Durée: 47’ 41’’
Fresh Sound Records 5506 (www.freshsoundrecords.com/Socadisc)
Si la valeur n’attend pas le nombre des années, il arrive parfois qu’elle se révèle tardivement au plus grand nombre. Ainsi, nous découvrons Gwen Perry, 75 ans, originaire de Caroline du Nord. Ayant décroché son premier contrat professionnel dès l'âge de 12 ans, elle débute dans un premier temps une carrière de chanteuse de jazz dans la région de Washington, DC. Puis, autour de 30 ans, elle quitte les Etats-Unis pour l’Europe et se produit dans la célèbre discothèque Tito’s, à Palma de Majorque, haut-lieu du gotha international qui depuis 1923 avait accueilli, entre autres, Charlie Chaplin, Marlene Dietrich, Maurice Chevalier ou Dean Martin, pour fermer ses portes en 2021. Durant une trentaine d’années, Gwen Perry vogue ainsi d’hôtels de luxe en bateaux de croisière et soirées privées pour têtes couronnées et chapeaux à plumes, passant par Le Caire –où elle a vécu dix ans – et l’Italie avant de s’établir définitivement en Catalogne. Les styles musicaux qu’elle emprunte durant cette période sont aussi variés que ses destinations: jazz (elle aura l’occasion d’ouvrir un concert de son idole, Ella Fitzgerald), funk (pour son premier 33 tours, Contestame, édité en 1977 par le label espagnol Drums), disco (avec une adaptation, façon boule à facettes, de «More» sortie sur 45 tours en 1978, en Italie) et autres variétés. C’est au début de la décennie 2010 que Gwen Perry se recentre sur le jazz, entamant une collaboration avec le quartet de la pianiste Michele Faber qui aboutit en 2011 à l’album Mellow (Gilco Productions). Second enregistrement en 2019 avec ces mêmes musiciens, The Ability to Swing, est produit par le label de jazz barcelonais bien connu, Fresh Sound.
A l’image d’autres grandes interprètes que nous avons la chance d’entendre régulièrement en France, comme Mandy Gaines ou Denise King, Gwen Perry n’est pas simplement une chanteuse, c’est une conteuse d’histoires, d’histoires vécues et ressenties. Si sa pratique très familière et maîtrisée des standards sont la marque évidemment d’une grande professionnelle, c’est la profondeur et la sincérité de son expression, enrichies par les années, qui font le sel de cet enregistrement. A son aise sur tous les registres, Gwen Perry est capable d’insuffler une belle énergie swing sur les tempos rapides («Straighten Up and Fly Right») comme de susciter une émotion réelle sur les ballades («Everything Must Change»). Mais c’est sur le blues que la dame est au sommet de son art, nous régalant d’un formidable «Alright, Okay, You Win» (sans doute le meilleur moment du disque), avec le soutien impeccable du quartet. On peut d’ailleurs saluer la qualité de l’accompagnement, en particulier le ténor tonique de Fredrik Carlquist et le piano swinguant de Michele Faber, tous deux particulièrement en verve sur le réjouissant «I Love Being Here With You».
Depuis la sortie de ce dernier disque, Gwen Perry a poursuivi son parcours entre jazz et paillettes, participant avec succès en 2022 à un télé-crochet sur une chaîne espagnole. Elle y a gagné un peu d’exposition médiatique et a enregistré un single pour le compte d’Universal Espagne, «Maybe It’s Time», plus jazzy que jazz. On lui souhaite de revenir vite au jazz, car elle y excelle.
Jérôme Partage
© Jazz Hot 2023
|
  Danger Zone Danger Zone
Introducing
Smokin’, One for CT, In the Still of the Night*, G!, Barron’s Theme, Mind the Tools, Gravy Waltz*, This Is all I Ask, A Night at the Duc, A Boy From Texas°
Alex Gilson (b), Paul Morvan (dm), Björn Ingelstam (tp, voc°), Amaury Faye (p), Michel Pastre (ts), Hetty Kate (voc)*
Enregistré les 12 et 13 avril 2022, Meudon (78)
Durée: 31’17’’
Gaya Music Productions 058 (L’Autre Distribution)
Quoi qu’on pense de l’état du jazz, l’enthousiasme de musiciens formés certes dans les conservatoires mais aussi à la réalité de la scène, connaissant l’histoire, le répertoire, jouant un jazz mainstream avec sincérité, sans chercher à réinventer la roue, fait toujours plaisir. Ils n’en sont pas moins créatifs ces jeunes lions des années 2020 qui n’étaient même pas nés à la glorieuse époque où Jack Lang subventionnait généreusement les artistes des scènes dites actuelles qui hurlaient à la ringardise devant les concerts de Cab Calloway ou de Claude Bolling. Justice du temps qui passe, c’est au final leur production discographique «innovante» qui est tombée aux oubliettes.
Ainsi, le batteur Paul Morvan et le contrebassiste Alex Gilson, la trentaine, ont mûri leur projet pendant la période covid, avec l’envie de jouer sous leurs propres couleurs: Danger Zone, un collectif regroupant des musiciens de la jeune génération (mais pas que) célébrant le jazz des maîtres, d’Art Blakey à Nat King Cole. Le nom du groupe fait référence aux débuts sulfureux du jazz, au temps où il s’épanouissait dans les bordels de New Orleans et les speakeasies de Chicago. Sidemen remarqués notamment auprès de Charles Turner, Champian Fulton, Dmitry Baevsky, ou encore Esaie Cid, Paul Morvan et Alex Gilson sont également depuis juillet 2021 aux manettes de la jam-session du Duc des Lombards. Venu de Rennes, Paul Morvan a été formé au conservatoire et s’est installé à Paris en 2013. La même année, il se produisait à Jazz in Langourla où il avait remporté l’année précédente, avec le quintet de Ludovic Ernault, le tremplin dédié aux jeunes talents. On le retrouve sinon dans le Galaad Moutoz Swing Orchestra et plus récemment dans le quartet de David Sauzay. Originaire de la Marne, Alex Gilson débute à la guitare en autodidacte à 18 ans et fréquente les musiciens manouches, s’essayant également à d’autres instruments: le violon, la batterie, le piano et l’accordéon. A 22 ans, il met fin à ses études d’infographiste pour intégrer une école de musique à Nancy où il commence véritablement à découvrir le jazz et adopte la contrebasse. Puis, diplômé du Conservatoire de Nancy, Alex Gilson participe à des tournées, voyage jusqu'à New York puis rencontre à Paris Laurent Courthaliac qui devient son mentor et le prend comme contrebassiste attitré.
Le duo s’est ici entouré du pianiste Amaury Faye qui évoluait en Belgique ces dernières années, mais qui privilégie actuellement une activité de sideman, notamment en France. Autre trentenaire, le trompettiste suédois, Björn Ingelstam, bien acclimaté désormais à la scène swing parisienne. Michel Pastre, l’aîné de la bande, apporte sa solide expérience et une expressivité toujours aussi puissante et revigorante. Enfin, invitée sur deux titres, l’Anglo-Australienne Hetty Kate participe à la variété de cet album bref (à peine plus de 30 minutes) mais de qualité. Avec un dosage savant entre bons originaux signés des différents membres de l’orchestre et standards, Introducing réussit une belle entrée en matière en maintenant de bout en bout la pulsation jazz. Le paysage musical s’étire entre swing era et bop, avec notamment une évocation évidente et très réussie d’Art Blakey sur «G!» (Paul Morvan) qui nous transporte directement dans les belles années Blue Note. Il s’agit là sans doute du meilleur titre de la série tant par l’intensité rythmique de deux leaders que par les prises de parole, tout en densité et profondeur des deux soufflants, avec un Björn Ingelstam qui ne manque pas ici de nous rappeler Lee Morgan. Au chapitre des hommages, le très dynamique «One for CT» (Björn Ingelstam) fait référence à Clark Terry, tandis que «Barron’s Theme» (Amaury Faye) est dédié bien sûr à Kenny Barron. Côté standards, Michel Pastre expose superbement la ballade de Gordon Jenkins, «This Is all I Ask», tandis qu’Amaury Faye dépose un magnifique tapis harmonique aux pieds d’Hetty Kate, pleine de justesse, sur le gospelisant «Gravy Waltz» (Ray Brown, Steve Allen). Petite curiosité finale, entre country et gospel –avec un Amaury Faye encore ici excellent –, «A Boy From Texas», morceau popularisé par Nat King Cole, sur lequel Björn Ingelstam pose sa voix de crooner. Décidément, on ne s’ennuie pas une seconde! Vite, la suite!
Jérôme Partage
© Jazz Hot 2023
|
  Pepper Adams with The Tommy Banks Trio Pepper Adams with The Tommy Banks Trio
Live at Room at the Top
CD1: Three and One, Civilization and Its Discontents,
Patrice
CD2: Oleo, 'Tis, Time on My Hands, Stella by Starlight
Pepper Adams (bar), Tommy Banks (p), Bobby Cairns (b), Tom Doran (dm)
Enregistré le 25 septembre 1972, Edmonton, AB
Durée: 54’ 54” et 52’
03”
Reel to Real 008 (www.cellarlive.com)
Il existe par chance une biographie de Pepper Adams (Reflectory: The Life and Music of Pepper
Adams, sous-titrée The long-simmering
disapointment) écrite par Gary Carner, et si, malheureusement, elle n’est
jamais parvenue jusqu’à nous, le seul titre laisse la désagréable impression
que les amateurs de jazz sont passés à côté d’un artiste exceptionnel,
sous-estimé. Nous sommes sur ce point en accord avec cette opinion, et si sa
carrière parle pour lui, ses enregistrements en leader auraient pu être plus
nombreux. C’est pourquoi, cette nouvelle exhumation de précieuses bandes de
1972 par les bons soins du producteur Cory Weeds pour ce label canadien de
qualité, Reel to Real, dont c’est la vocation, est un cadeau rare fait aux
amateurs du meilleur du jazz! Signalons pour mémoire locale (France), qu’en
1977, Gérard Terronès avait aussi eu le flair d’enregistrer Pepper Adams en
quartet avec le trio de Georges Arvanitas (Live
in Europe, Impro 02).
Les écrivains du jazz qui en sont à leur centième ouvrage sur Miles, Bird, Duke
ou Trane, etc., accumulation dont la pertinence n’est pas toujours la première
qualité, devraient prendre un jour conscience que le jazz est une musique
populaire à base large et qu’il y a d’autres belles curiosités à creuser et partager.
Pepper Adams en fait partie.
Les lecteurs de Jazz
Hot découvrent Pepper Adams au mois de mai 1958 par une photo pour illustrer un remplacement qu'effectue le quintet de Pepper Adams
avec Donald Byrd au Half Note de New York. C’est seulement 20 ans après, en décembre
1977, dans le Jazz Hot n°344,
dont la couverture et l’article principal sont consacrés au Thad Jones-Mel
Lewis Big Band auquel contribue Pepper Adams depuis l'origine, qu’une interview,
d’où est tirée une partie des informations qui suivent, annonce que Pepper a
l’intention de quitter, sans conflit car il l’aime, ce big band, après 12
années et demie de fidélité, où il a été un soliste de premier plan. La raison
en est la réalisation de projets personnels et des opportunités de tournées, en
quartet, ce qu’il fera en Europe permettant à Gérard Terronès de l’enregistrer à
Bordeaux le 4 novembre 1977. C'est un artiste rare qui parle, avec de belles
photos d’une personnalité sympathique en plus d’être un grand artiste.
Né à Highland Park (Detroit), dans le Michigan, le 8 octobre
1930, dans une famille très modeste qui a subi la crise de 1929 et a erré comme
beaucoup d’autres à la recherche de travail dans ces Etats-Unis déjà sinistrés,
Pepper Adams va connaître Rochester, NY, à partir de 1943 où il écoute
l’orchestre de Bud Powell et Cootie Williams comme celui de Duke Ellington, dans le foisonnement de l'âge d'or, tombant en admiration devant les grands orchestres
afro-américains et artistes de culture. En 1945 à Rochester, il y rencontre ses inspirateurs, Rex Stewart et Harry Carney, qui l’ont par la suite entouré
de leurs conseils et aide. A l’école, il apprend la musique, grâce au soutien
maternel (il sait lire à vue dès 7 ans), le saxophone ténor, soprano, le
piano et la clarinette. Son environnement musical est dévolu à la musique classique
et surtout de jazz, les big bands, les petites ou moyennes formations. Pepper
aime le jazz de culture, de la grande tradition afro-américaine, et on l’entend dans le feu de son jeu, dans sa sonorité, son attaque tranchante sur un instrument aussi lourd, son
imagination débordante, sa conviction, son expression aussi ancrées sur le
blues, le swing et les fondamentaux du jazz. Comme ses
modèles, Pepper joue sa vie dans ses chorus, soutient avec respect ses leaders
et possède autant de personnalité que de sens artistique pour servir la musique
des autres. C’est une autre incarnation parfaite de l’artiste de jazz. Bien
sûr, l’écoute et la rencontre d’Harry Carney sont sans doute à l’origine de son
choix instrumental, mais il en perçoit aussi de nouvelles possibilités en tant
que soliste, et rêve d’en faire un instrument leader, ce qu’il a réussi, ce
disque en atteste.
Il n’est pas le seul sax baryton du jazz, mais il est sans
doute l’un des rares dans ce registre afro-américain des plus aboutis qui se
réalise dans le bebop. Harry Carney sera un compagnon au long cours de Duke
Ellington, et Gerry Mulligan, autre grand leader sur cet instrument, son
quasi-contemporain (1927), gravitera dans l’esthétique euro-américaine du jazz,
une tradition de l’écriture d’un jazz savant moins expressive car plus cérébrale,
moins populaire. Cette dimension «jazz de culture», rare pour un Euro-Américain, Pepper
l’a acquise en jouant dès 14 ans à Rochester dans des orchestres de dancings
afro-américains, devenant «professionnel» (payé) en 1944, six jours par
semaine, ce qui le force à quitter la high
school où il participait à un orchestre dirigé par un ancien de Jimmie
Lunceford (James Smith, tp) tout en apprenant les bases de la culture classique
moderne (Debussy, Ravel, Stravinsky…) et en découvrant Don Byas, Bud Powell et
Dizzy Gillespie…
A la mort de son père en 1946, la famille retourne à
Detroit, MI, «une chance» selon Pepper, car il y a beaucoup de musiciens comme
nous l’a raconté Barry Harris. Il y côtoie Kenny Burrell, Tommy Flanagan, Barry
Harris, Paul Chambers, Doug Watkins le cousin de Paul Chambers, Donald Byrd… Ces
deux derniers sont dans sa formation de 1958 au Half Note. La famille Jones,
Hank, Elvin et Thad, sont aussi des amis proches et l’ont toujours soutenu.
Dans sa discographie, Pepper a régulièrement enregistré avec Hank Jones, Elvin
et Thad de la fin des années 1950 aux années 1980 où il décède. A propos de
discographie, il raconte qu’il a enregistré un premier disque sous son nom en
1948, jamais publié, avec notamment Yusef Lateef…
Ce beau monde part progressivement à New York pour acquérir
une plus grande notoriété et trouver plus de travail, et c’est aussi le choix
de Pepper. Il fait un court engagement avec Stan Kenton en 1955, lors d’un
séjour californien où il rencontre, entre autres, Lennie Niehaus, qui lui a dédié une composition («Pepper»), Shorty Rodgers; il trouve
parfois des engagements en leader de petites formations au tournant des années
1950-60, et c’est en 1957 qu’il enregistre ses premiers disques en leader. Pepper
participe de 1962 à 1964 à l’orchestre Lionel Hampton, à celui de Mingus
(1962-66, Blues & Roots). Il a
d’ailleurs enregistré sous son nom en 1963 Pepper
Adams Plays the Compositions of Charlie Mingus (label Jazz Workshop), avec
Charles McPherson, Dannie Richmond et Hank Jones. Il raconte également que dans
cette époque, sa sonorité ample qui emprunte aux gros sons des années 1930-40
alors que son phrasé est plus ancré dans le bebop, dérangeait parfois les
«modernistes».
Quoi qu’il en soit, c’est au sein du Thad Jones-Mel Lewis Orchestra,
qu’il va pendant plus d’une décennie affermir sa réputation de soliste virtuose
d’un instrument aussi imposant, contribuant à la réputation et à la sonorité de
ce big band qui tourne jusqu’en URSS. Les temps ont changé…
Pepper raconte que ces lundis au Village Vanguard avec cet
orchestre, d’abord en répétition, puis devenu une institution prisée des
amateurs, ont sans doute sauvé un club qui, des années 1960 aux
années 1980, a traversé la tourmente de l’écrasement du jazz par les musiques
commerciales. L’orchestre est très modestement payé, mais Pepper, comme
d’autres, survivent en assurant des séances de studios quand ils n’ont pas de
tournées ou d’engagements. L’horizon s’est à nouveau éclairé à la fin des
années 1970 quand Pepper se lance dans une carrière en leader, mais sa vie
écourtée en 1986 ne lui a guère laissé de temps.
Les qualités de lecteur, de virtuosité ont fait de Pepper
Adams un artiste courtisé par les orchestres, les studios, et si sa discographie
n’est pas ridicule avec plus de vingt disques en leader réalisés avec beaucoup
de compagnons de Detroit en particulier (les frères Hank, Thad et Elvin Jones,
Tommy Flanagan, Donald Byrd, Doug Watkins, Mel Lewis, Jimmy Knepper , Jimmy Rowles, Jimmy Cobbs, Teddy Charles,
Herbie Hancock, Charles McPherson, Duke Pearson, Benny Powell, Roland Hanna, Ron
Carter, Louis Hayes, Billy Hart, George Mraz, Frank Foster, Kenny Wheeler …),
ses contributions en sideman sont tout aussi dignes d’intérêt.
Cet enregistrement ramené à la vie par Corey Weeds a été
effectué au cœur de sa période avec le big band de Thad Jones-Mel Lewis, dans le
cadre d’une institution universitaire canadienne d’Edmonton, à l’Université d’Alberta,
le lundi 25 septembre 1972, dans le local des étudiants Room at the Top. Le
séjour musical s’est étendu sur une semaine. Les universités offrent en ce
temps aux musiciens quelques occasions de compléter leur planning; autres
temps.
Ces deux disques retracent ce moment avec un bon son et un livret
bien documenté, enrichi d’une contribution par Gary Smulyan (bar, 1956),
qui a été en quelque sorte son héritier dans l’orchestre de Mel Lewis, le
Vanguard Orchestra, le Dizzy Gillespie all stars Big Band, le Mingus Big Band,
le Carla Bley Big Band, et d’un échange avec un baryton plus jeune, Frank
Basile (né en 1978).
Pepper Adams y est brillantissime, avec cette qualité
d’articulation qui donne une grande fluidité à son discours en dépit d’un son
profond et d’une attaque véhémente dans la tradition parkérienne du saxophone,
qui a aussi influencé les ténors et les barytons. Le trio de Tommy Banks (1936-2018), un pianiste du cru
canadien, est à la hauteur du rendez-vous. Pour l’anecdote, Banks fut également
sénateur de l’Etat de l’Alberta de 2000 à 2011.
Le répertoire de six thèmes proches des 20 minutes est
constitué d’originaux («Civilization and Its Discontents», «Patrice»), de
standards («Time on My Hands», «Stella by Starlight»), de compositions du jazz
(«Three and One», «’Tis» de Thad Jones,
«Oleo» de Sonny Rollins), et il y est partout un grand saxophoniste inspiré. Pepper Adams a été considéré par beaucoup de ses pairs
comme l’un des meilleurs barytons de l’histoire du jazz (Coleman Hawkins, Curtis
Fuller, Bob Cranshaw, Phil Woods, etc.) et c’est en ce sens qu’on peut trouver
que sa reconnaissance par le public n’a pas été à la mesure de son talent. Sa vie
difficile mais passionnée par le jazz depuis sa jeunesse, marquée par un
accident stupide qui le handicapa dans les années 1970 et par un cancer qui l’a terrassé en 1986, à
56 ans, ne lui a guère laissé de temps.
Voilà un trésor en live qui suffit à nous rappeler le meilleur de cet artiste de jazz, hors norme sur
son instrument, qui se caractérise par une immersion réussie dans la
culture jazz au point qu’il a franchi le mur de verre qui sépare souvent
l’expression des Afro et des Euro-Américains quant à l’authenticité,
la profondeur et la maturité de l'expression, en raison de la différence des niveaux d'expérience qu'évoque James Baldwin (le vécu): il y a dans son jeu une intensité qui ne trompe pas.
|
  Delfeayo Marsalis Uptown Jazz Orchestra Delfeayo Marsalis Uptown Jazz Orchestra
Uptown on Mardi Gras Day
Carnival Time, Uptown on Mardi Gras Day, Big Chief*, Uptown
Boogie*, New Suit, All on a Mardi Gras Day, Midnight at the Zulu Ball, Street
Parade, Mardi Gras Mambo, So New Orleans! (2023), They All Ask’d for You, Mardi
Gras Mambo (For the Jass Cats)*
Delfeayo Marsalis (tb, lead) et selon les titres Scott
Frock, John Gray, Mike Christie (tp), Andrew Baham (tp, voc), Terrance Hollywood Taplin,
T.J. Norris, Ethan Santos (tb), Gregory Speedo Agid (cl), Khari Allen Lee (as,
ss), Amari Ansari (as), Roderick Paulin, Scott Johnson (ts), Roger Lewis,
Trevarri Huff-Boone (bar), Arnold Little III (g), Kyle Roussel, Davell Crawford
(p), David Pulphus, Jason Smiley Stewart (b), William Mobetta Ledbetter (eb,
b), Chris Severin (eb), Herlin Riley, Marvin Smitty Smith (dm), Alexey Marti
(cga), Tonya Boyd-Cannon, Glen-David Andrews (voc) + Branford
Marsalis (ts, ss)*
Enregistré les 14-15 octobre et 10 novembre 2022, New
Orleans, LA
Durée: 55’ 50’’
Troubadour Jass Records 02062023 (dmarsalis.com)
Vous êtes déprimé par l’enchaînement bien huilé des crises sanitaire,
financière, économique, sociale et de la guerre en Europe? Si votre moral ne tutoie pas les
sommets du CAC 40, on vous conseille de suivre l’ordonnance du Dr. Delfeayo Marsalis!
De la médecine 100% naturelle from New
Orleans à base de swing, de groove, de funk, de blues, de cuivres
rutilants, de rythmiques endiablées et de voix rocailleuses comme les fonds du
Mississippi. Une fête du Mardi Gras comme il n’en existe qu’à Crescent City! Uptown on Mardi Gras Day célèbre ainsi
la culture néo-orléanaise et une nouvelle renaissance de la ville, après les
mois d’enfermement –ayant causé l’annulation du Mardi Gras 2021, une première
depuis 1979– et d’incurie sanitaire généralisée –la famille Marsalis l’a vécu dans sa chair avec la disparition du patriarche Ellis–,
alors même que les plaies laissées par l’ouragan Katrina en 2005 ne sont pas
encore cicatrisées et ont encouragé la prédation immobilière.
Durant cette période, Delfeayo, qui, contrairement à ses aînés
Branford et Wynton, n’a jamais quitté New Orleans, s’est d’ailleurs mobilisé
pour venir en aide aux acteurs de la culture néo-orléanaise native avec la création
d’une association, Keep New Orleans Music Alive (KNOMA), destinée à recueillir
et distribuer un fonds d’aide d’urgence. Dans le communiqué accompagnant la
sortie du disque, il s’en explique: «Grâce
à ce travail, j’ai pu interagir avec de nombreux Big Chiefs, Big Queens et
tribus indiennes. Cela m'a permis de me rendre vraiment compte de qui sont ces personnes
et de leur importance dans la communauté. Bien sûr, nous aimons voir les
magnifiques couleurs et les belles plumes, mais ce sont des gens qui ont été
des leaders importants dans la communauté pendant la pandémie. Ils préparaient
de grandes marmites de soul food et faisaient des rondes, s'occupant des
personnes âgées et des infirmes. Un Big Chief m'a dit: "Nous n'avons pas
beaucoup, mais nous voulons nous assurer que ceux qui ont moins que nous soient
pris en charge". Cet album a été inspiré par les histoires que j'ai
entendues des Big Chiefs.» Rappelons que Delfeayo n’a pas attendu le covid
pour développer des dynamiques de solidarité avec notamment la création de
l’Uptown Music Theatre, en 2000, et sa participation à de nombreuses autres
actions pédagogiques.
Avec son Uptown Jazz Orchestra, monté en 2008, Delfeayo
Marsalis convie le monde entier au carnaval, se donnant aussi pour mission de
répandre les good vibes de New
Orleans. A la tête d’un collectif de trente musiciens, dont Branford Marsalis
invité sur trois morceaux, le tromboniste revisite les standards du jazz et du
blues de Crescent City, agrémentés de quelques (bons) originaux de sa main. La
formation ouvre ainsi le défilé façon big band –soutien groovy d’Herlin Riley– avec
une composition d’Al Johnson (p, voc, 1939), «Carnival Time» interprétée au
chant par le trompettiste Andrew Baham, un habitué du Uptown Jazz Orchestra qui
a également signé les arrangements avec le leader. Autre must du répertoire néo-orléanais, «Mardi Gras Mambo» (Frank R.
Adams, Chavers Elliott, Lou Welsch) est l’occasion d’un truculent solo de
Delfeayo avec sourdine, soutenu par les congas d’Alexey Marti: fermez les yeux,
vous êtes aux Caraïbes! Sensation vocale de ce disque, le tromboniste Glen
David Andrews (1979), ici chanteur à l’expressivité soulfull, donne un show aux accents gospel sur «They All Ask’d for
You» (Art Neville, Ziggy Modeliste, Leo Nocentelli, George Porter Jr.) en vis à
vis avec l’excellent Scott Frock (tp) et probablement le très talentueux Davell
Crawford (le livret ne détaille pas les configurations changeantes de
l’orchestre sur chaque titre). C’est d’ailleurs lui qui introduit vraisemblablement
aussi le célèbre «Big Chief» d’Earl King où Branford donne un virevoltant solo
de ténor. Autre titre d’Earl King, «Street Parade» offre un autre espace
d’expression à Glen David Andrews. Si l’orchestration du disque est
majoritairement acoustique, les sonorités électriques (Fender Rhodes, basse)
sont également présentes comme sur «Nuit Suit» de Wilson Turbinton (p, voc,
1944-2007) qui nous embarque vers un funk millésimé décennie 1970.
Pour ce qui est des originaux de ce disque, «Uptown on Mardi
Gras Day» est chanté par l’énergique Tonya Boyd-Cannon soutenue par Davell
Crawford (cette fois crédité) sous les doigts duquel on entend toute une
filiation du piano blues new orleans allant de Professor Longhair à Fats
Domino, en passant par Henry Butler et Dr. John. On retrouve les deux
frères Marsalis sur «Uptown Boogie», une composition au rythme chaloupé où Delfeayo
et Branford déroulent chacun une intervention à la hauteur. Autre réussite
caractérisant le gumbo propre à New Orleans, la reprise de la chanson «So
New Orleans» (présent sur le précédent disque Jazz Party) dont les paroles de Dr. Brice Miller (voc, tp), déclamées
dans le style hip hop, expriment la fierté d’appartenir à une ville populaire, aux racines diverses,
irriguée par la tradition jazz héritée de Buddy Bolden et Louis Armstrong –laquelle ne saurait être réduite à une attraction touristique–, une ville qui se retrouve aussi autour de son équipe de football américain, les Saints.
Vivifiant comme peu de productions actuelles le sont, Uptown on Mardi Gras Day réunit un panel
de talents attestant de la vitalité intacte du phénix néo-orléanais qui rejaillit de feux vaudous du bayou. Un
puissant concentré d’énergie et de combativité, revenant à l’essence même du
blues et du jazz, souvent perçue à tort dans une dimension ludique d'apparence, car sous les costumes perlés et les colliers bariolés, Delfeayo
Marsalis, déjà auteur d’un impertinent Make America Great Again! à la
veille de la présidence Trump, offre à ses semblables une musique de
résistance.
|
  Dave Burns Dave Burns
1962 Sessions
C.B. Blues, Tali, Something Easy, Secret Love, Straight Ahead,
Imagination, Rhodesian Rhapsody, Three-Fourth Blues*, R.B.Q.*, Automation°, Tamra°,
Siam°
Enregistré en juin 1962, New York, NY: Dave Burns (tp), Herbie
Morgan (ts), Kenny Barron (p), Steve Davis (b), Edgar Bateman (dm)
*Enregistré le 19 février 1962, Chicago, IL: Dave Burns (tp),
Al Grey (tb), Billy Mitchell (ts), Bobby Hutcherson (vib), Floyd Morris (p), Herman
Wright (b), Eddie Williams (dm),
°Enregistré le 30 octobre 1962, Chicago, IL: Dave Burns (tp), Billy Mitchell (ts), Bobby Hutcherson (vib),
Billy Wallace (p), Herman Wright (b), Otis Finch (dm)
Durée: 1h 18’ 44”
Fresh Sound Records 1113 (www.freshsoundrecords.com/Socadisc)
Comme le remarque Jordi Pujol, le travail de Fresh Sound de
préservation d’une mémoire élargie du jazz est indispensable, unique en son
genre. Il ne s’agit ici ni de retrouver un trésor enfoui d’un des grands noms
du jazz, œuvre déjà utile et louable, ni de rééditer des albums historiques,
avec parfois quelques inédits, autres œuvres utiles à la connaissance du jazz.
Non, le travail de Jordi Pujol est de restituer ce tissu dense de créateurs du
jazz, de haut niveau, qui pour n’être pas toujours devenu des grands noms du
jazz, n’en possèdent pas moins de talent et de créativité, et qui ont apporté
cette densité artistique propre au jazz, un art surpeuplé en son âge d’or
d’artistes exceptionnels, plus ou moins connus. C’est de cette émulation et de
cette densité sans comparaison dans l’histoire artistique de la planète, que le
jazz a puisé la force de s’imposer à un pays qui n’en voulait pas, mais plus
largement à un monde qui l’a adopté en reconnaissant aussi bien sa force
créatrice que son pouvoir de libération, et d’abord des esprits. Fresh Sound Records
et Jordi Pujol sont effectivement parmi les rares (le seul?) à explorer, avec
ce regard, cette grande base populaire du génie du jazz, né de cette pratique
démocratique, dans une époque (1920 à 1960) qui a entrouvert quelques portes et
fenêtres à l’air frais de la création populaire avant de les refermer à la fin
du XXe et au XXIe siècles. C’est effectivement le seul producteur actuel à
prendre le risque de produire intelligemment de tels albums, comme un vrai
amateur et connaisseur du jazz, regroupant ce qui peut l’être avec des éléments
de biographies, une vraie recherche, pour nous faire saisir que pour
qu’Ellington, Gillespie ou Coltrane existent, il faut aussi ces milliers
d’artistes que le jazz a enfantés, et qui ont pu laisser une belle trace par le
miracle d’un circuit de production discographique du jazz assez indépendant en
ces temps, dont Fresh Sound Records est la queue de comète. Il réactive cette mémoire
déjà oubliée pourtant indispensable pour comprendre la première note du jazz,
car le jazz est d’abord un état d’esprit, une attitude humaine devant la vie,
l’art, la musique.
A l’écoute de l’ignoré Dave Burns (né dans le New Jersey en 1924
et décédé en 2009 à Freeport, NY), trompettiste de haut vol, une sorte de
perfection instrumentale dans tous les registres, avec et sans sourdine, qui a
côtoyé les Savoy Sultans, Dizzy Gillespie (il fit partie du big band historique
de la fin des années 1940 qui se produisit à Paris en février 1948 à la Salle
Pleyel), Duke Ellington Orchestra (1949-50), James Moody, Dexter Gordon, Johnny
Griffin, Milt Jackson (la liste est très longue), on comprend que la richesse
du jazz ne s’arrête pas à l’écoute des grands noms et de quelques enregistrements
historiques, par ailleurs nécessaires. Comme le dit encore la fable de La
Fontaine aux amateurs de jazz, «Travaillez, prenez de la peine, c’est le fonds
qui manque le moins». Dans ce fonds «Dave Burns», regroupant ici des
enregistrements parus en 1962 (à l’origine sur labels Vanguard, Argo, Smash, et
sous les noms de Dave Burns, Al Grey et Billy Mitchell), Jordi Pujol a sélectionné
ces enregistrements avec une pléiade d’artistes de ce début de l’année 1962, encore
connus comme Kenny Barron (déjà essentiel en 1962), Bobby Hutcherson, ou déjà
oubliés, malgré un vrai talent, comme le
leader Dave Burns, splendide de classicisme et de maîtrise expressive, comme le
ténor Herbie Morgan, au beau son d’époque (John Coltrane-Hank Mobley), les
bassistes Steve Davis et Herman Wright, et à un moindre degré dans l’oubli Al
Grey, Billy Mitchell (du velours sur «Tamra»).
Le répertoire est dû à Dave Burns, Kenny Barron, Billy
Wallace présents sur ces séances, à Tom McIntosh (le beau «Tali»), à Gene Kee,
un arrangeur qui a côtoyé Al Grey et Billy Mitchell, avec en sus quelques
standards («Secret Love», «Imagination»).
La musique est une savante alchimie entre le mainstream où a
baigné la jeunesse de Dave Burns et le bebop de sa génération, entre la petite
formation et l’esprit big band («R.B.Q.»), un témoignage de plus que le jazz
est fait de continuité et non de ruptures. Le swing, le blues et une conviction
d’époque donnent à ces enregistrements la force de traverser soixante années sans une
ride. Les ensembles sont magnifiques, le beau son de Dave Burns éclabousse les
thèmes, l’art ne vieillit pas, et c’est aussi à ça qu’on le reconnaît quand on
n’a pas assez d’expérience ou de sensibilité pour s’en apercevoir en temps
réel. Une heure de bonheur, d’un jazz de culture sans fard,
à découvrir, c’est encore possible sans se noyer dans la médiocrité et la superficialité
qui se généralisent en 2023: comme le disait le laboureur à ses enfants, il
suffit de creuser le sillon.
|
  Veronica Swift Veronica Swift
This Bitter Earth
This Bitter Earth*, How Lovely to Be a Woman, You’ve Got to
Be Carefully Taught*, Getting to Know You*, The Man I Love, You’re the
Dangerous Type, Trust in Me, He Hit Me (and It Felt Like a Kiss), As Long as He
Needs Me, Everybody Has the Right to Be Wrong, Prisoner of Love, The Sports
Page, Sing°
Veronica Swift (voc), Emmet Cohen (p, celesta), Yasushi
Nakamura (b), Bryan Carter (dm) + selon les titres, Aaron Johnson (as, bfl,
fl), Armand Hirsch (g, eg) + Lavinia Pavlish*°, Meitar Forkosh*°, Andrew
Griffin (vln)*°, Susan D. Mandel (cello)*°, Steven Feifke (lead*°, choir°), Ryan Paternite, Will Wakefield
(choir)° + Stone Robinson Elementary School Choir° + Walton Middle School Girls
Choir°
Enregistré à New York, NY, date non précisée (prob. 2020)
Durée: 1h 01’ 10’’
Mack Avenue 1177 (www.mackavenue.com)
Après l’avoir découverte à l’occasion du prometteur Confessions,
paru chez Mack Avenue, nous attendions de voir quel chemin allait emprunter Veronica Swift: avec This
Bitter Earth, enregistré en plein covid, la chanteuse tente le grand écart entre le jazz et la musique commerciale avec un répertoire provenant majoritairement de la chanson populaire américaine, de Broadway mais aussi parfois de la pop et du rock. Heureusement pour elle, la présence, une nouvelle fois, du brillantissime Emmet Cohen –autre
artiste Mack Avenue–, renforce l'ancrage jazz du disque, faisant aussi «contre-poids» à l’emploi d’un quatuor à cordes sur quatre
titres. Veronica Swift est particulièrement à son aise sur les comédies
musicales –terreau toujours fertile pour le jazz– dont elle incarne les chansons avec conviction:
«How Lovely to Be a Woman» (Bye Bye
Birdie de Charles Strouse, 1960), avec un Emmet Cohen impérial, «You’ve Got
to Be Carefully Taught» (South Pacificde Richard Rodgers, 1949), «As Long as He Needs Me» (Oliver! de Lionel Bart, 1960). Même réussite sur les succès de Bob
Dorough («You’re the Dangerous Type», 1956), Frank Sinatra («Everybody
Has the Right to Be Wrong», 1965, bon solo à l’alto d’Aaron Johnson) ou du
compositeur Dave Frishberg («The Sports Page», 1971, avec les belles lignes de
basse de Yasushi Nakamura). Veronica, toujours superbement soutenue par le
trio, ne manque pas non plus d'habileté sur les ballades («The Man I Love» de George Gershwin). Sympathique pépite, la reprise de la berceuse venimeuse du
serpent Kaa, «Trust in Me» (tiré du long-métrage très jazz de Wolfgang
Reitherman, produit par Walt Disney Pictures, Le Livre de la jungle, 1967) est fort plaisante, entre
l’accompagnement chaloupé d’Emmet Cohen, la flûte envoûtante d’Aaron Johnson et
le numéro de diva surannée de Veronica Swift.
On comprend moins que «This Bitter Earth», morceau
popularisé par Dinah Washington en 1960 (avec déjà des violons), qui
ouvre l’album et lui donne son titre, soit accommodé à la sauce du remix
grandiloquent réalisé en 2010 par le compositeur anglo-allemand Max Richter.
Car si, avec ou sans violons, Dinah Washington transpire le jazz, Veronica
Swift s’embourbe ici dans la variété sirupeuse. Même constat avec «He Hit Me (and
It Felt Like a Kiss)», bluette pop de l’ensemble vocal féminin The Crystals
(1962), et le morceau de conclusion, «Sing», du groupe de rock américain The
Dresden Dolls, où s’ajoutent à la section de cordes pas moins de deux chorales. En sortant un produit par moment complaisant et calibré pour la grande consommation, Veronica Swift déçoit.
Jérôme Partage
© Jazz Hot 2023
|
  Ludovic Beier Ludovic Beier
Made in Black
Preludio, Swing Ready, Summer Winds, Made in Black, El
Cartel, Some Sweet Years, Swing to Do, Just One for Burt, La luz del dia, Bossa
manouche, Joyful
Ludovic Beier (acc solo)
Enregistré en décembre 2019, Paris
Durée: 39’ 14’’
Artmada Productions LBMIB21 (www.ludovicbeier.com/Socadisc)
A l’image d’une carrière très variée, entre la
sphère Django, musiques de film, jazz-rock ou variétés, d’une rive à l’autre de
l’Atlantique, le dernier album de Ludovic Beier, Made in Black, enregistré fin 2019 en solo et dans les conditions
du live, explore différents
territoires musicaux à travers une dizaine de compositions et improvisations de
l’accordéoniste. Instrument orchestral, comme le piano, l’accordéon se prête
parfaitement à l’exercice du solo. De même, Ludovic Beier, virtuose de
l’instrument et doté d’une expressivité ancrée dans les bals populaires et la
tradition Django depuis sa rencontre fondatrice avec Angelo Debarre en 1999, avait
les atouts pour capter son auditoire tout au long des 40 minutes de son
exercice solitaire. Il n’y parvient pourtant pas tout à fait: certes, la
musique est belle et bien jouée, avec spontanéité. On apprécie les bons moments
à l’énergie jazz («Swing Ready», «Swing to Do»), les ballades où
l’accordéoniste exprime sa sensibilité, passant d’une sonorité qui rappelle l’harmonica
à une autre plus proche de l’orgue («Summer Winds»), ou encore les détours
ensoleillés par le tango («El Cartel»). En dehors de ces titres, l’album pêche par
manque d’intensité –y compris quand Ludovic Beier évoque Django via la bossa
(«Bossa manouche»), en citant «Part Time Lover» de Steevie Wonder)– et des
thèmes un peu faibles dont les mélodies ne marquent pas vraiment l'oreille, alors que la seule reprise proposée est une version
jazzée, habile mais poussive, de «L’Hymne à la joie» de Beethoven
(«Joyful»).
Jérôme Partage
© Jazz Hot 2023
|
  John Coltrane John Coltrane
A Love Supreme: Live in Seattle
A Love Supreme, Pt. I – Acknowledgement, Interlude 1, A Love
Supreme, Pt. II – Resolution, Interlude 2, A Love Supreme, Pt. III – Pursuance,
Interlude 3, Interlude 4, A Love Supreme, Pt. IV - Psalm
John Coltrane (ts, perc), McCoy Tyner (p), Jimmy Garrison
(b), Elvin Jones (dm), Pharoah Sanders (ts, perc), Carlos Ward (as), Donald
Rafael Garrett (b)
Enregistré le 2 octobre 1965, Seattle, WA
Durée: 1h 15’ 28”
Impulse! 00602438499977 (Universal Music)
Voici pour les amateurs nombreux de John Coltrane et de son
quartet légendaire, augmenté en cette occasion de Pharoah Sanders, Carlos Ward
et Donald Rafael Garrett, «embarqués» à San Francisco, au détour d’une tournée
américaine à l’automne 1965, comme rappelé lors de la récente disparition de
Pharoah Sanders (cf. Jazz Hot 2022).
Après une mémorable tournée estivale européenne (Juan-les-Pins, Paris,
Comblain-la-Tour), au cours de laquelle le John Coltrane Quartet a déjà rejoué (Antibes-Juan-les-Pins, John
Coltrane-Love Supreme, Esoldun-Ina/France’s Concert 106) la fameuse suite en
quatre mouvements, en forme de prêche selon l’héritage familial et plus
largement communautaire, un impressionnant ensemble immortalisé le 9 décembre
1964 dans le studio de Rudy Van Gelder (Impulse! AS 77), le quartet de John Coltrane est de retour aux
Etats-Unis. Après la naissance de Ravi Coltrane (le 6 août 1965), le quartet
reprend la route vers la Côte Ouest où le hasard de la vie d’artiste le remet
en contact avec Pharoah Sanders après leur rencontre new-yorkaise (cf. article déjà cité). C’est ainsi que
la troupe se retrouve à Seattle, dans l’Etat de
Washington, pour une semaine déjà en partie documentée, puisqu’il existe un John Coltrane Featuring Pharoah Sanders,
Live in Seattle, enregistré le 30 septembre 1965 (Impulse! AS 9202, cf. discographie de John Coltrane, Jazz Hot n°492), avec le quartet
augmenté, où un autre répertoire a été abordé, tout aussi spirituel («Cosmos»,
«Out of This World», «Evolution») et d’autres prises de ce séjour à Seattle
sont réputées «perdues» ou inédites comme «Body and Soul» et «My Favorite Things»,
«Afro-Blue», avec des formations variables, Donald Garrett y jouant aussi de la
clarinette basse.
Le premier enregistrement de A Love Supreme a connu un succès public considérable, très
étonnant à sa sortie quand on considère la nature de cette musique, un accueil qu’on
n’imagine plus au XXIe siècle pour
une musique sans complaisance, si intense, aussi exigeante et pénétrante, qui
sort littéralement des tripes comme le blues le plus rural, comme le disent,
dans Jazz Hot, McCoy Tyner et, dans
le livret, Elvin Jones, une expérience spirituelle pour les musiciens comme
pour les auditeurs-spectateurs, quel que soit l’endroit où on l’écoute, un bar,
un club ou une église. C’était donc un défi, relevé, pour un public peu averti
de la réalité afro-américaine de ce temps (aussi bien l’histoire culturelle, la
vie quotidienne que l’actualité), au-delà du jazz habituel, mais un public sans
doute plus curieux car le jazz est alors encore la grande culture musicale de
l’après Seconde Guerre, malgré les débuts du rouleau compresseur de la musique
commerciale; John Coltrane Quartet est déjà heureusement une légende,
encore contestée mais admise.
La deuxième exposition en live, à ce jour publiée, de cette œuvre de cet été-automne 1965 a
été exhumée des archives du saxophoniste Joe Brazil (1927-2008), né à Detroit,
MI, qui y organisa une scène jazz dès 1951, et qui a été de longue date un
participant de la scène jazz de cette génération. Il a côtoyé la plupart des
musiciens de son terroir: Barry Harris, Donald Byrd, Joe Henderson, Doug
Watkins, Roy Brooks, Elvin Jones, et tant d’autres! Il faut simplement relire
dans Jazz Hot l’hommage à Barry Harris et ce qui concerne cette ville de Detroit si riche pour le jazz. Joe Brazil est
un ami de John Coltrane, et il l’accueille chez lui lors de ses passages, en
1961, note le livret.
Grâce donc à Joe Brazil, qui en avait fait profiter quelques
amis en privé avant son décès en 2008, on retrouve ici une version en quartet
augmenté de trois invités qui vont durablement intégrer la formation de John
Coltrane jusqu’à sa disparition, trois musiciens jetés dans le grand bain de
cette musique torrentielle mais aussi émouvante, intime, retenue selon les
moments, où le quartet est à son apogée expressive, sans plus aucun frein lié à
la réalité du spectacle. Le bain est sans doute à la température idéale, car
cet enregistrement est aussi bouleversant et majestueux que si les musiciens
jouaient cette musique depuis des années. On dit cela malgré les remarques du
livret qui détecte une perte de cohésion, remarque qui n’a aucun sens, d’après
moi, dans ce type d’expression qui n’exécute pas une partition. Il y a bien sûr
un tel fondement, une telle intensité relationnelle entre eux, une telle
motivation qu’on peut rationaliser sur les repères communs pour comprendre la
rapidité de l’alchimie, et même sur l’apport de volume grâce à cette formation
augmentée, ce qui contribue aux moments paroxystiques, mais vu la complexité de
l’ensemble, il faut aussi bien se dire que les mots et la raison sont parfois
insuffisants pour décrire la création, ce qui se construit dans la durée, un fondement culturel qui plonge ses racines dans les siècles, dans des
biographies complexes, dans un vécu aussi riche que dur, dans une histoire
complexe en Amérique où le racisme est fondateur. Le jazz dans son ensemble est
la pomme d’or d’un long cheminement où la tragédie côtoie l’imagination et la
recherche de la liberté. C’est particulièrement sensible dans ce type d’œuvre.
Au-delà du leader et de nouveaux arrivants, Elvin Jones, Jimmy Garrison sont
simplement extraordinaires, sans doute en transe, car cette dimension
intervient dans cette musique, particulièrement en live, ce qui est un des intérêts supplémentaires de ce disque. On
ne parlera ni de blues, ni de swing, car le blues est la matière première et le
swing, la langue naturelle de ses artistes.
Effectué à l’initiative de Joe Brazil, installé à Seattle
depuis 1961 (où il décède en 2008), sur son magnétophone personnel, au
Penthouse, un club de Seattle créé en 1962 par Charlie Puzzo, une étape qui vit
passer Miles Davis, Aretha Franklin, Wes Montgomery entre autres et qui ferma
en 1968, dont on voit la devanture dans le livret, l’enregistrement a été sans
doute bien restauré, car le son est correct comme le livret, avec plusieurs textes qui resituent l’événement. La photo de couverture est de Raymond Ross, grâce aux
archives de CTS/Images, notre correspondante Cynthia Sesso. A Love Supreme: Live in Seattle du John Coltrane Quartet augmenté est un enregistrement
historique, une nouveauté; merci à Joe Brazil et à ceux qui contribuent à cette
production, dont l’indispensable Zev Feldman!
|
 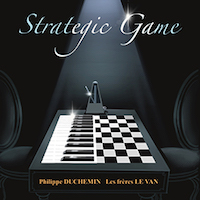 Philippe Duchemin / Les Frères Le Van Philippe Duchemin / Les Frères Le Van
Strategic Game
Strategic Game, Sweet Bossa, Clair de lune, Majesty's Song,
Un joli non, Acrylic Flowers, Caminho De Pedra, Oriental Pursuit, Meandre automnal,
Oscar's Influence, Sur l'eau, Pierro
Philippe Duchemin (p), Christophe Le Van (b), Philippe Le
Van (dm)
Enregistré les 13 mars et 22 juin 2022, Allauch (Bouches-du-Rhône)
Durée: 45’ 09”
Black & Blue 1094.2 (Socadisc)
Il est difficile de chroniquer un tel disque, une surprise,
qui n’appartient pas en totalité à l’univers du jazz malgré les trois
«classiques» de cette musique que sont les frères Philippe et Christophe Le Van et Philippe Duchemin,
qu’on ne présente plus dans ces colonnes, formidable pianiste de jazz, un des
enfants d’Oscar Peterson sur la planète jazz, et fier de l’être à juste titre.
Pour être précis, signalons qu’une partie des thèmes, «Strategic Game»,
«Oscar’s Influence», «Sur l’eau» relèvent de la tradition du jazz, mais la
majorité du disque est plutôt une balade dans un chemin de traverse de Philippe
Duchemin et de ses compagnons (Christophe Le Van apporte trois compositions),
une promenade dans l’imaginaire du pianiste, auteur de la plupart des thèmes. Le projet dans son ensemble relève davantage d’une volonté
de voyage, d’une nouvelle manière, avec des couleurs
classiques (Claude Debussy), bossa nova, romantiques contemporaines, habituellement intégrées dans le jazz de
Philippe Duchemin comme de simples couleurs ou des clins d’œil, alors qu’ici,
c’est plutôt le jazz qui est une couleur (dans le toucher, par le type de
formation et dans le fond mais pour trois thèmes seulement sur douze).
L’expression, loin du blues, et du swing, par choix («Majesty’s Song», «Un joli
nom», «Acrylic Flower», «Oriental Pursuit», «Méandre automnal»…), est une musique «crossover», comme on dit, ou hybride,
le terme en français est plus parlant, même si on y retrouve par séquence des petites touches de jazz. Strategic Game est donc un projet atypique, une curiosité, dans la production de
Philippe Duchemin, agréable à l’oreille, comme un
divertissement dans l’ensemble de l’œuvre à laquelle nous convie habituellement Philippe Duchemin, un
pianiste ancré dans la tradition du jazz et qui sait, personne n'en doute, toute
l’importance des accents du blues et du swing.
Yves Sportis
© Jazz Hot 2023
|
  Pierre Guicquéro Quartet Pierre Guicquéro Quartet
Just in Time
Broadway, I'll Be Seeing You*, Goodbye, You 'n' Me, It Could
Happen to You, Just in Time*, Conception, Stranger in Paradise, Chloe (Song of
the Swamp), Taylor Made
Pierre Guicquéro (tb, voc*), Jérôme Brajtman, François
Brunel (g), Dominique Mollet (b)
Enregistré les 3-4 mai 2022, Meudon (92)
Durée: 47’ 54’’
Camille Productions MS102022 (www.camille-productions.com)
Huit ans après Back From N.O. gravé avec son PG
Projet, Pierre Guicquéro propose un nouveau projet en leader, à la tête d’un
quartet à la configuration inhabituelle: trombone (et chant), guitare solo,
guitare rythmique (les deux électro-acoustiques) et contrebasse. Le leader, rencontré à l’occasion du concert
de sortie, fin janvier, de ce Just in Time au
Marcounet, nous en a précisé la genèse: «Au
départ, j’avais envie de monter un trio intimiste, plutôt musique de chambre,
avec en tête des références comme le trio de Chet Baker avec Philip Catherine
et Jean-Louis Rassinfosse, ou Chet Baker avec Gerry Mulligan. L’idée était une
formation sans batterie. Et François Brunel m’a suggéré d’ajouter Jérôme
Brajtman pour passer au quartet, ce qui donne plus de possibilités de
contre-chants, de thèmes. Quand on a formé ce quartet avec une
deuxième guitare, on a tout de suite pensé au Ruby Braff-Georges Barnes Quartet,
décliné au trombone.»
Chet Baker est encore plus directement convoqué par
Pierre Guicquéro qui pour l’occasion s’est fait chanteur sur deux titres: «I'll
Be Seeing You» et «Just in Time». Une première pour le tromboniste dont le
timbre n’est effectivement pas très loin de celui de Chet. Même si c’est au
trombone que Pierre Guicquéro est le plus profond, les parties chantées
sont agréables à l’écoute et amènent légèreté et diversité à l’ensemble. La
vraie réussite de cet album est d’avoir mené à bien un alliage instrumental où
se mêlent l’esthétique west coast, le
phrasé à la Jim Hall/Joe Pass –évoqué par Jérôme Brajtman (avec un beau développement sur
«Conception»)–, une couleur Django dans l’accompagnement rythmique de François
Brunel (bon solo sur «Broadway») et un excellent Dominique Mollet à la contrebasse.
Le quartet de Pierre Guicquéro revisite ainsi, à travers des
arrangements très fins, pour la plupart réalisés de façon collégiale, un
répertoire de standards et de grandes compositions du jazz dont une superbe
version de «Stranger in Paradise» où l’expressivité du trombone de Pierre Guicquéro est particulièrement mise en valeur, relayée par un superbe solo à
l’archet de Dominique Mollet enrichi du contre-chant du leader.
|
  Buck Clayton Buck Clayton
Complete Legendary Jam Sessions Master Takes
CD1: Moten Swing, Sentimental Journey, Lean Baby, The
Hucklebuck, Robbin's Nest
CD2: Christopher Columbus, How Hi the Fi, Blue Moon, Jumpin'
at the Woodside, Don't Be That Way
CD3: Undecided, Blue and Sentimental, Rock-A-Bye
Basie°, Out of Nowhere, Blue Lou, Broadway, All the Cats Join In, After Hours, Don't
You Miss Your Baby*
Enregistré à New York, les
14 décembre 1953: Buck Clayton (tp),
Joe Newman (tp), Urbie Green (tb), Benny Powell (tb), Lem Davis (as), Julian
Dash (ts), Charlie Fowlkes (bar), Sir Charles Thompson, Freddie Green (g), Walter
Page (b), Joe Jones (dm)
16 décembre 1953: Buck Clayton (tp),
Joe Newman (tp), Urbie Green(tb), Henderson Chambsers(tb), Lem Davis (as), Julian
Dash (ts), Charlie Fowlkes (bar), Sir Charles Thompson (p, celeste), Freddie
Green (g), Walter Page (b), Jo Jones (dm)
31 mars 1954: Buck Clayton (tp), Joe
Thomas (tp), Urbie Green (tb), Trummy Young (tb), Woody Herman (cl), Lem Davis
(as), Julian Dash (ts), Al Cohn (ts), Jimmy Jones (p, celeste), Steve Jordan
(g), Walter Page (b), Jo Jones (dm)
13 août 1954: Buck Clayton (tp), Joe
Newman (tp), Urbie Green(tb), Trummy Young (tb), Lem Davis (as), Coleman
Hawkins (ts), Charlie Fowlkes (bar), Billy Kyle (p), Freddie Green (g), Milt
Hinton (b), Jo Jones (dm)
15 mars 1955: Buck Clayton (tp), Ruby
Braff (crt), Bennie Green (tb), Dick Harris (tb), Coleman Hawkins (ts), Buddy
Tate (ts), Al waslohn (p), Steve Jordan (g), Milt Hinton (b), Jo Jones (dm),
Jack Ackerman (tap dance)°
5 mars 1956: Buck Clayton (tp), Ruby
Braff (crt), Billy Butterfield (tp), J.C. Higginbotham (tb), Tyree Glenn (tb
& vib), Coleman Hawkins (ts), Julien Dash (ts), Ken Kersey (p), Steve
Jordan (g), Walter Page (b), Bobby Donaldson (dm), Jimmy Rushing (voc)*
Durée: 1h 08’ 37”, 1h 17’ 22”, 1h 15’ 07”
Essential Jazz Classics 55753 (www.jazzmessengers.com)
Le natif de Kansas
City, Wilbur Dorsey Buck Clayton (1911-1991), fait partie de la légende de la trompette et du jazz, et ces splendides
enregistrements de 1953 à 1956 fleurent bon le Count Basie Orchestra, version «ancien testament» (années 1930), actualisé dans les années 1950: tout et tous ou presque nous
rappellent cette formidable machine à swing, made in Kansas City, qui a eu tant d’influence sur le jazz, dans
les grandes aussi bien que dans les petites (Nat King Cole, Oscar Peterson…) et
moyennes formations, comme ici. Si Buck Clayton est de Kansas City, ce n’est qu’en 1938
qu’il intègre le Count Basie Orchestra sur la recommandation d’Hershel Evans, remplaçant
Hot Lips Page, après un séjour, original, de trois années à Shanghaï de 1933 à
1937, interrompu par l’invasion japonaise en Chine. Buck Clayton fait partie de la tradition éclatante de la
trompette de Louis Armstrong, et on l’entend encore en 1953 sur le premier
thème («Moten Swing»). Il est aussi un artiste du contre-chant et des chorus de
trompette avec sourdine.
Ici, comme à la fin des années 1930, la section rythmique
avec Freddie Green, Walter Page et Jo Jones, la présence de Charlie Fowlkes,
Joe Newman disent clairement que l’ombre de Count Basie plane sur ces séances,
parfaitement évoqué au piano par Sir Charles Thompson, Jimmy Jones, Billy Kyle
entre autres selon les plages. La présence des gros sons des ténors Coleman
Hawkins et Buddy Tate, renforce cette couleur swing de Kansas City, et
l’intervention de Jimmy Rushing complète la couleur blues de ces enregistrements
comme le répertoire («Moten Swing», «Lean Baby», «Robbin’s Nest»,
«Rock-A-Bye-Basie», «Jumpin’ at the Woodside», «Blue and Sentimental», etc.).
Dans cet esprit, tout est perfection ici, un vrai régal dans
cette synthèse basienne du jazz, avec en dénominateur commun la sonorité
magnifique du leader mais aussi de ses invités de luxe, un vrai all stars
quelles que soient les dates. On perçoit l’absolue liberté de ces ensembles, où, en
raison du format réduit (autour de onze musiciens) par rapport au big band et
de la longueur des thèmes (10 minutes à 30 minutes pour le faramineux
«Christopher Colombus», ou 20 minutes pour le splendide «The Hucklebuck», longueur
impossible à l’enregistrement à la fin des années 1930), en raison aussi de
cette formule jam sessions sur un répertoire complètement possédé par chacun –le jazz de culture essentiel– l’ensemble des solistes s’en donnent à chœur joie en terme de blues
(omniprésent), de riffs («The Hucklebuck») et d’interventions brillantes du
leader et de chacun des invités, connus comme Coleman Hawkins, Al Cohn, ou
moins connus comme Julian Dash, Lem Davis, Charlie Fowlkes (chorus monumental
sur «The Hucklebuck»), avec toujours au service des solistes cette pulsation si
déterminante de Freddie Green ou Steve Jordan, de Walter Page ou de Milt Hinton
et du père des batteurs, Jo Jones, dont l’accompagnement de velours, même en
big band, souligne le swing-blues aérien à la Count Basie qu’évoque avec
maestria Sir Charles Thompson.
Buck Clayton, Joe Newman, Coleman Hawkins, Jo Jones avec
Bennie Green, Urbie Green, Benny Powell, Trummy Young, Dick Harris, J.C.
Higginbotham –quelle formidable brochette de trombonistes!– avec parfois Ruby
Braff et Woody Herman, c’est la garantie d’un sommet de l’expression dans le
jazz. Ce coffret de trois CDs réunit des enregistrements
réalisés à l’origine chez Columbia, soit près de quatre heures d’un jazz dans ce
qu’il a de plus essentiel.
|
 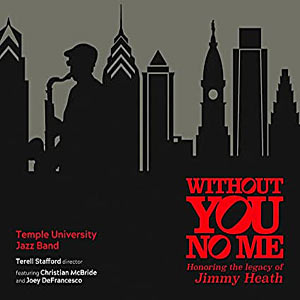 Temple University Jazz Band Temple University Jazz Band
Without You, No Me: Honoring the Legacy of Jimmy Heath
Passing of the Torch, Without You No Me, Bootsie, Please
Don't Talk About Me When I’m Gone, In That Order*, Voice of the Saxophone, I
Can't Give You Anything But Love°, The Wise Old Owl, The Blues Ain't Nothin'
(But Some Pain), Perdido*°
Temple University Jazz Band: Terell Stafford (lead), reste
du personnel détaillé dans le livret + Joey DeFrancesco (org)*, Christian
McBride (b)°
Enregistré en avril 2021, Philadelphie, PA
Durée: 1h 04’ 33’’
BCM&D Records (http://boyer.temple.edu/about/bcmd-records)
Terell Stafford ( Jazz Hot n°632) compte parmi ces messengers qui perpétuent la
transmission du jazz de culture jusqu’aux nouvelles générations. Formé par un disciple
et hériter d’Art Blakey, Bobby Watson, le trompettiste enseigne depuis plusieurs
années dans de grandes institutions et notamment à Temple University, à
Philadelphie, PA, dont il dirige l’orchestre d’étudiants, le Temple University
Jazz Band. Ce dernier a plusieurs enregistrements à son actif avec Terell
Stafford depuis Mean What You Say (Sea
Breeze Vista, 2003) qui avait notamment accueilli Jon Faddis en guest, jusqu’à Covid Sessions: A Social Call (BCM&D Records, 2020), enregistré
à distance durant la période du grand enfermement planétaire. L’année suivante,
la session qui réunissait de nouveau «physiquement» les musiciens pour graver Without You, No Me, était encore marquée
par un protocole sanitaire strict comme en témoignent les photos du livret. Ce
dernier projet est un tribute au
grand Jimmy Heath, disparu juste avant la crise du covid, le 19 janvier 2020. Terell
Stafford avait rencontré le saxophoniste au tournant du siècle,
quand ils jouaient ensemble au sein du Dizzy Gillespie Alumni All-Star Big Band et
avait conservé avec lui une relation de grande proximité. C’est aussi bien sûr
pour la ville de Philadelphie l’occasion de rendre hommage à l’un de ses
enfants, issu de cette extraordinaire famille Heath qui a irrigué le jazz à Philly
et très au-delà. Deux invités de marque, venant également de cette scène, se
sont joints à l’orchestre: Christian McBride et le regretté Joey DeFrancesco dont c’est l’un des tous derniers enregistrements. Le disque s’ouvre avec un bon original, dynamique avec une dimension blues,
«Passing of the Torch» (Passage du flambeau) composé pour l’occasion par l’altiste
Todd Bashore, également professeur à Temple University et ancien élève de Jimmy
Heath au Queens College, NY. Un thème qui évoque bien sûr cette transmission
dont Jimmy Heath a été un inlassable artisan. Autre original réussi, «Bootsie»,
très swing –du jeune ténor Jack Saint Clair, un ancien élève de Temple–, en hommage à une autre figure de Philly, Bootsie Barnes, également disparu en 2020. Les deux invités ont également amené
chacun un thème de leur cru. «The Wise Old Owl» de Chris McBride est dédié à
John Chaney (1932-2021), l’ancien entraîneur de football américain de Temple
(1982-2006), un personnage charismatique dont l’influence s’étendait au-delà
des limites du campus à en croire le livret. Le titre fait référence à la
sagesse du coach et à l'animal-mascotte de l’université. «In That Order» de Joey
DeFrancesco est tiré de son album Trip
Mode (HighNote, 2015). Ce thème mid-tempo aux accents mélancoliques met en
avant le bassiste de l’orchestre, Nathan Pence. L’organiste est aux claviers
sur ce titre nerveux auquel les cuivres apportent de l’ampleur.
L’œuvre de compositeur de Jimmy Heath n’est pas oubliée avec
«Without You, No Me» qui donne son titre à l’album. Ce morceau avait été écrit
par le saxophoniste à la demande de Dizzy Gillespie et enregistré à l’occasion
de ses 70 ans sur Live at the Royal
Festival Hall, London 1987 (BBC Music). Quant au très beau thème «Voice of
the Saxophone», il est superbement exposé au ténor par Dylan Band qui rend
ainsi hommage à la fois au compositeur et à l’instrumentiste. D’autres grandes
pièces du répertoire complètent la set-list:
«The Blues Ain't Nothin' (But Some Pain)» de l’organiste de Philly Shirley
Scott (1934-2002) interprété avec chaleur et conviction par Danielle Dougherty
(voc) qui donne également une version savoureuse de «Please Don't Talk About Me When
I’m Gone» (Sidney Clare/Sam H. Stept). Présent sur «I Can't Give You Anything
But Love» Chris McBride y développe un long solo tout à fait extraordinaire,
faisant sonner sa contrebasse comme un instrument soliste et achevant son
intervention par quelques mesures à l’archet. Un grand moment! L’album s’achève
sur un «Perdido» (Juan Tizol) haut en couleurs où l’on retrouve les deux
invités.
Un bon disque, dont on regrette simplement que le livret ne précise pas plus clairement les noms des compositeurs. Hormis ce détail, on peut louer le souci de Terell Stafford d’honorer avec ses étudiants l’héritage d’un
maître, Jimmy Heath, de même que la mémoire d’autres acteurs du Philly Jazz. Quant aux jeunes talents repérés ici, on leur souhaite de s'épanouir dans leur parcours musical et de servir le jazz de culture comme leurs illustres aînés .
|
 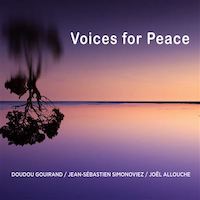 Doudou Gouirand / Jean-Sébastien Simonoviez / Joël Allouche Doudou Gouirand / Jean-Sébastien Simonoviez / Joël Allouche
Voices for Peace
Nature Boy, The Last Poet, Naima, Flying Eagle, My One and
Only Love, Hi-Fly, Voices for Peace, I Fall in Love too Easily, Blue Bolero,
Ugly Beauty
Doudou Gouirand (voc), Jean-Sébastien Simonoviez (p), Joël
Allouche (dm, perc)
Enregistré le 20 avril 2021, Pompignan (Gard)
Durée: 57’ 24’’
Hâtive (www.doudou-gouirand.com)
Doudou Gouirand a été le compagnon de route de Don Cherry,
Mal Waldron, Paul Bley, Jeanne Lee, a joué ou enregistré avec Lester Bowie,
Archie Shepp, Jim Pepper, Bobo Stenson, Chris McGregor, Sangoma Everett, Cheikh
Tidiane Fall, Michel Marre, parmi bien d’autres. Au terme d’un parcours de
saxophoniste alto et soprano passé par le free jazz, les musiques improvisées et
les musiques du monde, Gérard «Doudou» Gouirand sort un premier album en
tant que chanteur, gravé en 2021, l’année de ses 81 ans! Il y livre des
interprétations à fleur de peau, posant une voix joliment voilée, tout en
fêlures, sur des standards de Broadway («Nature Boy» d’Abbez Eden), des
compositions du jazz («Hi-Fly» de Randy Weston et Abbey Lincoln) et quelques
originaux («Voices for Peace»). Jean-Sébastien Simonoviez et Joël Allouche sont
des complices de longue date de Doudou Gouirand qu’ils accompagnent avec une
économie de moyens qui donne à l’ensemble un mood intimiste mettant en
valeur l’émotion créée par la voix, ce qui n’empêche pas des plages de
respiration dues aux longues improvisations de Jean-Sébastien Simonoviez («I
Fall in Love too Easily»). Dans l'atmosphère guerrière de nos temps financiarisés, la paisible poésie de Doudou Gouirand paraît d’un autre temps, et ça fait du bien...
Jérôme Partage
© Jazz Hot 2023
|
  Tchavolo Schmitt Tchavolo Schmitt
Miri Chterna
Seul ce soir, J'attendrai*, Coucou, Le Soir, It Had to Be
You°, Tchavolo Blues, September Song**, Billet doux°, Sheik of Araby, Ghost
Track
Tchavolo Schmitt (g), Julien Cattiaux (g), Edouard Pennes
(b) + invités: Bastien Brison (p)**, César Poirier (cl)°, Khoa-Nam Nguyen (vln)*,
Thomas Descamps (vln)*, Issey Nadaud (avln)*, Alexis Derouin (cello)*
Enregistré le 17 janvier 2022, Paris
Durée: 37’ 50”
Mambo Productions 180261 (L’Autre distribution)
Avec Tchavolo Schmitt, c’est l’assurance d’un moment de
bonheur authentique, et ce disque nous en propose car le génie de la mélodie du
grand guitariste est resté intact après les deux années de silence imposé à la
musique. On peut faire confiance à la liberté tzigane pour s’affranchir de ce
silence autoritaire et conserver cette poésie populaire qui en fait le prix. Sur le répertoire du jazz de la tradition de Django, on
retrouve Tchavolo égal à lui-même, c’est-à-dire chaleureux, direct et poète, dans
le cadre d’une rencontre en trio, parfois agrandie par la présence de quelques
invités. C’est Edouard Pennes, son contrebassiste sur le disque, qui
est à l’origine de cette rencontre enregistrée au Studio Ferber, intervenue
après une double soirée au Duc des Lombards. On comprend son souci
d’immortaliser ce qui est forcément un grand moment de sa vie musicale et un document de celle de Tchavolo.
Si l’expression du grand guitariste reste aussi
simplement virtuose, populaire et vraie, in
the tradition, celle de Django, sans servilité, la musique dans son
ensemble n’a pas toujours la profondeur, l’attaque et l’authenticité d’autres enregistrements
du même Tchavolo Schmitt, comme par exemple le Miri Familia qu’on garde en mémoire. Cela dit pour information, car
cet enregistrement témoigne de l’activité d’un grand artiste de la tradition
de Django, M. Tchavolo Schmitt, authentique dans tous les contextes.
|
  Julien Brunetaud Trio Julien Brunetaud Trio
Feels Like Home
Feels Like Home, Sael, Let It Be, Peace, Red’s Point,
Garfield Groove, Le Grand bleu, Emma’s Smile, Trinidad's Delight, Nola, McCoy’s
Blues
Julien Brunetaud (p), Sam Favreau (b), Cédrick Bec (dm)
Enregistré les 23-24 janvier et 27-28 juillet 2020, Rognes (Bouches-du-Rhône)
Durée: 56’ 13’’
Swing Alley 043 (Socadisc)
C’est dans la Cité Phocéenne où il réside depuis
2018, que Julien Brunetaud a préparé son dernier album, Feels Like Home, enregistré avec deux bons
accompagnateurs du cru: Sam Favreau (1983) et Cédrick Bec (1980), tous deux
formés au Conservatoire de Marseille. Le premier a croisé la route d’André
Ceccarelli, Stéphane Belmondo, Archie Shepp et Liz McComb, le second a côtoyé
sur scène Riccardo Del Fra, Ambrose Akinmusire et Wynton Marsalis. On
retrouve sur ce disque les qualités de jeu qui caractérisent Julien Brunetaud:
l’enracinement dans le blues, les couleurs de New Orleans, le swing. On
retrouve aussi les envies contradictoires et les questionnements de cet encore
jeune homme qui cherche d’autres voies parallèles pour s’exprimer. Sur son
précédent disque, Playground, Julien voulait jeter des ponts avec la pop (il
n’y a d’ailleurs visiblement pas renoncé), sur Feels Like Home, album où pour la première fois il ne chante pas,
il entend élargir sa palette au piano post bop, de McCoy Tyner (auquel il a
dédié l’excellent «McCoy’s Blues») à Keith Jarrett et ses succédanés («Sael»,
«Le Grand bleu», ballades quelque peu évanescentes). De ce fait, le répertoire de
compositions proposé est inégal, même si la majorité des thèmes
sont assez réussis, de la ballade swing qui ouvre l’album «Feels Like Home» au bluesy
«Emma’s Smile», en passant «Trinidad's Delight», aux accents stride, et le
dynamique «Red’s Point» qui évoque le quartier marseillais de la Pointe Rouge. La
seule reprise, celle du tube de Paul McCarthney, «Let It Be», s’avère plutôt
habile: parmi les tentatives de jazzification des Beatles, on a déjà fait moins
bien! Pour autant, le disque aurait gagné en authenticité et profondeur
d’expression en conservant une cohérence de répertoire, le jazz ne manque pas de diversité et de richesses infinies pour s'égarer sur les sentiers rebattus de réminiscences adolescentes.
Jérôme Partage
© Jazz Hot 2023
|
 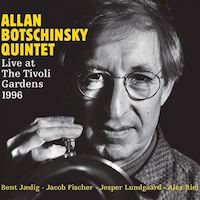 Allan Botschinsky Quintet Allan Botschinsky Quintet
Live at The Tivoli Gardens 1996
CD1: Four, A Song for Anna Sophia, It's You or no One, I
Thought About You, What's New, Donna Lee
CD2: What Is This Thing Called Love, All of You, Rhythm-a-Ning,
It Might as Well Be Spring, I'll Remember April
Allan Botschinsky (flh), Bent Jædig (ts), Jacob Fischer (g),
Jesper Lundgaard (b), Alex Riel (dm)
Enregistré le 6 juillet 1996, Copenhague (Danemark)
Durée: 1h 07’ 36’’ + 1h 08’ 22’’
Stunt Records 22042 (www.sundance.dk/www.uvmdistribution.com)
Le bon label danois Stunt Records continue de documenter la vie
jazzique de Copenhague en proposant cette fois un enregistrement inédit de 1996
du trompettiste et bugliste Allan Botschinsky (1940-2020). Il y partage la
scène avec un compagnon de longue date, le ténor Bent Jædig (1935-2004). Tous
deux sont originaires de Copenhague et sont des acteurs importants du jazz au
Danemark où ils ont joué et enregistré avec plusieurs grands musiciens
d’Outre-Atlantique, à l’occasion de leurs séjours plus ou moins prolongés,
notamment avec Thad Jones lorsqu’il dirigeait le fameux Danish Radio Big Band
(1977-1978) et dont la trace discographique, avec l’album A Good Time Was Had By All (Metronome, 1978), permet de mesurer
l’excellence de cette formation qui comptait alors, outre Allan Botschinsky et
Bent Jædig, Jesper Thilo, Niels-Henning Ørsted Pedersen ainsi que d’autres
«historiques» de la scène jazz danoise, tels Uffe Karskov (s, fl, 1930) et Bjarne
Rostvold (dm, 1934-1989) qui sont autant de passeurs ayant permis une
transmission de la pratique et du spirit des maîtres vers les plus jeunes générations de musiciens scandinaves. Allan
Botschinsky et Bent Jædig ont encore en commun d’avoir développé en partie
leur carrière en Allemagne.
En effet, Bent Jædig y a résidé dans les années 1950,
travaillant notamment avec Peter Herbolzheimer (tb, 1935-2010). Il rentre ensuite
au Danemark pour codiriger un quintet avec Bent Axen (p, 1925-2010) qui
comprend… Allan Botschinsky. Ils enregistrent ainsi en 1960 Let's Keep the Message (Debut Records).
Dans les années qui suivent, Bent Jædig joue aux côtés de Dollar Brand (alias Abdullah
Ibrahim) et Don Cherry, Tete Montoliu, Jimmy Woode, Philly Joe Jones, Dizzy
Reece… Il grave un premier disque sous son nom (orthographié Jädig), Danish Jazzman (Debut Records), en 1967, toujours avec Bent Axen et
Allan Botschinsky, mais également Niels-Henning Ørsted Pedersen et Alex Riel.
Dans les années 1970 et 1980, il continue de collaborer avec des jazzmen
américains comme Wild Bill Davison, Art Farmer, Stan Getz, et reste actif,
également à la tête de ses propres formations, jusqu’à son décès. Preuve de
l’étroitesse de sa relation avec la communauté jazz américaine, Charles Davis
(ts, 1933-2016) enregistre en 2006 un Plays
the Music of Bent Jædig: Our Man in Copenhagen (Fresh Sound).
Quant à Allan Botschinsky, il est le fils d’un joueur de
basson professionnel et commence l’étude de la trompette classique à 11 ans. Trois
ans plus tard, il entre à l’Académie danoise royale de musique. Il fait ses
débuts de jazzman dans le big band de son condisciple Ib Glindemann (tp,
1934-2019), de 1956 à 1959, puis commence une carrière de soliste tout en
accompagnant Dexter Gordon, Ben Webster, Stan Getz, Oscar Pettiford, Lee Konitz,
Shahib Shihab ou encore Kenny Dorham. Entre 1963 et 1964, il part se former à la
Manhattan School of Music et, à son retour, devient un membre régulier du
Danish Radio Big Band. En 1985, il s’installe à Hambourg où il se produit à son
tour avec Peter Herbolzheimer, ainsi qu’avec l’European Trumpet Summit, en plus
de ses propres groupes. Il y fonde, en 1987, un label, M.A. Music, avec sa sœur
Jette Botschinsky et son épouse Marion Kaempfert, tout en gravant également des
sessions pour d’autres labels comme Storyville, Stunt et Telefunken. A partir
des années 2000, sa santé lui rend difficile la pratique de l’instrument, mais
il compose, notamment de la musique classique.
Ce Live at The Tivoli
Gardens 1996 évoque aussi la mémoire d’un lieu disparu, le Jazzhus
Slukeefter, un pavillon du XIXe siècle niché dans les jardins du parc d’attractions
Tivoli, dédié à l’origine à la chanson populaire et devenu un haut-lieu du jazz
à Copenhague où ont notamment enregistré Phineas Newborn, Jr. (Tivoli Encounter, Storyville, 1979, avec
Bjarne Rostvold) et Hank Jones (Live at
Jazzhus Slukefter, vol. 1 et 2, Storyville, 1983). En juillet 1996, c’était
le clarinettiste Jørgen Svare (1935) qui en assurait la direction artistique. Le
livret nous apprend par ailleurs que le concert au Slukeefter s’est tenu dans
le cadre du Copenhagen Jazz Festival.
Au sein de la section rythmique, on retrouve trois
excellents musiciens dont les parcours ont aussi croisé ceux des plus grands.
De la même génération que les deux soufflants et partenaire ponctuel, Alex Riel
(1940) a poursuivi une carrière plus éclectique, empruntant des passages par la
fusion et le rock. Pour autant, dès ses débuts au milieu des années 1960 dans
l’orchestre maison du club Montmartre, aux côtés de NHØP avec au piano, selon
les périodes, Kenny Drew ou Tele Montoliu, le batteur a eu également l’occasion
d’accompagner plusieurs légendes du jazz comme Johnny Griffin, Jackie McLean, Don
Byas, Donald Byrd et, bien sûr, Ben Webster et Dexter Gordon dont quatorze
enregistrements avec Alex Riel, réalisés entre 1964 et 1976, ont été édités par
SteepleChase. On le verra également auprès de Wayne Shorter, Freddie Hubbard,
Dizzy Gillespie, Gary Burton, Gary Peacock, entre autres. Le contrebassiste
Jesper Lundgaard (1954) figure lui aussi sur le disque live de 1978 avec le DR Big Band de Thad Jones. Sa copieuse
discographie –plus de quatre cents titres, avec des musiciens danois ou américains–
est éloquente: on y croise Chet Baker, Paul Bley, Tommy Flanagan, Eddy Lockjaw
Davis, Horace Parlan, Kirk Lightsey... Il a aussi longuement accompagné Svend
Asmussen, tout comme Jacob Fischer (1967). Agé de 26 ans à l’époque de
l’enregistrement, le guitariste autodidacte a déjà alors près de dix ans de
carrière, dont quatre auprès du grand violoniste danois. Il a également, depuis
ses débuts et jusqu’à aujourd’hui, partagé la scène avec Monty Alexander, Art
Farmer, Toots Thielemans, Lee Konitz, Harry Allen de même que Scott Hamilton.
Pas pressé de se mettre en avant, il a attendu 2008 pour sortir un premier
album en leader, Jacob Fischer Trio Feat.
Svend Asmussen (autoproduit). Ce double album s’ouvre avec un solo crépusculaire
d’Allan Botschinsky exposant le thème «Four», signé de Miles Davis, dont on
perçoit clairement l’influence sur son jeu. Avec beaucoup de sensibilité et
l’accompagnement délicat de Jacob Fischer, le bugliste introduit également «A
Song for Anna Sophia», une jolie ballade de son cru, qui est d’ailleurs le seul
original interprété. L’intervention de Bent Jædig, suave et profonde, répond
superbement au leader, achevant de nous convaincre que nous avons ici affaire à
deux solistes de haut niveau à l’expressivité remarquable. Partout sur ce
disque, le swing est à l’œuvre, portée par une rythmique enthousiasmante dont
un Alex Riel très en forme (long solo d’une grande densité sur «I'll Remember
April»). Tandis qu’à côté du robuste Jesper Lundgaard, Jacob Fischer déploie ses
notes avec finesse et agilité (bonne intervention sur «What Is This Thing
Called Love»). Le quintet d’Allan Botschinsky nous offre ainsi deux belles
heures de jazz auxquelles la chaleur du live apporte encore un supplément d’âme
.
|
CHRONIQUES © Jazz Hot 2022
|
|

